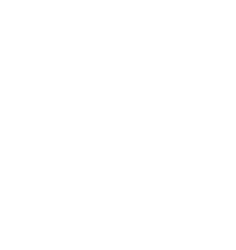Actualités
- 2026
- 2025
- 2024
À la une
Edouardo della Faille : Le talent ne connaît pas la différence
Portrait : Edouardo della Faille de Leverghem, 38 ans, est un artiste sensible et créatif. Observateur attentif du monde, il aime s’exprimer par les mots autant que par le corps. Danseur, circassien et comédien, il s’est produit à de nombreuses reprises sur scène. Il joue actuellement dans Justices, un spectacle inspiré de La Divine Comédie de Dante.Comment le théâtre est-il entré dans votre vie ?Le théâtre est d’abord entré dans ma vie à l’école, puis à travers ma participation à deux spectacles de L’Enfant des Étoiles. Les rencontres avec Jacqueline Beghin (L’art d’être différent), Frédérique Joye (Mouvements sans frontières) et Joëlle Shabanov du Créahmbxl ont été déterminantes. Elles m’ont permis de découvrir le besoin d’exprimer mes émotions, le plaisir de raconter des histoires et celui de rencontrer les autres. Très vite, la scène est devenue pour moi un véritable espace de liberté.Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier d’acteur ?Ce que j’aime par-dessus tout, c’est incarner des personnages différents. Chaque rôle est une nouvelle aventure humaine. Le contact avec le public est une grande source d’émotion. J’aime aussi voyager avec la troupe et partager de bons moments ensemble.Qu’est-ce qui compte le plus pour vous dans la pièce Justices, dans laquelle vous jouez actuellement ?Ce qui me touche le plus, c’est le message de justice et d’humanité porté par le spectacle. Il invite le public à réfléchir à la responsabilité, à la vérité et au regard des autres. J’y joue avec beaucoup d’engagement et de sincérité.Où pourrez-nous vous voir prochainement ? Et quels sont vos projets à venir ?Je jouerai début janvier à Marseille, puis les 4 et 5 février au Théâtre Le Manège à Mons, et du 7 au 11 avril au Théâtre National à Bruxelles. D’autres dates pour 2026 et 2027 sont en cours de confirmation. Je participerai également à un projet européen autour du théâtre inclusif à Varsovie en mars, avec Clément Papachristou, metteur en scène de Justices. Par ailleurs, un nouveau spectacle de danse, Mon Amour, est actuellement en création avec Joëlle Shabanov, chorégraphe au Créahmbxl.📍 Prochaines dates de JusticesDébut janvier à Marseille4 et 5 février au Théâtre Le Manège – MonsDu 7 au 11 avril au Théâtre National de BruxellesNous remercions monsieur Philippe de Potesta pour cette interview.
Toutes les actualités
Jean Rubay : guérir un enfant, c'est lui offrir un avenir
Chaîne de l’Espoir, voilà bien une expression qui fait jaillir des étoiles dans les yeux ! Et ce n’est pas un mirage. Nous en voulons pour preuve les réponses que le baron Jean Rubay, professeur émérite de chirurgie cardiaque et président fondateur de la Chaîne de l’Espoir nous a données. Professeur, vos spécialisations sont la chirurgie cardiaque pédiatrique ainsi que la chirurgie cardiovasculaire et thoracique que vous avez pratiquées en France Angleterre Afrique du Sud et Australie. Comment s’est enclenché ce chemin ?Il y a eu en plus de la transmission génétique et intellectuelle paternelle, la conviction de l’aide au prochain, la passion pour la création et la reconstruction qui trouve son expression dans la chirurgie cardiaque qui est une chirurgie de réparation d’une malformation présente dès la naissance.Comment est née la Chaîne de l’Espoir Belgique- Keten van Hoop België?En raison de la facilité d’accès aux soins les plus qualifiés dans notre pays ainsi que leur quasi-gratuité et imprégné de l’altruisme lié à notre profession, il nous est apparu évident qu’il fallait offrir cette même qualité sanitaire aux pays qui en disposaient le moins.Face à ce constat, les cardiologues pédiatres André Vliers et Thierry Sluysmans se sont joint à moi, chirurgien cardiaque pour fonder en 1997 l’association, copie belge de celle de France bien que strictement indépendante. Reconnue ONG en 2004, elle a grandi sous l’impulsion de sa directrice Anita Clément de Cléty. Son Conseil d’Administration rassemble des professionnels issus de divers horizons, assurant ainsi la stabilité et la vision de notre action.Notre slogan est : une malformation, une opération, une guérison, une formation. Après l’Amérique latine - Bolivie, Vénézuéla et Nicaragua -, c’est vers le continent africain que ce sont portés nos efforts, en particulier la RDCongo et le Bénin.Vous avez des projets dans différents pays ; comment opérez-vous des choix et comment les réalisez-vous ?Ce sont les médecins locaux, souvent formés en Belgique, qui font appel à notre association. Nous intervenons dans les domaines cardiaques, orthopédiques, urologiques : en fait, le choix se porte sur toute malformation infantile qui peut être guérie par un geste chirurgical. Pour qu’un projet soit réalisable, des conditions minimales doivent être réunies, notamment des infrastructures hospitalières suffisamment adaptées. La Chaîne de l’Espoir Belgique apporte alors son expertise médicale, un appui financier ciblé et un accompagnement pour renforcer les services de pédiatrie et de chirurgie.Notre approche vise également la pérennité : nous collaborons avec les autorités locales afin de les sensibiliser aux besoins spécifiques de la santé infantile, et les incitons à investir pour combler les manques souvent dramatiques qui se situent à différents niveaux : enseignement universitaire, formation, soins et gestion.Vous opérez des enfants en Belgique. Comment se passe leur prise en charge depuis leur pays jusqu’à Bruxelles ?Seule une minorité d’enfants est transférée en Belgique. Cela se produit lorsque le délai entre deux missions chirurgicales est trop long pour garantir leur prise en charge locale ou si l’association n’intervient pas dans le pays. Nous recevons des demandes via des médecins locaux, les dossiers sont analysés par un comité médical belge composé de spécialistes de la pathologie de l’enfant. Si les critères médicaux sont réunis et que le financement est assuré, l’enfant est alors accueilli en Belgique. L’enfant vient sans ses parents et est accompagné durant les voyages par des bénévoles d’Aviation Sans Frontières. Il est accueilli dans des familles qui leur procurent toute l’attention et l’amour durant toute la durée de ce séjour traumatisant.Le contact est maintenu quotidiennement avec la famille biologique. Après 6 à 8 semaines, une fois l’intervention et le suivi terminés, l’enfant peut rentrer guéri auprès des siens.Formez-vous aussi des médecins ou des équipes médicales dans ces différents pays ?L’essentiel de notre activité se passe dans les pays précités. Le « primum movens » de notre association est la formation pour qu’ils puissent à terme plus ou moins lointain le faire par eux-mêmes. A cette fin nous avons mobilisé les quatre centres universitaires agréés belges qui pratiquent la chirurgie pédiatrique congénitale- UCL, KUL, UZ GENT et HUDERF - et cette collaboration en plus d’être enrichissante fait ma fierté.La chirurgie qu’elle soit cardiaque ou orthopédique sauve des vies au quotidien et la Chaîne de l’Espoir Belgique incarne remarquablement cette mission à l’échelle mondiale, tout imprégnée de la conviction que guérir un enfant c’est lui offrir un avenir ! Au terme de cet interview, il me semble que le mot « magnifique » peut être prononcé moultes fois et cela fait chaud au cœur : c’est le cas de le dire !www.chaine-espoir.bePlace Carnoy, 151200 Bruxelles Belgiqueinfo@chaine-espoir.be+32 2 764 20 60+32 478 60 50 98Nous remercions la comtesse Emmanuel de Ribaucourt pour cette interview.
Edouardo della Faille : Le talent ne connaît pas la différence
Portrait : Edouardo della Faille de Leverghem, 38 ans, est un artiste sensible et créatif. Observateur attentif du monde, il aime s’exprimer par les mots autant que par le corps. Danseur, circassien et comédien, il s’est produit à de nombreuses reprises sur scène. Il joue actuellement dans Justices, un spectacle inspiré de La Divine Comédie de Dante.Comment le théâtre est-il entré dans votre vie ?Le théâtre est d’abord entré dans ma vie à l’école, puis à travers ma participation à deux spectacles de L’Enfant des Étoiles. Les rencontres avec Jacqueline Beghin (L’art d’être différent), Frédérique Joye (Mouvements sans frontières) et Joëlle Shabanov du Créahmbxl ont été déterminantes. Elles m’ont permis de découvrir le besoin d’exprimer mes émotions, le plaisir de raconter des histoires et celui de rencontrer les autres. Très vite, la scène est devenue pour moi un véritable espace de liberté.Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier d’acteur ?Ce que j’aime par-dessus tout, c’est incarner des personnages différents. Chaque rôle est une nouvelle aventure humaine. Le contact avec le public est une grande source d’émotion. J’aime aussi voyager avec la troupe et partager de bons moments ensemble.Qu’est-ce qui compte le plus pour vous dans la pièce Justices, dans laquelle vous jouez actuellement ?Ce qui me touche le plus, c’est le message de justice et d’humanité porté par le spectacle. Il invite le public à réfléchir à la responsabilité, à la vérité et au regard des autres. J’y joue avec beaucoup d’engagement et de sincérité.Où pourrez-nous vous voir prochainement ? Et quels sont vos projets à venir ?Je jouerai début janvier à Marseille, puis les 4 et 5 février au Théâtre Le Manège à Mons, et du 7 au 11 avril au Théâtre National à Bruxelles. D’autres dates pour 2026 et 2027 sont en cours de confirmation. Je participerai également à un projet européen autour du théâtre inclusif à Varsovie en mars, avec Clément Papachristou, metteur en scène de Justices. Par ailleurs, un nouveau spectacle de danse, Mon Amour, est actuellement en création avec Joëlle Shabanov, chorégraphe au Créahmbxl.📍 Prochaines dates de JusticesDébut janvier à Marseille4 et 5 février au Théâtre Le Manège – MonsDu 7 au 11 avril au Théâtre National de BruxellesNous remercions monsieur Philippe de Potesta pour cette interview.
Patricia de Cooman : la solidarité en action, soir après soir
Patricia de Cooman fait partie de ces personnes qui transforment la solidarité en action concrète. Bénévole de longue date, elle s’engage au sein de l’ASBL Opération Thermos, qui va à la rencontre des personnes en grande précarité à Bruxelles avec des repas chauds, une écoute et une présence. Dans cet échange, elle évoque l’engagement des bénévoles, la réalité du terrain et les besoins de l’association pour poursuivre sa mission. “En une minute, peux-tu me dire c’est quoi l’Opération Thermos, et pourquoi elle existe ?”‘Opération Thermos’ est née en 1987, à l’initiative de scouts sensibilisés à la précarité des personnes vivant dans la rue. Devenue ASBL, elle distribue chaque soir, du 1er novembre au 30 avril, des repas chauds et des boissons. La distribution a lieu au métro Botanique à 20h : soupe, plat chaud, dessert, pain, eau, café ou chocolat chaud.Pourquoi as-tu décidé de t’impliquer dans ce projet et qu’est-ce que cela t’apporte ?Il y a 23 ans, nous avons entendu un appel à la paroisse : il manquait des bénévoles. Nous voulions un projet humanitaire familial, près de chez nous, et nos deux fils (12 et 10 ans à l’époque) ont tout de suite été partants. Aujourd’hui, ils ont grandi, sont devenus papas et continuent à venir distribuer avec nous : la relève est assurée. On reçoit énormément en retour, et nous avons même créé des liens avec certains bénéficiaires.À qui vous vous adressez ? Qu’est-ce qui vous distingue dans l’aide aux personnes en grande précarité ?Nos bénéficiaires sont de plus en plus nombreux : nous sommes passés d’environ 80–100 repas à une distribution que nous devons limiter à 200, faute de moyens financiers et logistiques. Le repas est totalement gratuit.Concrètement, comment se déroule une soirée type : de la préparation à la distribution ?Dès 16h, une dizaine de bénévoles cuisinent sous la supervision d’un encadrant. Les repas sont acheminés au métro Botanique en bus STIB, partenaire de l’association. À partir de 19h15, d’autres bénévoles accueillent les bénéficiaires ; le repas est remis en sac “take away”.Si je comprends bien, une saison s’étend de novembre à avril : combien d’équipes/volontaires sont mobilisés sur une saison ?Chaque soir, une équipe se relaie pour assurer la distribution des 200 repas : parfois des entreprises (team building), mais aussi des groupes de jeunes ou d’adultes, sensibilisés au sans-abrisme. Certaines équipes reviennent plusieurs fois, d’autres une seule. .Aujourd’hui, de quoi avez-vous le plus besoin pour continuer, et comment aider concrètement ?Nous avons surtout besoin d’aide humaine et financière : il manque des bénévoles en station, et encore plus en cuisine. Les dons de vivres/repas sont appréciés, mais les dons financiers le sont particulièrement (déduction fiscale dansles règles de la loi). Bonnets, écharpes, gants et chaussettes sont utiles lors des grands froids (pas de vêtements).Le planning de cet hiver n’est pas encore complet, n’hésitez pas à vous inscrire ici planning@operationthermos.be Patricia de Cooman reste à votre disposition pour toutes questions ou suggestions : decoomanthibault@hotmail.com
"Trait d'union entre particules"
Paru en octobre 2025 : "La Famille dans la Belgique d’aujourd’hui"Moins d’un siècle après la publication de La Famille dans la Belgique d’autrefois par le comte Louis de Lichtervelde, le concept de famille connaît une transformation sans précédent. Dans une société marquée par un individualisme croissant, la cellule familiale traditionnelle se redéfinit sans cesse, partagée entre mémoire collective et aspirations personnelles.Cet essai interroge la place de la famille aujourd’hui : l’éducation, la transmission, l’habitat, les structures émergentes, le rôle des grands-parents, les politiques publiques… autant de dimensions qui éclairent les tensions et recompositions actuelles. Au cœur de cette réflexion, une question essentielle : que signifie encore « la Famille » dans sa complexité contemporaine ?Volume de 153 pages, format A5, couverture souple, diffusion restreinte.Prix : 20 € (+ frais d’envoi éventuels pour la Belgique).ISBN : 978-2-9603805-0-7Possibilité de récupérer, sur rendez-vous, votre exemplaire au Bureau d’Iconographie de l’ANRB.Contact : Pierre-Alexandre de Lannoy - pieralexdelannoy@gmail.comDate de parution: 24 novembre 2025 : "Alles Welbeschouwd. Een bevoorrecht leven"Journaliste envoyée aux quatre vents, Mia Doornaert y a appris une vérité cardinale : les étrangers sont différents, et nous le sommes pour eux, car pétris par une histoire et une culture radicalement différentes. Ã base de ses souvenirs, elle fait vivre les grands acteurs géopolitiques – Amérique, Russie, Moyen-Orient, une Europe perméable à l’islam – à partir de leur propre histoire.Mia Doornaert "Alles Welbeschouwd. Een bevoorrecht leven". 320 p. Date de parution: 24 novembre 2025. Ertsberg/Standaard Uitgeverij."Petite Philosophie des categories inévitables" par Luc de Brabandere - Ed. EyrollesDans son dernier ouvrage, Luc de Brabandere nous émerveille encore par son érudition, sa clairvoyance et son humour.Il démontre avec un brio et une clarté remarquable que penser, communiquer et agir ne peut se faire qu'en structurant le monde qui nous entoure, en le répartissant dans des cases, donc en créant inévitablement des catégories. Prenez une conversation au hasard et vous remarquerez que les catégories sont partout ! Qu'il s'agisse d'espèces en voie de disparition, de secteur de l'économie, de familles politiques, de genre littéraire ou encore de discipline scientifique, la démarche est toujours la même : un domaine complexe est découpé en morceaux dans le but d'être appréhendé.Et cela depuis la nuit des temps !Mais, au fil du temps et des époques, des catégories changent, certaines disparaissent, d'autres apparaissent, pour mieux refléter et structurer l'évolution du monde, de la société et des mentalités. Dans cette perspective, les catégories ne sont pas seulement inévitables, mais aussi indispensables.L'auteur parsème son histoire des catégories avec des exemples savoureux. Plus inquiétant, il nous alerte à juste titre sur l'émergence des algorithmes qui permettent aux géants du numérique (Amazon, FB, Google, ...) de créer des catégories à la demande et sur mesure. Enfin, il nous montre que les trois modes de pensée - pensée logique, pensée créative et pensée critique - impliquent chacun, malgré leurs grandes différences, la manipulation de catégories.Cette huitième Petite Philosophie sur l'idée de catégorie est un bonheur de lecture que nous vous recommandons vivement.Dans "La Huppe et la reine de Saba", Catherine d’Oultremont réinvente la légende de Makéda : royaume matriarcal, magie solaire, intrigues et voyage initiatique où s’entrelacent passions, identité, mystères et pouvoir. La Huppe et la reine de Saba | Asmodée Edern ÉditionsDate de parution : 25/10/2025Editeur EdernNombre de pages 232
L'année de la confusion
Au moins cinq événements ont provoqué cette année une confusion politique, économique et sociale : le second mandat du président Trump, l'effritement de la mondialisation, l'impuissance de l'Europe, l'avancée rapide de l'intelligence artificielle et la montée en puissance géopolitique de la Chine. Ces cinq-là sont mon choix. Il y en a d'autres et bien sûr il y a la crise climatique, mais elle crée de la confusion depuis longtemps. Le dictionnaire définit la confusion comme : « s'emmêler, ne pas trouver une issue ». C'est fortement formulé, mais c'est ce que je veux dire. Le monde calme et stable que nous avons connu durant les deux décennies qui ont suivi la seconde guerre mondiale, a disparu depuis longtemps. Bien que la stabilité fût déjà un concept très relatif à l'époque.Trump souverain.Donald Trump est un type de président différent. Trump est soi-disant républicain, mais en réalité, il ne l'est pas. Il ne défend pas l'économie de marché libre parce qu'il veut décider lui-même des taux d'intérêt et tient à orienter le commerce international. Il réduit les impôts pour les plus aisés mais ne semble pas se soucier du déficit budgétaire. Il n'est pas démocrate non plus, bien qu'il suive une politique qui conviendrait parfaitement aux démocrates : rouvrir les usines dans la Rust Belt et créer des emplois pour les classes moyennes. Les démocrates ont grossièrement négligé cet aspect. Ils l’ont payé très cher électoralement. Contrairement à ses prédécesseurs récents, Trump n'est ni républicain ni démocrate, il ressemble à un souverain européen du 19e siècle. Un souverain décide de manière autonome des droits d'importation et utilise ces droits pour punir ou récompenser des pays. Les considérations économiques jouent à peine un rôle dans cette affaire. Une taxe est imposée à un pays parce que le souverain en a décidé ainsi. Les célèbres checks and balances qui ont caractérisé le système politique américain sont contournés. Mais ils ne sont certainement pas encore complètement éliminés. Les prochaines décisions de la Cour Suprême fédérale seront cruciales à cet égard. La mesure dans laquelle la Réserve Fédérale reste indépendante sera également un baromètre pour le genre de présidence que souhaite Donald Trump. Un mot enfin sur les alliances internationales et le multilatéralisme. Nous avons grandi dans un monde où les blocs étaient clairs : unipolaire, bipolaire ou multipolaire. Cela changeait parfois, mais en général il était clair qui appartenait à quel bloc. Aujourd'hui, les amis sont presque devenus des ennemis et les ennemis sont traités comme des amis. Il est difficile pour les organisations internationales et pour les coopérations multilatérales de rester pertinentes.L'effritement de la mondialisation.La conséquence immédiate est que la mondialisation de l'économie mondiale s'effrite. C’est déjà arrivé. La mondialisation fluctue sur le long terme. Elle a atteint son apogée au début du 20e siècle et s'est effondrée pendant la première guerre mondiale. Tout a recommencé dans les années soixante. L'effritement de la mondialisation a des conséquences négatives pour la croissance de l'économie mondiale. Mais aussi pour l'inégalité économique entre les pays. Cette inégalité augmentera de nouveau. C'est souvent un sujet de discussion social. Néanmoins, de nombreuses études montrent que la mondialisation a rendu le monde moins inégal, principalement grâce à la croissance spectaculaire de la Chine et des économies asiatiques. Ce qui adviendra de l'inégalité ne sera pas une préoccupation majeure pour Trump. Mais cet effritement menace la position mondiale du dollar et le financement de la dette publique américaine. Les pays BRICS ne représentent pas encore une menace concrète pour l’instant, mais ces nations, et certainement la Chine, rêvent d'une monnaie mondiale concurrente et d'un propre système de paiement.L'impuissance de l'Union EuropéenneL'impuissance de l'Europe est devenue évidente en 2025. Les dirigeants européens étaient à peine impliqués dans les consultations sur l'Ukraine et l'Europe n'a même pas eu droit au chapitre concernant Gaza. Même lors de la conférence climatique, l'Europe a eu du mal. Il y a de nombreuses raisons à cela. L'essentiel est que l'Europe a perdu son pouvoir géopolitique parce qu'elle a perdu son véritable pouvoir économique. La croissance économique en Europe est bien trop faible depuis des années. L'Europe a également négligé et ignoré son industrie. La conséquence de cette négligence, c’est que l'Europe doit râcler les fonds de tiroir pour trouver des moyens de remplir un rôle crédible. L'Europe doit jouer un rôle en Ukraine, mais elle ne peut pas trouver ni libérer les moyens d'imposer sa volonté. Si l'Europe veut trouver une place entre les États-Unis et la Chine, elle devra changer : plus combattive dans la prise de décision et moins préoccupée par des formalités de technocrates. L'Europe doit à nouveau inspirer. N'écrivez pas à quel point l'Europe est bonne, mais faites-le.L'avancée rapide de l'intelligence artificielleL'Europe tente de rattraper son retard dans le domaine de l'IA. Ne désespérez pas, l'Europe a certainement des atouts maîtres. Mais en Europe, on accorde plus d'attention aux dangers de l'IA qu'à ses opportunités. Il y a un an, Mario Draghi a incité l'Europe à changer de cap et à se concentrer sur la compétitivité. Draghi a récemment noté que peu de choses de son plan avaient été mises en œuvre. Cela dit, il ne faut pas se laisser subjuguer par le battage médiatique de l'IA. The Economist a récemment montré que les cours des actions américaines d'IA sont probablement exagérés et qu’ils pourraient entraîner une crise financière. Pensez à la fameuse crise Dotcom. Une crise financière peut entraîner une récession économique. Ce n'est pas bon pour les entreprises européennes qui souffrent déjà de la lente croissance et de la faible compétitivité européenne. Comme l'a dit Draghi, l'Europe doit se concentrer sur l'innovation technologique. Ceci est souvent interprété comme étant une transformation digitale. C'est une interprétation trop étroite. Il existe plusieurs domaines où l'Europe est forte et où les autres grands concurrents, comme les États-Unis ou la Chine, sont moins dominants. Je pense à quelques spécialisations en chimie. L'Europe peut également jouer un rôle important dans la technologie du traitement médical.Le rôle de la ChineIl fut un temps où la Chine était traitée avec un regard compatissant : une économie qui copie nos innovations. Il y a quarante ans, on disait la même chose du Japon. Les États-Unis et l'Europe étaient les pays innovants. Le Japon puis la Chine ont copié. Depuis lors, les temps ont changé. Nous ne devons pas commettre la même erreur aujourd'hui. Économiquement, l'Europe souffre beaucoup de la Chine. La Chine a développé une grande capacité de production très moderne. L'infrastructure chinoise est souvent excellente. Maintenant que le marché américain est moins accessible à cause des droits d'importation, les entreprises chinoises envahissent le marché européen. Par exemple, notre industrie chimique et notre industrie automobile ont subi de fortes pressions. C'est une compétition de prix mais aussi une compétition de produits. Leurs produits conviennent mieux à certains segments de marché que les nôtres. Les petites voitures électriques le prouvent. L'Europe ne doit pas commettre d'erreur stratégique et exclure la Chine. La Chine devient une puissance technologique, elle compte plus d'ingénieurs que n'importe quel autre pays, peut-être à l'exception de l'Inde. Une grande partie de la recherche scientifique aux États-Unis a été et est réalisée par des doctorants asiatiques. Cela signifie qu'une partie du pouvoir innovant des États-Unis provient des immigrés asiatiques et des Chinois. L'Europe ne peut pas gagner cette bataille technologique sans des partenariats avec la Chine.C'est clair ! L'économie mondiale a subi plusieurs chocs. J'en ai mentionné cinq, mais il y en a d'autres. Les chocs nous embrouillent. Nous ne savons pas vraiment comment gérer tout ça. On se retrouve piégés. C'est pourquoi nous devons tout faire pour encourager le leadership à tous les niveaux. Baron (Herman) Daems,23 novembre 2025
Rencontre avec Bénédicte van Zeeland, infirmière en milieu carcéral : soigner derrière les barreaux
À l'âge de 50 ans, j'ai choisi d'opérer une réorientation professionnelle mûrement réfléchie après avoir travaillé la majeure partie de ma carrière au sein d'un service d'urgences. J'ai souhaité mettre mes compétences au service d'une population différente, dans un environnement unique et spécifique. C'est ainsi que j'ai intégré l'établissement pénitentiaire de Leuze-en-Hainaut en tant qu'expert technique médical pénitentiaire.Philippe de Potesta : Comment vivez-vous le rythme d’une journée en prison ?Bénédicte van Zeeland : Le rythme de la prison est certes contraint par la sécurité, mais je l'aborde comme une opportunité d'exercer mon métier de soignante. Le quotidien peut être émotionnellement éprouvant et demande une vigilance constante. La satisfaction ressentie lorsque l'on parvient à établir une connexion, à soulager une douleur ou à soutenir un détenu dans sa prise en charge donne tout son sens à notre travail. L'objectif est de faire exister l'humanité du soin, même face aux comportements les plus ardus.Mes consultations sont des moments privilégiés qui me permettent d'établir un lien avec les détenus. Mais je ne me voile pas la face: certains détenus ne sont pas toujours "gentils" ou coopératifs: insultes et comportements agressifs font malheureusement partie du tableau. Ces réactions reflètent souvent une grande souffrance, une frustration face au système, un manque total de repères ou encore un manque d'éducation. Ma priorité reste le soin. Je maintiens mes limites claires, je rappelle le cadre, les règles de respect mutuel, tout en garantissant la confidentialité absolue.Philippe de Potesta : Comment établissez-vous la relation de soin et comment se déroule leur suivi médical ?Bénédicte van Zeeland : La relation de soin et le suivi médical des détenus sont guidés par le principe d'équivalence de soins (droit à avoir des soins équivalents à ceux prodigués à la société civile) et par le respect des droits du patient dont le secret professionnel.Elle repose sur plusieurs piliers essentiels :- Nous abordons les détenus sans jugement et avec empathie comme des individus à part entière, indépendamment des raisons de leur incarcération en veillant à la continuité des soins avant, pendant et après leur détention.- Nous garantissons la confidentialité des informations médicales, condition essentielle pour instaurer la confiance.- A leur arrivée, une évaluation initiale (incluant l'état médical, psychologique et le risque suicidaire, particulièrement élevé en début de détention) est réalisée. Un examen médical est effectué par un médecin et une infirmière dans les 24 heures de son arrivée. Il permet d'évaluer l’état de santé du détenu, d'identifier ses problèmes physiques et psychiques et d'assurer la poursuite des traitements en cours: ex: traitements de substitution pour les toxicomanes.Chaque établissement dispose d'une équipe de soins pluridisciplinaire: avec des médecins généralistes, infirmiers, psychiatre, psychologues, dentiste, kinésithérapeute. Les détenus ont le droit de demander à voir l'infirmerie tous les jours: nous y assurons les premiers soins: (plaies, fractures, prises de sang, électrocardiogrammes, douleurs dentaires, etc.) tandis que les consultations spécialisées sont organisées suivant un calendrier de rendez-vous.- Bien que je travaille dans un milieu sécurisé en étroite collaboration avec les surveillants, je tiens à maintenir mon identité professionnelle d'infirmière. Cette neutralité est perçue comme telle par les détenus et facilite le lien de confiance.Philippe de Potesta : La détention peut-elle être un levier de transformation personnelle ?Bénédicte van Zeeland : La transformation dépend avant tout de la volonté et de la résilience du détenu. Le système propose des outils: travail, formation professionnelle, activités culturelles et sportives et programmes thérapeutiques mais le cheminement est personnel. Les parcours de réinsertion les plus probants concernent généralement les détenus qui ont admis leur culpabilité et manifestent la volonté de réparer le préjudice aux victimes.Mais je constate aussi que la surpopulation carcérale, la violence et l'influence d'autres détenus peuvent saboter ces efforts et aggraver les situations. Les moyens humains et matériels alloués à la réinsertion restent insuffisants, ce qui limite nos actions.Philippe de Potesta : En quoi le travail d’infirmière en milieu carcéral diffère-t-il de celui en milieu hospitalier ?Bénédicte van Zeeland : Il se distingue surtout par le cadre sécuritaire contraignant, la globalité des soins et la spécificité de la population.Nous travaillons avec des règles strictes et dépendons des agents pour l'organisation concrète de notre travail: la sécurité prime et peut impacter l'organisation de nos soins.Nous traitons un large éventail de pathologies: problèmes de santé mentale, assuétudes, maladies infectieuses, soins chroniques et urgences avec des ressources plus limitées qu'à l'hôpital, ce qui exige une grande polyvalence. Nous assurons à la fois le suivi, le dépistage et la prévention.Un autre point à souligner aussi est leur demande de soins qui peut être manipulatrice: je dois souvent démêler ce qui relève d'une vraie demande de ce qui serait plutôt une tentative pour sortie de cellule ou un désir d'accéder à des médicaments détournés. Cela peut parfois être épuisant mais cela fait partie du notre travail.Philippe de Potesta : Un tout grand merci à Bénédicte van Zeeland pour cet échange et la qualité de ses réponses.Nous remercions également Philippe de Potesta
Enjoy Saint-Nicolas Light…
Au cœur de la nuit précédant le 6 décembre, une silhouette barbue, reconnaissable entre mille, se déplace de toit en toit. De vous à moi, il s’agit du grand saint Nicolas, accompagné de son âne. En Flandre, la tradition lui octroya un cheval blanc à l’instar de son confrère Saint Émilion…Figure majeure du christianisme, saint Nicolas trouve son origine en Nicolas de Myre, né au IIIᵉ siècle à Patara, en Asie Mineure. Devenu évêque, il se distingua par sa bonté et sa protection des enfants, des pauvres et des marins. Persécuté sous Dioclétien, il retrouva son ministère après l’édit de Constantin en 313. Mort le 6 décembre 343, ses reliques furent transférées à Bari en 1087, ce qui contribua à renforcer son culte. Célébré pour ses miracles et sa générosité, il devint le saint patron de nombreux métiers mais surtout le protecteur des enfants.Selon la légende, trois jeunes garçons, cherchant refuge chez un boucher, furent tués par ce dernier, homme d’une grande cruauté, qui les enferma dans un tonneau. Plus tard, saint Nicolas vint les ressusciter à dos d’âne. Soit, ce récit des « trois petits enfants partis glaner aux champs » s’est profondément enraciné dans la mémoire collective.La veille de sa fête, accompagné du Père Fouettard, le Grand Saint apporte friandises, pains d’épices et autres spéculoos aux enfants sages. Arrêtons-nous un instant au mot friandise. S’il évoque la douceur de l’enfance, la généreuse main tendue d’une grand-mère bienveillante ou l’odeur caractéristique d’un feu d’artifice buccal, il mériterait presque un mode d’emploi, afin que les enfants obéissants ne soient pas punis par la vilaine carie qui rôde par là.Le sucre… ces petits granulés, qui adoucissent les aliments mais moins les mœurs, agit sur nos émotions. Halloween n’est d’ailleurs pas bien loin quand on parle de saccharose : ce mot édulcoré cache un parfum de mystère, et rime étrangement avec nécrose, psychose ou cirrhose. De quoi rappeler que derrière le caractère mielleux du sucre se dissimule souvent un petit goût de frayeur !En effet, le dernier rapport, daté de novembre 2025, de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a de quoi faire froid dans le dos : « Dans les pays participants, 1 enfant sur 4 (25 %) âgé de 7 à 9 ans est en surpoids (y compris obèse) et 1 sur 10 (11 %) est obèse. Les garçons (13 %) sont plus susceptibles de souffrir d’obésité que les filles (9 %), avec une forte variation de la prévalence ». Le rapport ajoute que cette prévalence du surpoids et de l’obésité « favorise l’apparition du diabète, du cancer, des maladies cardiovasculaires et d’autres maladies non transmissibles potentiellement mortelles. Parallèlement, les parents d’enfants souffrant de surpoids ou d’obésité ont tendance à sous-estimer l’état pondéral de leurs enfants ».Mais alors, faut-il se cacher de ce saint qu’il nous faudrait voir ? Non pardi ! Les traditions font partie de notre royaume, et le 6 décembre aussi ! Et puisqu’il n’est pas question de renoncer à la fête, pourquoi ne pas la célébrer allégée ?Si vous ne savez pas à quel saint vous vouer, voici de quoi remplacer la gélatine de porc tout en gardant le côté fruité qui fait tant plaisir à nos gastronomes en construction : clémentines, mandarines, pommes, fruits secs ou, pour les plus courageux, des energy balls ou des barres de sain granola (composées d’un mélange de céréales, de graines, de fruits secs et de noix), ainsi que des cookies, biscuits ou gâteaux composés simplement de fruits ou de légumes, d’oléagineux et, si nécessaire, de quelques œufs…Il ne faut pas glisser des cakes aux courgettes dans les pantoufles de vos marmots pour autant, mais simplement leur rappeler que le mulet, tout comme le blanc canasson, se contente bien d’une maigre carotte…Nous remercions le comte Pierre-Alexandre de Lannoy pour la rédaction de cet article.
Ensemble, mettre fin au sans-abrisme.
Emilie Meessen, c’est l’énergie du cœur au service de ceux qu’on oublie trop souvent. Infirmière, co-fondatrice avec Sara Janssens de Bisthoven de l’ASBL Infirmiers de rue, nous avons pu la rencontrer.Votre démarche est profondément humaine et utile. Comment est née votre idée ?Infirmière de formation, j’ai toujours travaillé dans le social et en psychiatrie. J’ai ainsi eu l’opportunité de travailler et de créer des postes infirmiers dans différentes organisations pour les personnes sans-abri ou souffrant de problèmes de toxicomanie.En 2005, avec Sara, nous avons réalisé une étude de terrain à Bruxelles pour voir s’il y avait besoin de créer un nouveau lien vers les personnes sans-abri et leur permettre de reprendre confiance en elles et regagner l’envie de se soigner. C’est ainsi qu’après avoir rencontré une trentaine d’associations et services médicaux, Infirmiers de rue (IDR) a pu naître.L’idée a évolué au fur et à mesure des 20 ans. La méthodologie s’est affinée et professionnalisée. Notre vision s’est également élargie progressivement à la suite des réussites de terrain et de l’expérience avec les personnes sans abri.Chaque collègue et bénévole a ajouté sa pierre à l’édifice et a permis à l’association de grandir.Vous dites que les sans-abri doivent retrouver l’estime de soi, condition pour sortir de la rue. Comment vous y prenez-vous ?L’association a développé une méthodologie basée sur l’hygiène et la santé afin d’aider les plus vulnérables à reprendre confiance en eux et à trouver un logement stable et durable, moteur de bien-être.Nous avons trois équipes de terrain : Rue – Logement- MyWay.La 1e travaille sur l’hygiène et la revalorisation de la personne pour l’estime de soi, pour la motiver à reprendre soin d’elle et l’aider à susciter le changement.La 2e accompagne les personnes en logement avec la méthodologie « Housing First » pour leur réapprendre à se recréer de nouvelles habitudes et prendre soin d’elles.La 3e, l’équipe MyWay, aide la personne à se reprojeter dans le futur. Elle est déjà stabilisée dans son logement, il est possible alors de créer de nouvelles envies.Vous êtes aussi infirmière spécialisée en Santé communautaire. Pouvez-vous nous en dire plus ?Le soin est plus qu’un acte, c’est un accompagnement. Pour nous, l’hygiène est devenu un outil diagnostique et thérapeutique : c’est un langage du corps quand les mots ne viennent plus. La solution ne vient jamais d’un seul acteur mais de la coopération entre citoyens, soignants, institutions et services publics. Je suis convaincue qu’une action collective est indispensable à des résultats durables.Cela fait 20 ans maintenant que vous avez créé cette association majeure. Comment vous et votre équipe évoluez-vous à l’heure actuelle ?Chaque jour, sur le terrain, je vois des raisons d’espérer, des équipes qui se mobilisent, des citoyens qui tendent la main, des collaborations improbables qui sauvent des vies. Ces « bonnes nouvelles », partagées régulièrement au sein de l’association, deviennent des sources d’énergie et de persévérance.Cependant l’asbl Infirmiers de rue est régulièrement confrontée à des obstacles structurels, par exemple : la fragmentation des institutions (santé mentale/addiction/maladie chronique) qui complique la coordination et d’autre part la précarité des financements : le budget repose pour la moitié sur des subsides publics et pour moitié sur des dons privés. Or les premiers sont soumis aux choix politiques et au coupes budgétaires, tandis que les seconds dépendent de la communication autour de notre projet et de l’envie de chaque donateur de nous soutenir – cela crée un climat d’incertitude permanent. Et j’en profite donc pour remercier sincèrement l’ARNB de nous faire connaitre , ainsi que notre site internet (www.infirmiersderue.org) au travers cet article.Notre travail n’a de sens que si tout le monde s’y met et participe à sa façon!Le véritable enjeu, c’est d’accepter que la valeur d’une personne ne se mesure pas à sa productivité. Une société solidaire ne se demande pas si un individu est « rentable » mais comment il peut, à sa manière, contribuer et participer au vivre-ensemble.Redoutez-vous l’arrivée de l’hiver, au vu du manque criant de places d’hébergement ?Oui, car la vie à la rue abîme tout : les corps, les esprits, la dignité. Beaucoup de personnes finissent par perdre la sensibilité au froid, à la douleur ou même aux odeurs…ce qui est un mécanisme de survie.Guérir en rue est impossible. Le logement fait partie du traitement. Nous parlons d’un logement adapté et accessible, dont la personne paye le loyer.La fin du sans-abrisme est-elle possible ?Bien sûr – nous avons la chance d’habiter en Belgique où il y a énormément de moyens et de possibilités, il ne manque « plus que » la motivation politique !« Le courage est d’essayer » même si c’est plus compliqué que prévu !Puissent ces quelques paroles prononcées avec détermination, conviction et optimisme être entendues !Nous remercions la comtesse Emmanuel de Ribaucourt pour la réalisation de cette interview.
" Le retour du tragique ": comte Van Rompuy
La situation internationale actuelle est très différente de ce qu'elle était il y a quelques années. Voici quelques exemples sans vouloir être exhaustif.Le retour de la primauté de la politique. Regardez le Brexit, la guerre tarifaire, les guerres elles-mêmes, l'instrumentalisation de l'énergie et des matières premières à des fins non économiques. L'ordre multilatéral et l'UE étaient fondés sur la croyance en la liberté des marchés et la rationalité économique. Ils servaient la paix. Plus on était dépendant des autres, moins on aurait d'appétit pour faire la guerre, ce qui signifierait un appauvrissement direct. L'essor économique spectaculaire de la Chine n'aurait pas été possible sans son adhésion à l'OMC et donc l'ouverture des marchés. Les pays du Sud disent souvent que les institutions multilatérales classiques ont été mises en place par l'Occident pour leur propre bénéfice. L'exemple de la Chine démontre le contraire.La montée du nationalisme dans les pays anglo-saxons et dans les pays ex-communistes comme la Chine et la Russie déjoue la logique économique. Ces pays sont prêts à payer un prix en termes d'appauvrissement et de pauvreté pour rendre leur pays « grand ». Le nationalisme est en contradiction avec le multilatéralisme. L'UE a été fondée pour empêcher un retour du nationalisme qui avait ruiné l'Europe lors des deux guerres mondiales. La primauté de la politique est souvent la primauté de la sécurité et de la guerre. L'économie politique a donné à la politique économique un contenu différent. C'est bien plus qu'un jeu de mots.Le nationalisme fait également obstacle aux alliances. Dans le cadre d'une alliance, les pays se réunissent et renoncent volontairement à une partie de leur souveraineté. Un nationaliste se dresse contre cela. L'OTAN fonctionne beaucoup moins bien aujourd'hui jusqu’au jour où elle ne fonctionnera plus, depuis le retour du nationalisme. D’ailleurs, dans une alliance, on partage des valeurs et des intérêts. Mais si les valeurs diffèrent même sur les libertés, l'état de droit et la démocratie, alors la base même d'une alliance est sapée. Si même les intérêts sont également différents, dans ce cas c’est le commencement de la fin. On pourrait dire qu'un ennemi commun transcende ces différences, mais avons-nous toujours les mêmes ennemis au sein de l'OTAN ? La Russie est-elle l'ennemie à la fois des Américains et des Européens ?Ces exemples démontrent également que la politique intérieure détermine la politique étrangère. « America first » ou « to get back control » est d'abord et avant tout un slogan destiné à des fins électorales intérieures. À l'époque, Marc Eyskens appelait cela « de verbinnenlandsing van het buitenlands beleid » Cela se produit maintenant à grande échelle. Il y a quelque chose d'autre de spécial dans le nationalisme d'aujourd'hui. Il est nostalgique d'une époque où le pays concerné se portait mieux, d'une sorte d'âge d'or. Cette époque n'a jamais existé. C'était de l'or pour une élite. Une usine à rêves. Les gens qui sont peu sûrs d'eux, craintifs, en colère et agressifs sont ouverts à ces contes de fées parce qu'ils sont un moyen de combattre les dirigeants en place. « Rendez-nous nos rêves ». Bien sûr, cela n’a aucun sens de cette façon. Après tout, le temps d'hier ne revient pas parce qu'il n'a jamais existé.Le nationalisme extrême a un autre effet secondaire. Étant donné que les dirigeants de ce genre ne se soucient pas de l’état de droit au niveau international, cette valeur n'a pas non plus d'importance au niveau national ou vice versa. Seule la force brutale compte. Dégage ou je te fais un malheur. La démocratie est attaquée de l'intérieur, parallèlement aux actions étrangères d'états officiellement autoritaires. C'est le retour de la violence, le retour de la tragédie.Tout cela se fait avec le consentement, parfois même d'une majorité de la population. Ce qui est étrange, c'est que ceux qui utilisent et abusent de la liberté d'opinion sur les réseaux sociaux sont les mêmes qui seraient d'accord pour abolir cette liberté ! C'est le nième paradoxe. La seule explication est qu'ils veulent refuser cette liberté d'opinion à ceux qui ne partagent pas « leur » opinion ! Et ils ne se rendent même pas compte que tôt ou tard, on leur demandera aussi de garder le silence et d'obéir, surtout si les dirigeants ne peuvent pas honorer leurs promesses concernant l'Âge d'Or, ce qui sera bien sûr le cas.La question est de savoir pourquoi beaucoup de gens sont tellement en colère et frustrés. Nous ne vivons pas dans les années 30 du siècle dernier avec un chômage de masse et un appauvrissement. Ou pensent-ils vraiment qu'avec zéro migration ou zéro pollution, l'insatisfaction disparaîtra ? Peut-être cherchent-ils un nouveau bouc émissaire. Je n'ai pas non plus d'explication concluante.Mais un élément qui est généralement négligé est la perte de capital social et familial dans notre société. Beaucoup sont livrés à eux-mêmes. En raison de ce manque de connexions (liens), l'individualisation règne en maître. La révolution digitale a enfermé les gens encore plus dans leur petit monde. La santé mentale se détériore de façon dramatique. On peut le voir dans l'augmentation des addictions de toutes sortes (drogues, alcool, gaming, porno), des burn-outs et des dépressions, des pensées suicidaires et des suicides eux-mêmes. Les jeunes y sont plus en proie que leurs parents. La crise de la démocratie fait référence à la crise de la société.Heureusement, il y en a encore beaucoup qui résistent et veulent vivre une vie aussi normale et équilibrée que possible. Peut-être même s'agit-il d'une majorité silencieuse. Du moins, je l'espère. Nous remercions le comte Van Rompuy pour la rédaction de cet article.
Entretien du baron Johan Swinnen (JS) avec le chevalier Loïc De Cannière (LDC), auteur du livre « L'Afrique : un avenir rêvé »
JS : Dans le livre « Afrika : een gedroomde toekomst » (L'Afrique : un avenir rêvé), vous dressez un tableau assez optimiste de l'avenir du continent africain. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre ?LDC : Je suis allé en Afrique à de nombreuses reprises au cours des trente dernières années : d'abord pour la société d'ingénierie maritime DEME (qui fait partie du groupe Ackermans & van Haaren), puis en tant que PDG d'Incofin Investment Management (« Incofin IM »). Avec Incofin IM, une société d'investissement à impact, nous avons investi plus d'un demi-milliard d'euros dans 23 pays africains au cours des vingt dernières années, dans des institutions de microfinance, des entreprises agricoles et alimentaires et des petites entreprises productrices d'eau potable. Les investissements d'Incofin IM visent à fournir un rendement financier combiné à un impact social positif mesurable. L'objectif est d'intégrer au maximum les petits entrepreneurs et les agriculteurs dans le circuit économique et de leur offrir ainsi des perspectives d'avenir.Je suis fasciné par l'Afrique et j'ai voulu mettre mes expériences et mes analyses par écrit mais en utilisant un point de vue spécial. Ce qui m'a frappé, c'est que nos médias ont l'habitude de dresser un tableau très pessimiste de l'Afrique, où prédominent la guerre, la faim et la misère. Cette image est très unilatérale. J'ai souvent vu beaucoup de développements porteurs d'espoir en Afrique, qui sont à peine rapportés par les médias. D'où le titre de mon livre : L'Afrique, un avenir rêvé. D'ailleurs, en tant qu'économiste, je souhaitais évaluer l'évolution du continent africain d'ici à 2050. On a beaucoup parlé et écrit sur le passé de l'Afrique, mais peu sur son avenir. Je voulais avant tout faire une analyse de l'avenir de ce continent à la population très jeune.JS : Vous analysez donc l'avenir du continent africain en tant qu'économiste et investisseur. Quels sont les points clés de votre analyse ?PMA : Je pars de l'évolution démographique de l'Afrique subsaharienne. Sa population (1,1 milliard d'habitants aujourd'hui) doublera d'ici 2050 et triplera d'ici la fin du siècle. En conséquence, plus de 20 millions de jeunes entreront sur le marché du travail chaque année au cours des trois prochaines décennies. C'est un chiffre énorme. Il est essentiel que la croissance de l'emploi suive le rythme de la croissance démographique et que l'Afrique réussisse ainsi à créer 20 millions d'emplois supplémentaires par an. Sinon, le chômage, la pauvreté et les troubles menacent. Il ne fait aucun doute que l'augmentation du chômage augmentera la pression migratoire, y compris vers l'Europe. Dans ce livre, j'examine si et comment l'Afrique peut faire face à cette nécessaire création massive d'emplois. JS : Votre analyse de l'avenir de l'Afrique n'est pas vraiment optimiste, objectivement parlant. Qu'est-ce qui justifie votre optimisme ?PMA : L'Afrique est en effet confrontée à d'énormes défis. Mais je vois deux raisons d'être optimiste.Tout d'abord, les Africains excellent par leur créativité et leur esprit d'entreprise. Le professeur Clayton Christensen de la Harvard Business School a décrit dans son livre « The Prosperity Paradox » comment les Africains ont la capacité particulière de faire croître et prospérer les entreprises dans un environnement à faible pouvoir d'achat, dans lequel les entreprises occidentales ne sont pas disposées à opérer. Je constate que l'Afrique compte de plus en plus de « licornes » à succès, des entreprises qui valent plus d'1 milliard de dollars. En outre, de grands conglomérats panafricains émergent dans le secteur alimentaire et dans le secteur bancaire. Ce n'était guère le cas il y a dix ans. Et bien sûr, il y a les millions de micro-entrepreneurs dynamiques, dont j'en ai vu et parlé à des centaines.Deuxièmement, l'évolution démographique en Afrique a aussi un côté très positif. Les Africains ont en moyenne 19 ans. Dans l'Union européenne, l'âge moyen est de 44 ans. L'écart d'âge entre l'Afrique et l'Europe est donc de 25 ans. Une population jeune est un vivier de créativité et d'innovation. On le constate dans la croissance des secteurs créatifs (mode, musique, cinéma, arts plastiques) et dans le secteur technologique (fintech, agritech). Une population jeune, qui a un accès facile aux médias sociaux, fait pression sur les régimes autoritaires et les oblige à plus de transparence, à des réformes démocratiques et au respect des droits de l'homme. C'est une bonne chose pour l'Afrique.JS : Quel rôle voyez-vous pour l'Europe, qui partage une longue histoire pas toujours irréprochable avec l'Afrique ? PMA : Il est temps de tourner la page du passé et d'œuvrer à un partenariat d'égal à égal entre l'Europe et l'Afrique, le « continent jumeau » comme l’appelait l'ancien président de la Commission Européenne, Jean-Claude Juncker. Dans un monde où les tensions géopolitiques s'intensifient, l'Europe et l'Afrique doivent former un tandem qui sert les intérêts des deux parties, par exemple dans les domaines de l'énergie, du climat, des matières premières, de la technologie et de la mobilité de la main-d'œuvre. En poursuivant explicitement l'intérêt mutuel, l'Europe se distinguera positivement de la manière dont d'autres puissances étrangères, telles que la Chine et la Russie, agissent en Afrique. L'Union Européenne a fait des pas dans la bonne direction. Les Africains aiment travailler avec l'Europe, mais l'Europe doit faire preuve de plus de volonté de dialogue et de combativité. Sur ce dernier point, l'Europe a beaucoup à apprendre de la Chine. Je reçois ce message de nombreux interlocuteurs africains.
Publireportage : Rencontre avec Ghislaine Holvoet, gemmologue et organisatrice du salon BELFAIR ( 21,22 et 23 novembre 2025)
Chère Ghislaine, la gemmologie est votre passion, et avec “Mère & Fille” vous en avez fait une aventure à deux voix : qu’apporte ce duo unique à votre regard sur les pierres et sur la création ?“Mère et Fille” reflète une complicité familiale et une passion transmise. Nous avons voulu créer une approche humaine, où chaque pièce, chaque sélection de gemmes, est pensée pour le client afin de susciter une émotion. C’est une aventure à deux, où tradition et modernité se rencontrent.BELFAIR en est déjà à sa troisième édition. Qu’est-ce qui rend ce salon unique par rapport à d’autres événements consacrés au luxe ? BELFAIR offre une parenthèse rare : pendant trois jours, une sélection d’une douzaine de Maisons de haut savoir-faire, souvent sans boutique, réunies trois jours seulement dans les salons privés de l’avenue Franklin Roosevelt. Intimiste, ultra-sélectif et 100 % créateurs : le luxe à découvrir à la source. Pourquoi avoir choisi à nouveau les ‘Salons du 25’ comme lieu d’accueil de cette nouvelle édition ? La maison de l’ANRB, lieu chargé d’histoire, offre un écrin idéal : chaleureux, d’une grande élégance, avec parking aisé et sécurité totale. Loin du stress des rues commerçantes, elle permet une visite sereine, en parfaite résonance avec nos valeurs. Quels sont vos souhaits pour cette 3ᵉ édition ?Mon envie ? Que chacun trouve sa pièce idéale, et qu’il reparte avec un coup de cœur, ou que le visiteur garde un beau souvenir. Les hommes ne sont-ils pas oubliés chez ‘Mère et Fille’ ?Bien sûr que non ! Ni les hommes, ni les jeunes fiancés ! Nous vous encourageons à venir découvrir notre collection de boutons de manchettes. Cette troisième édition conservera-t-elle sa dimension solidaire ?Depuis notre fondation en 2014, nous avons soutenu de nombreuses œuvres. Cette année encore, nous offrons un stand à l’œuvre Oxybulle afin qu’elle puisse présenter ses produits et jouir d’une belle visibilité.
Royal Condroz Culturel asbl 50 ans d’une aventure culturelle, humaine et solidaire
Déjà bien occupée par ses fonctions de bourgmestre de Barvaux-Condroz, ma mère, la comtesse Ferdy d’Aspremont Lynden – femme dynamique et entreprenante – fonde en septembre 1974, le Condroz Culturel asbl.Cet esprit d’entreprise et enthousiaste, le tenait-elle de sa mère, issue d’une lignée d’industriels américains ?Selon ses statuts, l’association a pour mission la promotion et la valorisation de toute forme artistique, ainsi que le soutien financier à des œuvres caritatives, philanthropiques et à des associations culturelles poursuivant des objectifs similaires. Pour ce faire, elle organise des activités variées telles que visites de musées, excursions, voyages … L’idée était – et reste – qu’on peut faire du beau en faisant du bien !Durant les années septante, l’association proposait des pièces de théâtre dans les propriétés privées de la région. Du haut de mes 10 ans, j’accompagnais souvent ma mère et garde un souvenir émerveillé de ces soirées de spectacles où les comédiens jouaient, entre autres, dans la cour du château d’Annevoie, Barvaux ou Ry ! De même, je participais à la préparation des 400 enveloppes contenant la lettre mensuelle de 5 pages, un travail méticuleux facilité aujourd’hui par le courrier électronique.Derrière cette belle initiative, une petite équipe aussi discrète qu’efficace : ma mère, bien sûr, mais aussi ses cousines, la baronne Philippe van Zuylen et la comtesse Didier d’Aspremont Lynden. Ensemble, elles ont façonné l’âme de l’association.Début des années 80, Josyne van Zuylen, globe-trotter à l’esprit curieux, a donné un nouvel élan aux activités de l’asbl. Sous son impulsion, des voyages culturels, proches ou lointains, se sont multipliés, dans une ambiance conviviale et bienveillante. Depuis 2007, j’ai repris le flambeau, entourée de Marguerite De Cannière, de ma belle-sœur, Béatrice de Spirlet et toujours soutenu par mon cher époux.Philippe de Potesta : Quels sont les moteurs de l’engagement bénévole au sein de votre équipe ? Caroline d’Aspremont : Il s’agit de poursuivre cette belle aventure culturelle et sociale, toujours portée par cette atmosphère conviviale et bienveillante qui en fait sa richesse ! Cette démarche a récemment été couronnée par une reconnaissance qui nous touche profondément : la décision de Sa Majesté le Roi d’accorder à notre association le titre honorifique de « Royal ». Désormais, nous portons le nom de Royal Condroz Culturel asbl, une distinction symbolique, qui vient saluer cinq décennies d’engagement en faveur de la culture et la philanthropie. Ce titre ne constitue pas seulement une reconnaissance du chemin parcouru, mais aussi un encouragement à poursuivre la mission fondatrice de l’association.Ph de P : Quelles ont été les dernières activités marquantes du Condroz Culturel ?C d’A : Il est difficile de résumer 50 années de nombreuses activités riches et variées … En 2023, une magnifique croisière en Croatie, à bord d’un bateau entièrement privatisé pour l’association, a marqué les esprits.Octobre de la même année, un séjour culturel à Rome nous a emmenés sur les traces de Raphael. Le printemps 2024 a été l’occasion d’une semaine passionnante au Caire et ses environs, entre histoire millénaire et monde moderne. Février 2025, l’Asie avec une croisière inoubliable sur le Mékong. Et tout au long de ces mois, de nombreuses expositions ont enrichi notre programme, de la Georgie à Aleschinsky, Louise-Marie d’Orléans, première reine des Belges, en passant par bien d’autres escales artistiques.A l’occasion des 50 ans du Condroz Culturel, une pièce de théâtre, « Crusoé repart », amusante, fraîche et originale a été jouée à la Comédie Royale Claude Volter. La soirée s’est poursuivie par une réception chaleureuse, soigneusement orchestrée par Cap Event asbl.Ph de P : Quels sont les projets qui vous enthousiasment pour le futur ?C d’A : Comme d’habitude, plusieurs expositions viendront ponctuer la saison automnale. Fin novembre, une escapade en Rhénanie-Westphalie nous plongera dans la magie de l’Avent, entre châteaux, visite d’Aix-la-Chapelle et marché de Noël au Schloss Merode. Au printemps 2026, cap sur l’Egypte pour un voyage de Louxor à Assouan prolongé par une croisière sur le lac Nasser. Et à l’automne 2026 se profile déjà un voyage à la découverte de la Roumanie.Ph de P : En conclusion, quels sont les souhaits pour l’avenir de votre association ?C d’A : Ce que nous souhaitons aujourd’hui et demain, c’est rester fidèle à l’esprit insufflé par les fondatrices : l’enthousiasme face à l’inattendu, la joie de découvrir ensemble, la souplesse face à l’imprévu. Mais surtout une fidélité profonde de nos valeurs : la culture partagée, l’élégance de la pensée, le plaisir d’être ensemble tout en continuant d’avancer avec cœur !Ph de P : Merci infiniment à Caroline d’Aspremont pour ces précisions qui éclairent avec justesse les réalisations du Condroz Culturel.Philippe de Potesta
Bourse d’Etude Avancée de Solidaritas : Témoignage d’Antoinette de Crombrugghe de Picquendaele.
Antoinette de Crombrugghe a obtenu une bourse de Solidaritas pour l’aider à financer un master d’un an en Climatologie à la prestigieuse Columbia Climate School aux Etats-Unis. Nous lui avons demandé d’évoquer son parcours et son choix.Pourriez-vous résumer votre parcours ? Et nous dire ce qui vous a incité à partir aux Etats-Unis l’année dernière pour y étudier la climatologie à Columbia ?J’ai passé une partie de mon adolescence au Chili, aux côtés de mes parents engagés dans le bénévolat au sein des bidonvilles de Santiago. J’ai été témoin des effets du réchauffement climatique, qu’il s’agisse du recul des glaciers ou de vastes incendies, et j’ai constaté combien ces phénomènes sont profondément liés aux enjeux de justice sociale.Revenue en Belgique, après ma scolarité à Saint-André à Bruxelles, j’ai obtenu en 2023 un Bachelor of Arts in liberal Arts and Sciences à l’Université de Maastricht.Après un stage chez Telos Impact, entreprise spécialisée dans la gestion et le conseil en investissement pour un monde plus durable et résilient, j’ai réalisé mon projet : poursuivre mon parcours académique à Columbia pendant un an.Pourquoi ce projet vous tenait-il tant à cœur ?Comme je l’évoquais, durant mon enfance au Chili, j’ai été confrontée aux effets directs du changement climatique et de son impact sur les communautés vulnérables en particulier.Mon intérêt - je dirais même ma passion - pour les crises du climat et ses enjeux politiques, économiques et sociétaux s’est renforcé au gré de lectures et de discussions toujours plus approfondies.Le programme suivi à Columbia m’aura permis d’acquérir des compétences recherchées et reconnues, mais aussi de bénéficier d’un réseau de poids, pour influer sur la scène et les politiques européennes. Qu’avez-vous appris sur vous-même au cours de cette année à Columbia ?J’ai appris à ne pas compter mes heures ! Car la charge de travail était énorme ! Mais quand on aime, on ne compte pas … Et puis à Columbia l’esprit de communauté « étudiants/enseignants » est une réalité qui s’est d’ailleurs renforcée depuis la dernière élection présidentielle.Quels conseils ou message avez-vous envie de donner aux jeunes de l’ANRB qui rêvent de se perfectionner à l’étranger ?Sur le plan pratique, une bonne planification est fondamentale. Il faut s’y prendre bien à l’avance, bien à temps pour préparer son parcours académique, son projet d’études.Plus votre CV sera cohérent, plus vous aurez des chances d’être accepté par l’institution que vous aurez sollicitée.Sur le plan financier, cela implique la préparation d’un budget : compte tenu du coût élevé des études de haut niveau à l’étranger, il est essentiel d’élaborer un plan financier bien détaillé et structuré.A cet égard, des bourses d’études des institutions hôtes, des pays hôtes et de fondations belges ou mixtes sont généralement disponibles. Une recherche bien complète des possibilités et des conditions d’éligibilité est indispensable. En Belgique, je pense par exemple à la Fondation Roi Baudouin, le fonds Sofina Boël, ou pour ce qui concerne les études aux Etats-Unis, la Belgian American Educational Foundation (BAEF) ou la Fulbright Commission.Mais l’essentiel, finalement, n’est-il pas d’oser poursuivre sa passion ?Nous remercions le baron Henry d'Anethan pour la rédaction de cet article.Solidaritas : Octroi de bourses pour des études avancées à l’étranger ou dans des institutions internationales en Belgique.Votre enfant a obtenu un premier diplôme et veut poursuivre ses études en Belgique ou à l’étranger ? Se spécialiser ? Obtenir un post-master ?Un doctorat ? Des difficultés à financer le projet ?Solidaritas peut accorder une bourse d’études pour contribuer à financer la poursuite de ses études supérieures.En effet, Solidaritas peut octroyer à des jeunes de la noblesse des bourses pour des études à l’étranger ou dans des institutions internationales établies en Belgique.Les études visées sont les spécialisations à l’étranger après un premier diplôme : master après master, doctorat (de préférence à l’étranger), écoles d’art (musique ou autres), stages et tutorats, préparation de concours, etc.Le plan de financement, ainsi que la preuve de son admission par l’institution visée, devront figurer dans le dossier du demandeur.Le rôle de Solidaritas est supplétif : l’étudiant communiquera à Solidaritas le plan de financement établi avec toutes les aides et bourses déjà obtenues ou garanties (bourses publiques ou privées, aide familiale, moyens propres ou autres).Les demandes de renseignements et de bourses sont traitées confidentiellement. solidaritas@anrb-vakb.be
Un anniversaire d’envergure se prépare à Bruxelles : la cathédrale Saints- Michel-et-Gudule fêtera, en 2026, ses 800 ans d’existence ! Son doyen et sa Fabrique d’église s’activent.
Gaëtane Janssens de Bisthoven, présidente de la Fabrique, répond à nos questions.Contribuer à faire connaître ce magnifique édifice gothique est un objectif majeur. Pouvez-vous brièvement raconter son histoire ?Aux VIIIe et IXe siècles, il y avait déjà sur cette colline bruxelloise un oratoire consacré à l’archange St Michel. Au début du XIe siècle, le comte Lambert II de Louvain fit construire une église de style typiquement roman, consacrée elle-aussi à l’archange St Michel, le protecteur de la ville. Cette collégiale fut consacrée en 1047. Pour attirer les pèlerins, il fit transporter dans celle-ci les reliques de Sainte Gudule qui se trouvaient dans la chapelle de Saint Géry située dans la ville basse. Depuis lors, l’église fut officiellement dénommée la collégiale des Saints- Michel- et- Gudule.Ce n’est qu’en 1962 qu’elle fut érigée au rang de cathédrale aux côtés de la cathédrale Saint Rombaut de Malines.Sainte Gudule est une sainte très populaire à Bruxelles mais dont on ne sait pas grand-chose si ce n’est sa piété remarquable.Les forces vives de la cathédrale se sont réunies : quel est leur objectif ?A l’occasion du 800e anniversaire de la pose de la première pierre de l’édifice actuel, en 2026, le conseil de fabrique de la cathédrale des Saints-Michel-et-Gudule, à l’initiative de ce projet, a constitué un groupe de travail, dénommé GUDULA26. Le projet a pour objectif de faire mieux connaître la cathédrale, ses trésors artistiques et la diversité des activités qui s’y déploient aux Belges et aux touristes étrangers.Le programme explore diverses dimensions. Lesquelles ?Gudula26 commencera par une messe pontificale présidée par l’archevêque de Malines-Bruxelles, Monseigneur Terlinden.Au programme aussi : un spectacle de son et lumière, des expositions, des conférences, des concerts, des visites guidées, des pièces de théâtre, des installations artistiques, etc… Ces activités variées ont pour but de mettre en valeur la cathédrale, la spiritualité et l’art qui l’habitent, de faire découvrir ou redécouvrir son histoire passionnante, de faire vivre au public des expériences artistiques uniques.Sur quel laps de temps s’étalera ce projet Gudula26 ?Concrètement, le programme de Gudula26, proposant des activités distinctes et complémentaires, s’étend sur toute l’année 2026. Mais, dès la deuxième semaine de décembre 2025, le spectacle de son et lumière LUMINESCENCE sera proposé.Des activités sont prévues pour tous les publics. Pouvez-vous les décrire ?Alors, je lève pour vous dès à présent le voile sur quelques aspects de ce programme !Le dimanche 11 janvier 2026, à 11h, se tiendra une messe pontificale avec l’envoi par le Pape d’un légat le représentant. Le Roi et la Reine ont également confirmé leur présence. Cette messe sera très probablement diffusée sur KTO.Le spectacle de son et lumière LUMINESCENCE prendra place dans la cathédrale du 11 décembre 2025 au 21 mars 2026, 4 ou 5 soirs par semaine avec 2 ou 3 représentations par soirée. Chaque représentation pourra accueillir 700 personnes. Nous proposons aux spectateurs une expérience artistique et immersive exceptionnelle, permettant à chacun de découvrir la richesse artistique de ce lieu emblématique.La musique a toujours occupé une place prépondérante dans la vie spirituelle et culturelle de la cathédrale. Ses murs résonnent non seulement de prières mais également de musique, en tant que vecteur d’émotion et de langage spirituel, ce qui nous rapproche tous . Il était donc évident pour nous d’inclure dans notre programme des concerts variés et surtout de qualité. Ceux-ci auront lieu durant les week-ends qui suivent la Sainte-Gudule (le 8 janvier 2026) et la Saint-Michel (le 29 septembre 2026) ; nous avons prévu un riche programme musical très varié : du classique, du baroque, des trompes de chasse, des chœurs d’enfants, etc…Sur le plan historique et artistique, tout autant qu’éducatif, des experts viendront nous parler des joyaux que recèle notre belle cathédrale. Ces conférences, gratuites, en français et/ou néerlandais, permettront au public d’enrichir ses connaissances sur le patrimoine artistique de la cathédrale, mais également d’en mesurer son importance sociale et historique.De plus, le lundi 19 janvier 2026, le cardinal-archevêque de Luxembourg, Monseigneur Jean-Claude Hollerich, viendra présenter au Bozar ses réflexions sur : « La cathédrale dans l’Eglise et le monde de ce temps ».Deux pièces de théâtre auront également lieu dans le chœur de la cathédrale : le dimanche 8 février 2026 « Sœur Emmanuelle, le ciel au cœur des poubelles » et le mardi 21 avril 2026 : « Les 5 C : Cardinal, Cancer, Covid, Clown et Coulisses ».Sera également édité un fascicule de visite guidée, conçu spécialement pour le jeune public et remis gratuitement à chaque enfant visitant la cathédrale.Cerise sur le gâteau, une nouvelle BD, dessinée par Baudouin de Ville et retraçant l’histoire de la cathédrale sera aussi éditée.Voilà bien un éventail passionnant qui se déploie sous nos yeux et qui nous entraînera à pérégriner avec intérêt, plaisir et enthousiasme dans ce haut lieu de Bruxelles !Nous remercions la comtesse Emmanuel de Ribaucourt pour cette interview.
Willem van de Voorde, un diplomate courageux qui défend des intérêts à long terme dans un monde de plus en plus concurrentiel
Quel est votre parcours ?J'ai étudié le droit et la philosophie à l'UFSAL (Bruxelles), j'ai obtenu mon diplôme de droit à Louvain puis je suis parti à Londres (LSE) pour un Master of Laws. Mais je n'ai jamais travaillé comme avocat parce que je savais depuis des années que je voulais devenir diplomate. C'est ainsi que lors de mon service militaire en tant qu'officier de réserve à Cologne, j'ai préparé mon examen diplomatique.Après mon stage diplomatique, j'ai demandé à travailler pour mon premier poste dans notre ambassade auprès de l'UE à Bruxelles, car ma femme était encore en cours de spécialisation orthodontie. C'était une merveilleuse première introduction à la diplomatie ; je n'aurais jamais pu imaginer que j'y retournerai 30 ans plus tard. Puis je me suis retrouvé dans un monde complètement différent car j'ai été nommé secrétaire de la reine Paola pendant 6 ans, ce qui était également une expérience agréable et unique.En 2000, j'ai décroché mon premier poste à l'étranger, à Berlin. C'était une période incroyablement intéressante, car c'était la première année où la capitale allemande était transférée à Berlin. La ville était encore en construction et c'était un nouvel environnement pour tout le monde, pour les étrangers, mais aussi pour les Allemands qui venaient de Bonn et qui, comme nous, devaient s'y retrouver. Nous y sommes restés 4 ans. Ma femme, qui parlait allemand, pouvait aussi y travailler 2 jours par semaine, mais avec nos 4 jeunes enfants, elle avait les mains pleines.En 2004, je suis devenu chef de poste adjoint à Tokyo, un poste également intense et très satisfaisant.En 2008, je suis rentré à Bruxelles, au sein du département des affaires européennes, où, en tant qu'adjoint au directeur général, j'ai été très occupé à la préparation de notre présidence de l'UE en 2010. Par la suite, pendant un peu plus de 3 ans, j'ai rejoint les cabinets des ministres Steven Vanackere et Didier Reynders où j'ai coordonné leur politique européenne.En 2014, j'ai obtenu mon premier poste d'ambassadeur, à Vienne. C'était tout un défi, car c'est de cette ville que j'ai représenté notre pays en Autriche, mais aussi en Bosnie-Herzégovine, en Slovaquie, en Slovénie et auprès des institutions de l'ONU qui ont leur siège à Vienne. En 2018, j'ai déménagé à Berlin en tant qu'ambassadeur dans un pays vaste et très fascinant, que j'avais déjà appris à connaître. Au début de l'année 2020, un autre déménagement était imminent, celui du retour dans l'Union européenne, où je suis devenu le représentant permanent de la Belgique et y suis resté jusqu'en novembre de l'année dernière. Puis, comme le prévoit notre règlement d’ordre interne, le moment était venu de retourner à l'administration centrale à Bruxelles, où j'ai été nommé envoyé spécial pour le climat et l'environnement, afin de représenter la voix de la Belgique de manière horizontale dans les très nombreuses enceintes diplomatiques qui traitent du climat et de l'environnement.Quel est le rôle d'un diplomate dans un monde connecté ?Les fonctions diplomatiques sont très variées. D'une manière très générale, les diplomates gèrent et développent des relations avec d'autres pays. Nous sommes là pour promouvoir notre pays, notre gouvernement, nos entreprises, pour informer et pour aider si nécessaire nos compatriotes qui vivent ou voyagent à l'étranger.Dans le monde d'aujourd'hui, il est bien sûr devenu beaucoup plus facile qu'auparavant d'établir des contacts, mais le monde est aussi devenu plus grand et beaucoup plus compétitif. Dans de nombreux pays, la prospérité a énormément augmenté – heureusement ! - et leurs habitants revendiquent une place dans le commerce international et dans les organisations internationales. Alors que dans le passé, uniquement très peu de pays riches et occidentaux étaient aux commandes partout, il existe aujourd'hui une grande variété d'acteurs, dans tous les domaines : commerce, lutte contre la pollution de l'environnement et le réchauffement climatique, gestion de l'énergie, coopération internationale, éducation, extraction de matières premières, production alimentaire, biens de consommation, etc. : cela crée un environnement très concurrentiel, dans lequel les bons accords et la coopération étroite deviennent de plus en plus importants. Les choses tournent souvent mal, comme le montrent malheureusement divers conflits violents. Il faut donc beaucoup de personnel pour organiser une collaboration fluide et équitable, pour établir les bonnes règles et gérer cette gouvernance.Ces dernières années, des changements majeurs ont eu lieu, tels que l'accélération constante du réchauffement climatique, la transition vers des sources d'énergie plus durables, l'attention accrue portée à l'accès à l'énergie et aux matières premières ; tout cela se reflète sur la scène diplomatique et politique internationale, où les anciens rapports de force sont mis sous pression.Quelle est votre meilleure expérience professionnelle jusqu'à présent ? J'en ai eu beaucoup, mais je peux dire sans aucun doute que l'expérience la plus intense et la plus pertinente a été la présidence européenne en 2024. La Belgique était aux commandes de l'UE, à la fin de la législature où il y a toujours beaucoup de législation en attente d'approbation, avec les élections européennes qui ont dû être organisées, la guerre en cours en Ukraine, la crise énergétique. Toute l'équipe de la Représentation Permanente, ainsi que de nombreux autres membres de notre administration publique, ont fait un effort formidable à l'époque, et avec des résultats positifs. J'ai le sentiment que la Belgique a su apporter une vraie valeur ajoutée à la construction européenne.Comment êtes-vous devenu envoyé spécial pour le climat et l'environnement ?Dans le cadre de la rotation régulière des diplomates, c'était à mon tour de retourner à l'Administration centrale, rue des Carmélites, près du Sablon. J'ai eu l'opportunité de choisir ce poste et j'ai pensé qu'il s'agissait d'une problématique très actuelle et pertinente, qui implique également de nombreux processus internationaux de négociation et des dimensions diplomatiques. Le thème est également interpellant, car il réunit deux phénomènes contradictoires. Les effets du réchauffement climatique qui s'accélère, sont aujourd'hui clairs pour tout le monde et ont été scientifiquement prouvés. La Belgique compte de nombreux climatologues réputés, et l'un d'entre eux, le professeur Jean-Pascal van Ypersele, était vice-président de l’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) de l'ONU. Mais en même temps, il y a, dans notre société, beaucoup de résistance à atténuer les effets ou à éliminer les raisons du réchauffement climatique – essentiellement la combustion de combustibles fossiles. Et c'est parce que cela nécessite un changement de comportement. Les coûts des investissements nécessaires pour la société dans son ensemble, pour les entreprises, pour les individus sont énormes et doivent être supportés maintenant, mais les effets ne viendront que plus tard. Le monde occidental a également une responsabilité historique vis-à-vis des pays les plus pauvres, mais ceux-ci devront également accepter que leur propre industrialisation, qui a succédé à la nôtre, devra se faire sur une base plus durable. Une période de transition est toujours difficile. Il est important de garder le cap et de communiquer clairement et régulièrement à ce sujet afin que notre action politique reçoive un soutien suffisant. J'essaie donc d'y contribuer.Le fait d'être membre de la noblesse est-il un avantage ou non ?En Belgique ou dans les cercles de l'UE, cela joue un rôle moindre. Certains le regardent même avec un certain scepticisme ou un œil critique. Mais à l'étranger, par exemple lors de mes séjours en Autriche, au Japon ou en Allemagne, j'ai souvent eu l'impression que cela était perçu comme quelque chose de positif, car cela montre une expression de la tradition et de l'excellence dans notre pays qui est appréciée dans l'environnement diplomatique et qui ouvre souvent des portes.Quel message aimeriez-vous transmettre à nos membres, plus particulièrement aux jeunes ?J'ai 3 messages :1. Le monde est très complexe et connecté, mais la diplomatie reste très pertinente, car la coexistence pacifique sur terre nécessite l'élaboration de règles. La lutte pour la paix au Moyen-Orient ou en Ukraine, l'organisation de la gestion conjointe des océans ou la conclusion d'accords pour lutter contre la pollution plastique n'en sont que quelques exemples récents. La Belgique a beaucoup d'expérience utile et d'expertise à offrir dans bon nombre de ces types de négociations et doit donc investir davantage d'attention et de ressources pour rester pleinement impliquée dans ce paysage hautement concurrentiel.2. La lutte contre le changement climatique et le réchauffement de la planète, la réduction de la pollution et la protection de la biodiversité doivent rester en tête de nos priorités. Selon l'ONU, il s'agit - à juste titre - d'un problème existentiel que nous ne pouvons aborder qu'ensemble. Cela nous aidera à long terme.3. Nous avons besoin de courage et de persévérance pour rendre notre monde meilleur. De temps en temps, je pense à une belle phrase que l'on attribue souvent à Guillaume d'Orange : « point n'est besoin d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer ».Propos recueillis par Catherine de Dorlodot
La journée de la Transmission 5/10/2025
ATTENTION: Clôture des inscriptions le 3 octobre à 9 hr. Inscrivez-vous vite!!! Dans un monde en constante évolution, où les repères traditionnels se brouillent parfois, la transmission familiale demeure un pilier fondamental de la stabilité, de la continuité et de l'identité. C’est à cette richesse silencieuse que s’intéresse La journée de la Transmission, fruit d’une collaboration entre l’Association de la Noblesse du Royaume de Belgique (ANRB) et la Fédération Royale des Associations de Familles (FRAF). Au cœur de ce rendez-vous, quatre grandes thématiques émergent pour explorer les multiples visages de ce qui se transmet dans les familles, d’hier à demain.1. Les valeurs : un héritage immatériel et vivantAvant même les biens matériels, ce sont souvent les valeurs qui constituent le socle de l’héritage familial. Éducation, sens du devoir, responsabilité, ouverture aux autres, transmission de la foi ou d’engagements citoyens ; ces principes se forgent dans l’intimité du foyer et se perpétuent au fil des générations.Il ne s’agit pas uniquement de préserver des traditions, mais bien de cultiver une identité familiale partagée. Les récits de vie, les rituels transmis, les règles implicites qui régissent les relations... tous ces éléments façonnent la manière dont chaque membre s’inscrit dans une lignée, en dialogue permanent avec ses aïeux et ses descendants.2. Archives et mémoire : garder trace pour mieux transmettreLes familles qui prennent soin de leurs archives nourrissent leur mémoire et affirment leur présence dans le temps long. Correspondances anciennes, photographies usées, contrats de mariage, lettres patentes, enregistrements oraux ou encore films de famille constituent un trésor parfois insoupçonné.Aujourd’hui, de nombreux outils contemporains viennent enrichir cette mémoire : biographies familiales, podcasts familiaux, documentaires, livres-souvenirs... Ces initiatives permettent de sauvegarder l’histoire d’une famille ou de l’un de ses membres, et de les transmettre de façon vivante. Car se souvenir, ce n’est pas figer le passé : c’est offrir aux générations futures la possibilité de mieux comprendre d’où elles viennent pour mieux choisir où elles vont.3. Planification successorale et médiation : anticiper pour apaiserSi la transmission matérielle peut être source de liens, elle peut aussi, mal préparée, générer tensions ou conflits. C’est pourquoi la planification successorale prend une importance croissante. En s’entourant de professionnels compétents, les familles peuvent organiser le partage des biens mobiliers ou immobiliers, anticiper les enjeux fiscaux, mettre en place un mandat de protection extrajudiciaire, ou encore planifier la transmission d’une entreprise familiale.Au-delà des aspects juridiques, il est essentiel de laisser la place au dialogue familial, parfois facilité par des médiateurs. Une transmission réussie est celle qui a été préparée, réfléchie, et surtout discutée : elle prend en compte les souhaits du donateur, mais aussi les réalités et attentes des héritiers.4. Patrimoines culturels et matériels : conserver et faire vivreLes demeures historiques, les terres familiales, les portraits anciens, les objets d’art, les bibliothèques ou même certain type d’entreprises constituent autant de patrimoines tangibles, témoins d’une histoire singulière. Leur conservation et leur transmission exigent une vigilance constante : entre restaurations nécessaires, coûts d’entretien et adaptations aux normes actuelles, les défis sont nombreux.Ces biens racontent pourtant bien plus qu’une potentielle valeur marchande. Ils incarnent une mémoire vivante, un lien entre générations et une responsabilité collective. Préserver un tableau de famille ou gérer un domaine agricole transmis depuis des siècles, c’est perpétuer un dialogue entre passé et avenir, tout simplement.Un rendez-vous pour penser la transmission dans toutes ses dimensionsLa journée de la Transmission, qui se déroulera dans les salons de l’ANRB le 5 octobre prochain, souhaite offrir un espace de rencontre, de réflexion et de solutions concrètes. Il rassemblera experts, juristes, notaires, médiateurs, historiens des familles, archivistes, artisans de la mémoire, antiquaires, psychogénéalogistes, passionnés de patrimoine et représentants de nos associations « sœurs » (Association des Demeures Historiques et Jardins, OGHB, etc.), tous unis par une même ambition : aider les familles à préserver ce qui compte, transmettre ce qui dure.Dans un monde parfois trop pressé, où tout semble devoir être réinventé sans cesse, prendre le temps de réfléchir à la transmission familiale, c’est faire œuvre de sagesse. C’est reconnaître que certaines richesses ne s’évaluent pas en euros ou en mètres carrés, mais en souvenirs, en valeurs, en liens.Un catalogue rassemblant un maximum de coordonnées d’experts, d’amateurs chevronnés et d’autres professionnels sera conçu afin de constituer une véritable « bible » des intervenants de la transmission.Consulter le programme : https://bit.ly/programme-transmissionS'inscrire : https://membernet.anrb-vakb.be/fr/tous-evenements/journee-transmission/Nous remercions le comte Pierre-Alexandre de Lannoy pour la rédaction de cet article.
Le Cinéma Belge
Notre compatriote Joseph Plateau, professeur en physique expérimentale à l'Université de Gand, a développé dès 1836 un dispositif stroboscopique, le phénakistiscope, apportant ainsi une contribution essentielle à l'invention du cinématographe par les frères Lumière en 1895, et donc à la naissance de l'industrie cinématographique. Le 1er mars 1896, la première projection d’un film en Belgique a eu lieu dans une salle des Galeries Royales Saint-Hubert à Bruxelles.Durant la première moitié du siècle dernier, le cinéma en Belgique est resté un terrain d'expérimentation pour les pionniers. Avec l'aide de l'industriel français Charles Pathé, Alfred Machin a fondé en 1910 un premier studio de cinéma. Hypolyte De Kempeneer devient le premier producteur de films et travaille notamment avec la première réalisatrice et actrice Aimée Navarra. Son film Coeurs Belges s'inscrit dans une série de mélodrames patriotiques qui dominent la modeste industrie cinématographique belge après la Première Guerre mondiale. Un autre pionnier, le comte Robert de Wavrin de Villers-au-Tertre, ethnologue et explorateur, a vécu plusieurs années parmi les Indiens d'Amérique du Sud et a capturé des témoignages de diverses cultures sur pellicule. Ses films les plus connus sont Au Centre de l’Amérique du Sud inconnue (1924) et Au Pays du Scalp (1931).Dans les années 30, Charles Dekeukeleire, Henri Storck et Joris Ivens ont expérimenté de nouvelles techniques cinématographiques et fondé l'École belge du documentaire. Misère au Borinage de Storck et Ivens est considéré comme une œuvre marquante. De Witte (1934), adapté du roman d'Ernest Claes, devient le premier long-métrage de fiction populaire. Le réalisateur Jan Vanderheyden réalise ensuite avec Edith Kiel une série de comédies populaires avec des acteurs comme Gaston Berghmans, Jef Cassiers et Nand Buyl.De l’après-guerre aux années 80, le drame paysan devient un genre clé du cinéma belge. Parallèlement, certains cinéastes posent leur empreinte personnelle sur le cinéma belge et déclenchent ainsi une première vague de reconnaissance internationale : Roland Verhavert (Meeuwen sterven in de haven,…), André Delvaux (De man die zijn haar kort liet knippen, L’oeuvre au noir,…), Harry Kümel (Malpertuis,…) et Jacques Boigelot (Paix sur les champs). Leurs films deviennent plus contemporains, souvent empreints de réalisme magique, une tendance qui persiste. La création des premières écoles de cinéma au début des années 60 forme une nouvelle génération de réalisateurs. Des talents comme Chantal Akerman ou Raoul Servais (Palme d’or à Cannes avec Harpya) cherchent leur propre voie dans le film expérimental et d’animation. Robbe De Hert, Guido Henderickx et Patrick Lebon construisent à Anvers le Fugitive Cinema progressif, tandis que Marion Hänsel, Jean-Jacques Andrien et Michel Khleifi façonnent un cinéma universel.Dans les années 80 apparaît une manière plus personnelle et réaliste de faire du cinéma. Notre cinéma devient petit à petit mature et plus divers. Les producteurs Pierre Drouot, Erwin Provoost et Dominique Jeanne apportent une structure financière et économique dans le secteur et misent sur la promotion. Le public découvre tant le cinéma d’auteur que les films populaires : Brussels by Night de Marc Didden, Crazy Love de Dominique Deruddere, Toto le Héros et Le Huitième Jour de Jaco Van Dormael, Le Maître de Musique et Farinelli de Gérard Corbiau, C’est arrivé près de chez vous de Benoît Poelvoorde, Rémy Belvaux et André Bonzel ou encore Hector, Koko Flanel et Daens de Stijn Coninx. En 1987, Nicole Van Goethem remporte le premier Oscar belge du meilleur court-métrage d’animation avec Een Griekse Tragedie. Puis Le Maître de Musique et Daens sont nommés à l’Oscar du meilleur film en langue étrangère. Et avec Rosetta, Luc et Jean-Pierre Dardenne gagnent leur première Palme d’Or au festival de Cannes. Après 100 ans, les choses s’accélèrent enfin pour l’industrie cinématographique belge.Les frères Dardenne restent toujours nos porte-drapeaux, avec de nombreux talents dans leur sillage. Trop nombreux pour être tous cités, ils comptent d’excellents acteurs, actrices, producteurs, compositeurs, chefs créatifs et artistiques, ainsi que des maîtres dans la photographie, le montage et le maquillage qui font la richesse de notre pays.Aujourd’hui, le cinéma belge est devenu un produit d’exportation, au même titre que nos pralines, notre bière et notre chocolat. En décembre 2022, le magazine britannique Sight & Sound a désigné Jeanne Dielman, 23, quai du Commerce, 1080 Bruxelles (1975) de Chantal Akerman comme le meilleur film de tous les temps. Bien que le cinéma belge ne rencontre pas encore une grande popularité ou un succès financier régulier à l’international, le circuit festivalier international reste toujours à l’affût de nouvelles œuvres belges. Lukas Dhont (Close, Girl), Baloji (Augure) et Felix Van Groeningen (The Broken Circle Breakdown, De acht Bergen) suscitent de grandes attentes. Les récompenses pleuvent et les nominations aux Oscars ne sont plus une exception.Les frères Dardenne ont récemment reçu plusieurs prix à Cannes pour Jeunes Mères. De plus, le documentaire Soundtrack to a Coup d’État de Johan Grimonprez a été nommé aux Oscars 2025 dans la catégorie du meilleur documentaire et la coproduction belge Flow a remporté cette année le Golden Globe et l’Oscar du meilleur film d’animation.Faire un film coûte cher. En Europe, le cinéma est considéré comme un produit culturel et artistique, subventionné par les pouvoirs publics, contrairement aux États-Unis où l’industrie cinématographique repose sur un modèle économique basé sur le divertissement. En Belgique, chaque Communauté a mis en place des fonds pour soutenir les productions locales, mais les budgets sont et restent trop limités. En complément, le gouvernement a instauré le système de Tax Shelter, une mesure fiscale favorisant l’investissement privé.Si le groupe Kinepolis est mondialement connu, l’arrivée des plateformes de streaming a profondément changé l’expérience cinématographique. Les grands joueurs décident de plus en plus ce qui se produit ou pas : tout doit être plus rapide ou moins cher et nos chaînes nationales peinent à suivre cette évolution.Le cinéma est un art, une alchimie entre histoire, mise en scène, jeu d’acteur, photographie, mouvement, décors, costumes, musique, son et montage pour transformer l’ensemble en une expérience immersive et captivante sur un grand écran blanc. C’est une magie, un miroir, une réflexion d’émotions et de désirs. Le film donne conscience, rend curieux et connecte les gens et les cultures. C’est ce dont le monde a un besoin urgent et croissant.Nous avons beaucoup de jeunes talents et la dernière décennie, de nombreux jeunes réalisateurs et quelques acteurs belges ont trouvé leur voie à l’étranger. Pour que nous puissions continuer à raconter nos propres histoires, préserver notre culture d’ouverture d’esprit, d’imagination et de liberté créative, et ne pas perdre nos talents émergents, il est essentiel de développer de nouvelles formes de financement.Baron Stijn Coninx, réalisateur et scénariste (Daens, Hector, Koko Flanel, When the Light Comes, Sœur Sourire, Marina, Niet Schieten…), a été professeur à l'INSAS et au RITCS pendant 28 ans et est actuellement vice-président de la Cinémathèque Royale de Belgique.
La Psychogénéalogie : un héritage que l’on ne peut refuser…
Développée dès les années 1970, la Psychogénéalogie s’intéresse aux transmissions émotionnelles et comportementales au sein des familles.L’un des concepts majeurs de cette discipline repose sur l’idée que la charge émotionnelle d’événements marquants vécus par nos ancêtres (deuils non faits, secrets de famille, faillites, drames ou injonctions tacites façonnant la psyché) peut se transmettre d’une génération à l’autre et conditionner nos vies, favorisant l’émergence de comportements répétitifs, d’angoisses inexpliquées ou de symptômes psychosomatiques.La psychothérapeute Anne Ancelin-Schützenberger a permis en France la théorisation et l’essor de cette méthode thérapeutique et a inventé le génosociogramme. Celui-ci consiste en un schéma avec ses propres codes graphiques, associant généalogie familiale, liens affectifs et environnements historique, socioculturel et économique.Mais il est capital de noter que les avancées récentes dans les domaines de la biologie et des neurosciences ont ouvert des perspectives passionnantes pour la Psychogénéalogie.Tout d’abord l’épigénétique révèle que nos gènes peuvent évoluer en réponse à des événements extérieurs, notamment des traumatismes. Et les neurosciences nous apprennent que le cerveau a la capacité, grâce à sa neuroplasticité, de reprogrammer d’anciens schémas toxiques pour en bâtir de nouveaux, plus constructifs. En s’alliant, ces trois disciplines expliquent comment nos expériences de vie et celles de nos ancêtres influencent notre comportement et comment il est possible de s’en libérer.Selon la baronne Sandrina d'Anethan, psychogénéalogiste de terrain formée auprès d’Agnès Paoli (Mon Arbre Génial-logique) et de Bruno Clavier (le Jardin d’Idées), les difficultés existentielles ou factuelles rencontrées par celui qui consulte constituent le point de départ de la démarche. La représentation qu’il a de l’histoire familiale et le récit qu’il en fait permettent d’identifier les ressources vives de la lignée, mais aussi les stress et les solutions mises en place pour assurer la survie.Une attention particulière portée au choix des prénoms et des métiers, aux dates anniversaires, à la répétition de situations à des âges signifiants fait ressortir les interdépendances entre les individus d’un même système familial, susceptibles de les empêcher d’évoluer librement. Une fois reconnus les liens existants qui entravent, il est possible de s’en détacher avec bienveillance… et d’écrire la suite de l’histoire, une vie où passé et présent se réconcilient pour un avenir plus lumineux. Car si nous portons en nous les traces des blessures de nos ancêtres, nous portons aussi leur résilience et leur amour.L’adage dit que notre famille vit en nous. C’est pourquoi on veillera enfin à donner aux ancêtres, par le biais d’actes symboliques, les ressources qui les auraient aidés à dépasser les épreuves rencontrées. Pour qu’ils retrouvent leur juste place dans l’arbre généalogique. En agissant ainsi, on entraîne cette famille qui nous habite sur le chemin de la lumière et de la libération.La Psychogénéalogie est prisée dans le cadre du développement personnel, mais également pour traiter des blocages émotionnels et des troubles psychosomatiques. Précieux outil de compréhension des dynamiques familiales, elle s’inscrit avec succès dans une approche pluridisciplinaire.De nombreuses personnes témoignent d’un apaisement et d’une meilleure compréhension d’eux-mêmes : en prenant conscience des héritages psychiques de leurs lignées ascendantes, ils ont pu s’approprier les ressources de l’arbre tout en se libérant de poids qui ne leur appartenaient pas et ainsi renouer avec un chemin de vie plus épanouissant. C’est donc bien une œuvre d’émancipation et d’individuation dans le présent que propose l’analyse transgénérationnelle.Sophie du Fontbaré de Fumal, développeuse de talents chez Ozratu et passionnée par le sujet, estime que cette méthode peut être bénéfique pour surmonter des schémas répétitifs (échecs sentimentaux, troubles financiers récurrents, maladies inexpliquées), mieux comprendre son rapport aux autres et à soi-même, et ainsi accéder à une forme de résilience transgénérationnelle.Sandrina d’Anethan et Sophie du Fontbaré de Fumal seront présentes lors du « Salon des Transmissions » organisé par l’ANRB le 5 octobre 2025. Venez les écouter pour découvrir l’efficacité et les bienfaits de cette discipline.Nous remercions le comte Pierre-Alexandre de Lannoy pour la rédaction de cet article.
Jean Ferrat chantait : « La femme est l’avenir de l’homme ». Dans notre monde chahuté, quelle belle opportunité que de pouvoir interroger Anne-Claire de Liedekerke, Présidente de l’association Make Mothers Matter - MMM. Avec conviction, clarté et une détermination chaleureuse et de bon aloi, elle a accepté de répondre à nos questions.
Comment est né ce mouvement MMM ?Make Mothers Matter est une association sans affiliation politique ni confessionnelle, née en 1947 à l’UNESCO, dans un contexte d’après-guerre : pendant la guerre, quand les hommes et beaucoup de femmes sans enfants étaient au front, ce sont les mères qui s’occupaient de faire « tourner les choses » càd s’occuper des fermes, des commerces, des entreprises… en plus du foyer et de l’éducation des enfants. Elles avaient tout à gérer. C’est à la suite du congrès international « La mère, ouvrière du progrès humain » organisé à l’UNESCO, qu’est né le Mouvement Mondial des Mères devenu Make Mothers Matter – MMM.MMM défend les femmes qui sont mères et valorise leur rôle au sein de la famille et dans la société. MMM invite inlassablement à prendre conscience que les mères sont actrices de changement pour un monde meilleur et que leur action a un impact bien au-delà du cercle familial.« Quand les mères sont soutenues et reconnues » dites-vous, « elles sont actrices de changement », quel serait alors leur rôle ?Reconnaître le rôle des mères, c’est défendre le concept du « CARE » (mot englobant pour dire « prendre soin de » qui n’a pas son équivalent en français). Ce TRAVAIL de soin et d’éducation (c’est un vrai « travail » même s’il n’est pas rémunéré !) est tellement important pour préserver l’équilibre familial et social ! C’est un travail invisibilisé et pourtant derrière lui se cachent des enjeux économiques, de développement, de justice sociale, d’égalité et même de paix. Lors d’un colloque organisé au Bangladesh, j’ai entendu ce cri du cœur des femmes qui était le même que celui des mères chez nous : « Nous demandons d’être RECONNUES pour notre travail dans notre famille ! » C’est tellement nécessaire et évident car « Essayez sans les mères » ! Dans le monde du travail rémunéré, « la vraie différence de salaire commence dès le premier enfant… » et c’est une grande injustice pour les mères qui se retrouvent trop souvent dans la catégorie la plus pauvre de la population. Ce constat fut mis en lumière par Claudia Coldin, chercheuse américaine et prix Nobel d’Économie en 2023. Mais MMM le dit depuis bien longtemps !Quels sont les domaines d’action privilégiés de MMM ?La valorisation du travail familial de « care » et d’éducation » qui a une incidence réelle sur l’avenir des pays ; le développement de la petite enfance : la base affective et émotionnelle est si importante ; la conciliation vie familiale - vie professionnelle ; la santé mentale des mères souvent pas loin de l’épuisement tant est lourde leur charge entre famille et travail car partout ce sont les mères qui s’occupent majoritairement des enfants. Elles sont aussi parfois victimes de violences tout en ayant, magnifique paradoxe, le pouvoir de promouvoir la paix et d’éduquer aux valeurs de cohésion sociale. Enfin, l’engagement des pères qui est un levier essentiel pour faire évoluer la situation en s’investissant d’avantage dans le soin et l’éducation des enfants.Comment parvenir à moduler la vie familiale et la vie professionnelle pour une mère ? Le monde du travail entend-il cette demande pressante ?Depuis le début de l’ère industrielle les familles n’ont cessé de s’adapter au monde du travail. Aujourd’hui, le monde du travail doit s’adapter aux familles. C’est un enjeu vital pour nos sociétés. Il s’agit de réaliser qu’à certaines périodes, la priorité doit pouvoir être donnée à la famille. Développer la flexibilité au travail et le travail à temps partiel ; faciliter la rentrée dans le monde du travail en valorisant les compétences acquises par le travail familial seraient des solutions. La diversité des politiques et des mesures doit accompagner la diversité des choix et des personnes.MMM travaille aussi en partenariat avec d’autres organisations. Comment ?MMM est une association mondiale avec un réseau d’associations partenaires qui agissent sur le terrain avec et pour les mères. MMM entend et fait entendre les voix des mères : nous entendons ce que disent les mères dans différents pays et le répercutons au niveau des institutions internationales pour susciter des lois et des mesures qui répondent aux défis que rencontrent les mères.La force de MMM est de créer des ponts entre les mères et les décideurs. Notre objectif est de soutenir les mères avec un impact profond et durable sur leurs enfants, leur famille et plus largement sur la société dans son ensemble.Thomas d’Ansembourg écrivait qu’ « un citoyen pacifié est un citoyen pacifiant ». Quelle évidence forte à proposer sans réserve à notre société et que MMM, par son élan, ses propos justes et son souci de fédérer les mères, essaie d’améliorer sans relâche et avec une belle part d’enthousiasme !Nous remercions la comtesse Emmanuel de Ribaucourt pour la réalisation de cette interview.
A l'hôtel de Gaiffier d’Hestroy à Namur qui abrite le musée des arts anciens du namurois, débute l’exposition LOUISE D'ORLÉANS, première reine des Belges : un destin romantique.
Monsieur Julien de Vos est, pour la Province de Namur, le directeur du Service des musées et du patrimoine culturelPhilippe de Potesta : Monsieur de Vos, y a-t-il une différence entre l’exposition sur Louise d’Orléans qui s’est tenue à Chantilly et celle qui débute en ce moment jusqu’à la mi-juin à Namur ?Julien de Vos : L’exposition au musée Condé à Chantilly était l’occasion d’évoquer la place particulière qu’occupait Louise au sein de la maison royale des Orléans, et d’en réhabiliter en quelque sorte l’importance, avec un accent tout particulier sur les goûts et passions hérités de ses parents. L’exposition de Namur ajoute à cette première présentation un volet complémentaire, plus personnel, grâce non seulement aux écrits de la souveraine (sa correspondance pléthorique, ses carnets de croquis, ses exercices d’« écolière », ses cahiers de voyage, …) mais aussi à l’aide d’objets et de souvenirs qu’elle collectionnait ou réalisait. C’est ainsi, par exemple, que le parcours scénographique dévoile pour la première fois des bijoux et des objets sentimentaux, mais aussi des sculptures, dessins et aquarelles que la première reine des Belges conservait soigneusement dans ses appartements dans des portefeuilles ou des albums romantiques, Les pièces présentées, qui n’avaient encore jamais été exposées, sont donc plus nombreuses et plus diverses, afin de découvrir avec pudeur l’intimité de Louise, depuis sa passion pour le Moyen Âge et ses châteaux, jusqu’à ses goûts belges et les combats qui ont forgé sa vision de la fonction royale. À l’issue de la visite, loin de la vision d’une femme effacée et d’une reine oubliée que le souvenir en a trop souvent laissé, la personnalité de Louise se révèle au visiteur telle qu’elle apparut dès l’époque : une icône pour la Belgique devenue son ange tutélaire, une première reine des Belges qui connut le destin d’une héroïne romantique.Ph de P : Parmi les pièces exposées, y en a-t-il une qui suscite une émotion particulière ?J de V : L’objet présenté dans l’exposition, qui pour moi et pour les visiteurs est le plus émouvant, est sans nul doute le bracelet d’or avec les médaillons en forme de cœurs, renfermant les cheveux des membres familiaux proches de Louise. Ce bijou précieux, qui permettait à la reine des Belges de rester intimement proche avec ceux qu’elle aimait, a été offert par la reine d’Angleterre Victoria le 3 avril 1844, à l’occasion de l’anniversaire de Louise. Il s’inscrit dans la longue tradition romantique de la joaillerie sentimentale, dont les pièces produites servaient en quelque sorte de précieux reliquaires, emportés à volonté par Louise lors de ses sorties ou, le plus souvent, portés dans l’intimité de ses appartements. Ils sont l’incarnation des liens étroits et des souvenirs familiaux que les membres des cours princières se plaisaient à se rappeler et à évoquer, en s’offrant et s’échangeant de tels objets. Les miniaturistes, pour ces bijoux sentimentaux, étaient des artistes particulièrement recherchés, dans la mesure où la préciosité des réceptacles d’or - souvent ornés de pierreries – pouvait être combinée à l’emploi de miniatures, réalisées par les plus grands artistes, dont le plus fameux est sans nul doute William Charles Ross. Puisant son inspiration dans les portraits officiels réalisés par Franz Xaver Winterhalter, le miniaturiste ne s’attachait à en garder que les yeux, considérés comme « la voix de l’âme ». Et c’est cette « ribambelle » de prunelles qui interpelle, alors qu’à l’intérieur de plusieurs de ces médaillons certaines inscriptions permettent parfois d’identifier le « propriétaire » de l’œil. Dans d’autres cas, le prénom est formé, sur le couvercle grâce à l’usage d’acrostiches, l’initiale de chaque pierre représentant une lettre bien précise. La préciosité de ces deux objets, intimes et familiers, donnent un éclairage émouvant sur les sentiments éprouvés par la reine dans son quotidien. Ce sont les recherches menées en partenariat étroit avec le musée Condé qui a permis non seulement d’en retrouver et d’en retracer l’histoire, mais aussi de les acquérir. Ils sont désormais la propriété du musée de Chantilly, et ont ainsi rejoint les collections dont l’embryon a été constitué par le propre frère de Louise, le duc d’Aumale Henri d’Orléans.Un grand merci à l’homme passionné d’histoire qu’est monsieur de Vos pour ses explications qui nous donnent vraiment l’envie de découvrir cette passionnante exposition sur notre première Reine dans le lieu prestigieux qu’est l'hôtel de Gaiffier d’Hestroy, en plein centre de Namur. Exposition placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté la Reine.Philippe de Potesta
CARE Belgium : Agir pour un monde plus stable et équitable
Dans un monde en pleine mutation, marqué par des crises géopolitiques, économiques et environnementales de plus en plus complexes, la solidarité internationale se trouve face à des défis majeurs. Le contexte actuel est particulièrement difficile : guerre en Ukraine, crise climatique, insécurité alimentaire... autant de phénomènes qui exacerbent les inégalités et fragilisent la stabilité mondiale. Dans ce contexte turbulent et incertain, il devient essentiel de se poser une question fondamentale : peut-on vraiment se passer de solidarité internationale ?La réponse est non. La solidarité internationale n’est pas seulement un impératif moral, elle est un pilier de stabilité pour l’ensemble de la planète. L’aide humanitaire et les initiatives de coopération internationale ont permis de réaliser des avancées significatives dans de nombreux domaines. Depuis 1945, l’absence de conflits majeurs entre pays de l'Union européenne en est un exemple frappant. De même, l'extrême pauvreté a diminué de manière spectaculaire, passant de 36 % en 1990 à 8,5 % aujourd'hui. Ces progrès sont le fruit de la coopération internationale et de l'engagement des ONG, qui œuvrent au quotidien pour faire face aux crises.Les défis auxquels sont confrontées les ONG aujourd’hui sont donc nombreux : montée du nationalisme, repli sur soi, et fragmentation des initiatives de solidarité. Cependant, ces difficultés ne doivent pas faire oublier les opportunités que recèle l’approche collaborative et inclusive. Les progrès réalisés jusqu’ici montrent qu’il est possible de faire une différence collective, et de nombreux exemples démontrent que l’action collective peut engendrer des victoires durables, comme l'éradication de la variole ou les avancées écologiques avec le Protocole de Montréal.Chez CARE Belgium, nous choisissons l’action. Depuis 2015, notre réseau CARE International a soutenu 210 millions de personnes. Mais pour que ces avancées perdurent, la solidarité doit rester une priorité. Nous nous engageons à ne pas nous contenter de solutions temporaires, mais à investir dans des actions durables qui permettent aux populations de se relever et de se renforcer sur le long terme. Cela signifie une approche holistique, combinant aide d’urgence, renforcement des capacités locales et action en faveur de la résilience face aux crises à venir.La solidarité internationale n'est pas une option, mais une nécessité pour construire un monde plus stable, plus juste et plus équitable. C’est dans cette conviction que nous poursuivons notre travail au quotidien, en soutenant des millions de personnes en situation de vulnérabilité. Mais pour que ces avancées perdurent, il est essentiel que la solidarité reste une priorité mondiale, et que chacun d’entre nous, à travers des actions concrètes, continue de soutenir cet engagement.Dans ce contexte, nous vous invitons à vous joindre à nous pour soutenir la solidarité internationale. Nous espérons ainsi vous compter parmi nous le 12 juin 2025 au Palais d’Egmont, afin de célébrer ensemble le 10e anniversaire de notre Gala caritatif, sous la présidence de Son Altesse Royale la Princesse Esméralda de Belgique, Présidente d'honneur de CARE Belgium. Cette soirée marquante célébrera une décennie de solidarité et de soutien aux projets que nous menons à travers le monde pour promouvoir les droits des femmes, lutter contre les effets du changement climatique et intervenir lors des urgences humanitaires.Nous remercions la baron (Johan) Swinnen pour la réalisation de cet article et la contribution d'Odile de Saint-Marcq, Secrétaire Générale de CARE Belgium.
Après la fête, le bilan : rencontre avec le baron (Guy) de Borchgrave, responsable du bal de l’anrb
Le 75e Bal de l’ANRB s’est tenu cette année sous le signe de la fête, de l'élégance et de la solidarité. Un moment exceptionnel qui a réuni plusieurs générations autour d’un même objectif : soutenir les actions de Solidaritas tout en perpétuant une tradition précieuse.Mais derrière les lumières et la musique, ce sont des mois de préparation et l’engagement sans faille d’une équipe de bénévoles qui rendent cet événement possible. À la tête de cette organisation depuis près de 15 ans, Guy de Borchgrave nous partage son bilan de cette édition historique et revient sur son engagement de plus de 40 ans au sein de l’ANRB.Un 75e Bal couronné de succèsQuels ont été, selon vous, les grands succès de cette édition ?"Le Piano Bar a été une vraie réussite : une excellente atmosphère et un public très nombreux.L’ambiance sur la piste de danse, dès le début du Bal était particulièrement enthousiaste, toutes générations confondues ! Sans oublier le Photocall, qui a rencontré un vif succès."Une édition anniversaire pas comme les autresEn quoi cette 75e édition était-elle différente des précédentes ?"Nous avons ajouté quelques détails spécifiques pour marquer cet anniversaire, comme les noms de table personnalisés en hommage à des membres ayant joué un rôle clé depuis les débuts du Bal, ou encore une attention particulière à tous ceux qui célébraient leurs 75 ans cette année. Bertrand de Jamblinne a même créé un site retraçant l’histoire du Bal.Un engagement de longue dateCela fait plus de 40 ans que vous vous investissez pour l’ANRB et plus de 30 ans pour le Bal. Quelles sont vos motivations profondes ?"L’ANRB est une vieille dame que j’aime beaucoup. J’ai été inspiré par des figures exemplaires comme le Comte Jean d’Ursel et Madame Martens de Noordhout, qui m’ont donné envie de m’engager."Qu’est-ce qui vous touche le plus dans cette aventure humaine ?"J’apprécie particulièrement le fait que, le temps d’une soirée, les jeunes se retrouvent de l’autre côté de la barrière en tant que serveurs et bénévoles. Beaucoup d’entre eux ne regardent plus jamais un serveur de la même manière après cette expérience."Comment le Bal a-t-il évolué au fil des années ?"Le Bal reste traditionnel et multigénérationnel, ce qui est un choix délibéré. Certaines évolutions sont nécessaires, notamment avec les nouvelles technologies, mais il faut les intégrer avec finesse pour ne pas déstabiliser une partie du public. Je pense entre-autre au piano bar ou à la participation de certains rallyes. Certains jugent le Bal de ‘poussiéreux’, je préfère dire ‘traditionnel’."Pourquoi venir au Bal ?Que diriez-vous à celles et ceux qui n’ont jamais participé et qui hésitent encore ?"VENEZ ! Ceux qui viennent ne repartent plus !"Qu’est-ce qui rend cet événement unique ?"Son ambiance multigénérationnelle. Il est rare de voir grands-parents, parents et petits-enfants partager une même piste de danse."Une organisation bien huiléeCombien de personnes travaillent en coulisses ?"Nous avons une équipe de 25 personnes, chacune responsable d’un département, garantissant une organisation fluide. Le soir du Bal, 140 bénévoles prennent le relais pour assurer l’ensemble des services jusqu’au bout de la nuit."Quand commence la préparation d’une édition ?"Le lendemain du Bal !"Un engagement solidaireAu-delà de la fête, le Bal a aussi une vocation sociale et solidaire. Pouvez-vous nous rappeler ce que permet de financer cet événement ?"Le Bal est l’un des événements les plus lucratifs pour Solidaritas. Nous tenons à ce qu’il reste accessible à tous nos membres, tout en permettant de soutenir nos actions solidaires.”Un immense merci à Guy de Borchgrave et à toute son équipe pour leur travail remarquable. Grâce à leur engagement, le Bal de l’ANRB continue de faire résonner ses traditions tout en contribuant à une cause essentielle.Rendez-vous l’année prochaine, le troisième samedi de mars, pour une nouvelle édition inoubliable !
Regards croisés… pétillants !
A l’instar des couleurs vives de l’arc-en-ciel enrichissant un paysage, créer des liens et des affinités entre musées peut ouvrir un monde de possibilités ! Ce qui fut le cas lors de la rencontre fructueuse organisée entre Valentine Boël, Présidente des Amis des Musées Royaux d’Art et d’Histoire et Eline Ubaghs, Présidente des Amis des Musées Royaux des Beaux-Arts.André Malraux affirmait que visiter un musée était une délectation de l’esprit : voyons donc le menu.Eline Ubaghs met en avant le caractère éminemment pluriculturel de Bruxelles invitant les musées à communiquer les valeurs de notre pays qui permettent de comprendre les modes de pensées qui ont conduit à notre culture actuelle. La perspective du bicentenaire du Royaume rappelle cette nécessité. A l’horizon 2030, les Musées Royaux des Beaux-Arts vont bénéficier de nombreuses remises à niveau structurelles. Les travaux vont rendre nécessaire le déménagement de plusieurs collections ; des salles d’exposition rénovées seront ouvertes au public pour présenter un nouveau parcours muséal des collections permanentes avec des œuvres du XVe au XXIe siècle qui ne seront plus compartimentées chronologiquement. Cet accrochage offrira plus de transversalité, de diversité, d’inclusion.Les Musées qui ont accueilli plus des 700 000 visiteurs en 2024 poursuivront leur politique de prêts et de partenariat à des expositions dans le monde entier, afin de valoriser leurs collections.Dans le même esprit, Valentine Boël souligne que l’asbl des Amis des Musées Royaux d’Art et d’Histoire a été créée voici 50 ans par Pierre Solvay pour permettre l’accès aux musées et promouvoir la culture auprès d’un large public tout en soutenant ces musées dans la mise en valeur et l’enrichissement de leurs collections par la restauration des œuvres des musées et l’achat d’œuvres ayant un intérêt scientifique pour les collections qui sont d’un intérêt et d’une qualité égale au Victoria & Albert Museum of London. « Partager le savoir des collections et la joie des découvertes avec les visiteurs permet d’apprécier les facettes du monde dans lequel nous vivons. De plus, les conservateurs nous font le privilège d’être toujours présents à nos évènements qu’ils nourrissent en conférences et exposés de grande qualité ». Elle ajoute : « notre équipe très dynamique s’investit beaucoup pour élaborer un programme attractif de visites en semaine et le week-end, de nocturnes, de visites spécialisées avec les conservateurs, ainsi que d’activités pour grands-parents et petits-enfants ».Convaincue, elle poursuit : « L’horizon 2030 est un challenge pour une meilleure visibilité des musées et une mise en valeur des collections dans un nouvel écrin avec la réouverture des salles rénovées. Nos deux projets phares à venir sont la digitalisation des visites via une App pour les nouvelles salles des 19e et 20e siècles que nous inaugurerons en juin et la mise en place d’un accueil dans le Musée Art et Histoire par des bénévoles.C’est dans le même état d’esprit que travaille Eline Ubaghs : « Les Amis auront plus que jamais pour vocation d’aider les Musées dans leurs missions. Leur support est focalisé sur l’accueil des visiteurs et le soutien à la formation d’un public de plus en plus diversifié et en particulier des jeunes visiteurs.»Elle poursuit : « En 2025, les Amis offriront 100 visites guidées gratuites pour les écoles de l’enseignement en Belgique avec priorité pour les écoles défavorisées. Ils financeront la production et la distribution du Petit Musée Portatif développé par la Médiation culturelle des Musées ainsi que la formation des enseignants chargés d’utiliser ces kits dans les écoles. Ils contribueront à former à la diversité les guides freelance ; ils renouvelleront le matériel du « Musée sur mesure » qui propose une offre adaptée aux visiteurs fragilisés ou en situation de handicap. Plus original, ils permettront la réalisation d’un projet académique avec des dermatologues de la VUB dans l’étude des peintures… Les Amis désirent faire découvrir l’Art à leurs membres et publient deux fois par an un carnet « Become a Friend » informant des travaux, expositions, évènements et initiatives culturelles visant à l’ouverture à la scène culturelle bruxelloise, européenne et même mondiale. »Valentine Boël et Eline Ubaghs insistent toutes les deux sur le fait qu’elles ne travaillent qu’avec des bénévoles ; tout l’argent est concrètement investi dans les projets d’édition, de restauration et d’acquisitions pour les musées. Elles soutiennent fermement l’idée qu’un musée est un lieu de rencontre, dans un esprit de diversité et d’universalité afin de résister à l’obscurantisme qui règne de plus en plus sur la planète. C’est un message à transmettre en particulier aux jeunes générations.L’importance de la culture est déterminante pour se mieux comprendre et accepter la différence dans ce qu’elle a d’enrichissant. Le soutien des Amis est vital pour nos musées belges. Ne dit-on pas que les musées sont les chefs étoilés de la culture ?!Rencontrer deux personnalités aussi concernées, lucides et enthousiastes se révéla passionnant ; ces regards croisés chaleureux et pertinents autorisent une belle conclusion : ils sont devenus des regards accordés ! Nous remercions la comtesse Emmanuel de Ribaucourt pour la rédaction de cette interview.
Séverine de Fierlant nous fait découvrir son aventure en Inde
Philippe de Potesta : pourriez-vous me parler de votre rôle dans votre école en Inde, nous expliquer où elle se situe et comment ça se passe en classe ?Cette année, je suis professeure de français et sciences sociales dans le Gujarat, un État au Nord-Ouest de l'Inde. Quelle drôle d'idée... Et quelle belle expérience !Le système éducatif est assez différent du nôtre en Belgique. Ici, les élèves enchaînent neuf cours avec deux petites pauses, sans récréation. La prière est récitée quotidiennement en sanskrit/anglais/français. Au programme, en plus des matières classiques, les étudiants ont Yoga, Art, Danse, Musique, Librairie, Robotique, Théâtre, ... Après l'école, ils ont encore des activités parascolaires, l'académie et les devoirs. Le rythme est assez intense. Et puis au Gujarat, on travaille aussi le samedi.Ceci dit, les 17 schtroumpfs de ma classe sont comme tous les enfants du monde, toniques et très attachants. L'organisation est un brin olé-olé et on n'est jamais à l'abri d'une coupure de courant ! N'empêche, j'ai beaucoup aimé donner cours dans cet environnement dynamique.Ph de P: qu’est-ce que vous aimez le plus en Inde ? Comment décririez -vous les gens et la culture là-bas ?À mes yeux, l'Inde c'est comme une boule disco, un pays avec 1000 facettes de couleurs, de paysages, d'odeurs et de saveurs.En Inde, on vit intensément !Il y a du monde, du bruit, des animaux partout... Ce sont beaucoup de nouveautés pour un étranger qui débarque.Ici, nos sens sont constamment en éveil. On entend une palette de langues chantantes, on contemple des couchers de soleil magnifiques, on porte des textiles délicats ... Les arômes font voyager nos papilles. Les Indiens ne peuvent d'ailleurs pas vivre sans leurs épices. Ils en mettent partout : dans les plats, les desserts, les boissons et sur leurs tranches de fruits frais. Et alors, oubliez vos standards européens. En Inde, le "little spicy" peut déjà vous faire transpirer à grosses gouttes !Mais surtout, les Indiens sont d'une extrême bonté et hospitalité. Combien de fois on ne m'a pas invitée à boire un chay (thé au lait sucré). Partout, on se pliera en quatre pour vous honorer en tant qu'invité, qu'en bien même la manière de procéder peut sembler légèrement maladroite. Par exemple, j'ai eu peur au restaurant la première fois que 4 serveurs se sont rué sur moi pour me resservir !Vous serez toujours bien accueilli en Inde. Par respect, veillons simplement à porter une tenue décente, selon les normes locales. Au Gujarat, les femmes se baladent le nombril à l'air mais les épaules et les jambes sont toujours couvertes.C'est ça que j'aime finalement en Inde, l'authenticité des habitants, les aléas qui pimentent votre quotidien, l'ambiance vibrante des villes et le calme ressourçant des lieux reculés.Ph de P : la spiritualité occupe une grande place en Inde. Comment est-elle vécue au quotidien ?Les Indiens vivent effectivement au rythme du calendrier et selon les dogmes propres à leur religion. La majorité des Indiens sont hindous. Les autres religions pratiquées sont l'islam, le bouddhisme, le christianisme, le judaïsme, le jaïnisme et le sikhisme. Cette diversité s'explique par les influences coloniales et les migrations de peuples dans cette région du monde depuis la nuit des temps.J'admire la piété et la tolérance des Indiens. Chacun prie librement et ouvertement à la maison, dans les espaces publics ou au travail.En à peine quelques heures, je peux chanter à l'église protestante, prendre un tuk-tuk avec un chauffeur musulman qui écoute sa musique ourdou afin d'aller rejoindre des amis hindous pour un rituel religieux, et puis sortir dîner avec des Jaïns (menu végan et pas de légumes racines).Autant dire que je ne sais plus à quel saint ou Dieu me vouer !Ph de P : y a-t-il une fête ou un événement en Inde qui vous a particulièrement marquée ? Pourquoi ?Dans ce pays aux multiples traditions et confessions, il y a toujours une raison pour se rassembler, danser et manger.Récemment, j'ai eu la grande joie d'assister au mariage de mon ami Gagan.Alors un mariage indien, c'est plusieurs jours de festivités, un dress code spécifique pour chaque cérémonie, des danses endiablées et des zakouski à l'infini. C'est féerique !Honnêtement, sous un sari de soie on se sent un peu comme un gigot ficelé et on a chaud, mais qu'est-ce que c'est classe !Finalement les fêtes traduisent parfaitement l'histoire et la culture millénaires de l'Inde, si riches et haut en couleurs !On dit souvent "incredible India". C'est tout à fait ça. Il faut le vivre pour le croire.Ce pays, mes amis et les indiens garderont une place spéciale dans mon cœur. Quelle chance d'avoir passé cette année merveilleuse sur la terre des maharajas.Ph de P : un grand merci Séverine de nous avoir partagé cette fantastique expérience indienne !Interview réalisé par Philippe de Potesta
Le Hainaut : une terre, des patrimoines
Avant l’arrivée de Jules César en 58 av. J.-C., le Hainaut était occupé par les Nerviens, réputés pour leur résistance farouche contre les légions romaines. Une fois intégrée à la « Gaule Belgique », cette contrée devint un carrefour stratégique du monde romain. De cette époque subsistent encore des traces dans la toponymie locale et les vestiges archéologiques.Avec le déclin de l’Empire romain, le Hainaut entra dans l’orbite des Francs Saliens, qui s’y installèrent progressivement. Clovis Ier, après sa victoire contre Syagrius en 486, annexa la région à son royaume mérovingien. Elle devint ensuite un territoire clé du vaste empire carolingien, gouverné par Charlemagne depuis Aix-la-Chapelle. Après le traité de Verdun en 843, le Hainaut fit partie de la Francie médiane de Lothaire Ier avant d’être rattaché à la Francie occidentale de Charles le Chauve.De comté à provinceBien que son existence comtale remonte à la fin du IXe siècle, c’est au Xe siècle que le Hainaut acquit une véritable identité politique. À cette époque, Mons devint le centre de cette nouvelle entité féodale. Le comte Régnier Ier au Long Col y fit édifier une forteresse en bois pour défendre la ville contre les incursions vikings. Sous la comtesse Richilde, au XIe siècle, cette première forteresse fut progressivement renforcée en pierre.Tour à tour rattaché à la Francie médiane, la Lotharingie et le Saint-Empire romain germanique, le comté de Hainaut fut intégré aux Pays-Bas bourguignons en 1477 après le mariage de Marie de Bourgogne avec Maximilien Ier de Habsbourg. Il devint ensuite une province des Pays-Bas espagnols avant de passer sous contrôle autrichien au XVIIIe siècle. Ses capitales historiques furent Valenciennes, principal centre du comté jusqu’à son annexion par la France en 1678 lors du traité de Nimègue, et Mons, qui devint par la suite la capitale administrative du Hainaut belge.Le XVIIe siècle marqua un tournant avec les conquêtes de Louis XIV, qui permit l’intégration progressive de plusieurs territoires hennuyers au royaume de France, tandis qu’une partie du comté resta sous domination autrichienne jusqu’à la Révolution française.Après la chute de Napoléon, le Congrès de Vienne rattacha le Hainaut au royaume uni des Pays-Bas, avant qu'il ne devienne une province belge en 1830 sous l'impulsion de la révolution, avec Bonaventure de Bousies comme premier gouverneur. Son industrie, notamment charbonnière, alimenta aciéries et usines textiles, assurant la prospérité économique de la région du XIXe siècle au début du XXe siècle.Les grandes familles aristocratiques hennuyères, telles que les princes de Ligne, les princes d’Arenberg, les princes de Croÿ, les comtes du Chastel de la Howarderie, les comtes de Lalaing, les comtes de Lannoy et les marquis de Trazegnies, ont exercé une influence considérable sur cette terre. Ces « dynasties » ont su perdurer malgré les changements de régime et ont forgé le paysage historique du Hainaut. Aujourd’hui encore, certaines de ces familles résident dans leurs domaines ancestraux et se consacrent avec ardeur à la préservation de ces précieux témoins de l’Histoire.Son patrimoine castralParmi les vestiges architecturaux les plus emblématiques ayant traversé les siècles, les châteaux hennuyers offrent une immersion unique dans le passé. Le château de Beloeil est implanté depuis huit siècles au milieu de ses douves. Par son élégance et ses vastes jardins, il est une véritable perle du Hainaut. Le château de Chimay, dont l'origine remonterait à l'an 1000, fut d'abord un donjon, entouré de tours et d'une enceinte dès le XIIIe siècle. De son côté, le château féodal d’Antoing trouve son origine au Xe siècle. La première mention évoque une simple élévation de terrain surmontée d’une construction en bois, protégée par une palissade et un large fossé. Le château d’Anvaing, qui se distingue par son architecture Renaissance, date du XVIe siècle, bien qu’une première construction y existait déjà à l’époque de la première croisade. Le château d’Écaussinnes-Lalaing fut édifié au XIIIe siècle à l’emplacement d’un poste fortifié construit en 1184 par Baudouin V, comte de Hainaut. Le château voisin de La Follie est un manoir du XVIe siècle bâti sur les fondations d’une forteresse médiévale en moellons, autrefois entourée de douves.D’autres demeures, comme le château de Louvignies, ancienne motte féodale abritant une tour, ont servi de décor au film Germinal. Le château d’Attre, quant à lui, a accueilli le tournage d’une partie du film Les Visiteurs : La Révolution.Un rendez-vousAvis aux passionnés d’histoire et d’architecture : l’ANRB vous convie au Rallye des Parcs et Châteaux, qui se tiendra dans cette province wallonne le 25 mai 2025. Venez flâner à travers les propriétés de Taintignies, Vaulx, Bruyelle, Antoing, Wez-Velvain, Braffe, La Berlière, Beloeil, Louvignies, La Follie, Ecaussines-Lalaing, Wavrin, ainsi que Ramets (FR) et Potelle (FR) ; et plongez dans le passé, au cœur d’un territoire où la grandeur des siècles passés continue de rayonner.Nous remercions le comte Pierre-Alexandre de Lannoy pour la rédaction de cet article.
RALLYE DES CHÂTEAUX 2025 : le Hainaut !
Partez à la découverte de 15 parcs et châteaux dans la province du Hainaut. Un déjeuner est proposé à Antoing, Beloeil et Louvignies, sur réservation et avec paiement préalable. Tous les bénéfices de cette journée seront reversés à Solidaritas. Inscription, réservation et paiement possibles jusqu'au 17 mai sur : www.anrb-vakb.be/rallyeLe programme sera envoyé par email ( version .pdf) pour toutes les inscritpions et paiement après le 12 mai. Les inscriptions pour les lunches sont clôturées.Toute inscription en tant que non-membre doit se faire par le biais d'un parrainage.
De la finance aux foyers solidaires : un engagement qui donne du sens
Bernard de la Vallée Poussin Né le 29 octobre 1991 à Saint Germain en Laye (France) Belge & Français AvocatJeune Belge élevé dans un environnement international et multi culturelJe suis très attaché à ma nationalité Belge. Les familles de mes deux parents appartiennent à la noblesse du Royaume de Belgique et comportent certaines personnalités inspirantes.Né en France, j’ai également été élevé dans un environnement international et multiculturel. Depuis mon enfance, j’ai appris à apprécier la richesse de la diversité tout en ayant une affection profonde pour mon identité et mes racines Belges.Avocat engagé au service des acteurs de la croissanceA l’issue d’un double cursus universitaire en droit et finance, entièrement réalisé en France, je suis devenu avocat au Barreau de Paris spécialisé en droit des sociétés. En pratique, j’interviens en qualité de conseil juridique dans des opérations de croissance externe (Fusions-Acquisitions) et d’investissement (Private Equity). Plus spécifiquement, j’ai développé une appétence personnelle pour les opérations de levée de fonds de start-up (Venture Capital). J’ai beaucoup de plaisir à accompagner quotidiennement des dirigeants de groupes internationaux, des investisseurs et des créateurs d’entreprises. Ce sont des personnes passionnées. Leur engagement professionnel est absolu. Et le fruit de leur travail est un pilier de la croissance de notre Economie et participe plus généralement à la construction du Bien Commun.J’ai la chance d’exercer un « métier passion » au service du développement de l’Economie. Toutefois, je reconnais que cette profession nécessite un engagement total et la faculté de savoir repousser ses limites. En effet, certains dossiers nécessitent de travailler de jour comme de nuit, en semaine comme durant le week-end.Cette façon d’exercer ma profession d’avocat fait écho à mon caractère passionné et engagé. J’ai très tôt découvert le plaisir d’apprendre à me surpasser pour réaliser mes rêves.Sur le plan extraprofessionnel, je garde précieusement en mémoire la joie que j’ai ressentie en réalisant l’ascension du Mont-Blanc et la fierté qui m’a habitée en devenant Vice-Champion de France par équipe en saut d’obstacles.J’insiste sur le fait que lors de ces deux expériences, j’ai été mué par la force d’un collectif. Je crois fermement que – tant dans l’environnement professionnel que dans la sphère extraprofessionnelle – le collectif donne du sens et permet de mettre en valeur les individualités qui le compose.La solidarité comme vecteur de croissanceAu cours de l’année 2023-2024, mon cabinet d’avocats (https://www.uggc.com) m’a offert la possibilité d’effectuer un détachement permanent au sein de son bureau en Belgique. Cette expérience m’a permis de m’inscrire au Barreau de Bruxelles (Liste E) et d’approfondir mes connaissances en droit Belge des sociétés. J’ai notamment été impliqué dans plusieurs opérations transfrontalières entre la France et la Belgique.Lors de ce détachement, j’ai également eu la chance de vivre pendant un an au sein de la colocation Lazare. Il s’agit sans aucun doute de l’une de mes plus belles expériences !Lazare (https://www.lazare.eu) est une association d’origine française qui propose des colocations solidaires entre jeunes actifs et anciens sans abris. A Bruxelles, il existe deux maisons Lazare : une première colocation de 10 hommes et une seconde colocation de 12 femmes. Une famille bénévole est responsable de chacune des maisons. Chaque famille responsable habite dans son propre appartement à côté des deux maisons.Au quotidien, nous vivons ensemble, tout simplement. C’est ni plus ni moins qu’une vie en colocation. Nous sommes tous coloc’ au même titre : chacun paye une indemnité d'occupation, la même pour tous (certains bénéficient des aides publiques liées à leur statut).Lazare offre la possibilité de réunir sous un même toit des personnes venant de tout horizon. Certains de mes colocs issus de la galère ont vécu de véritables drames personnels et/ou souffrent d’addiction(s).J’ai été immédiatement séduit par l’intensité et la beauté de cette vie en colocation. La maison Lazare des hommes de Bruxelles est un collectif uni et très attachant qui m’a fait grandir. J’ai énormément appris auprès de mes colocs. A Lazare, on rit beaucoup, on partage également la peine de chaque coloc qui va mal. Mais de jour en jour, on est porté par une joie profonde qui nous habite.La vie en colocation Lazare est compatible avec un engagement professionnel. Ces deux expériences se nourrissent mutuellement. Je suis désormais convaincu que la solidarité et la gratuité sont des vecteurs de croissance.Lazare est une douce folie au cours de laquelle l’extraordinaire est vécu quotidiennement : Lazare permet à des personnes de sortir de la rue ; Lazare répond à la quête de sens qui habite les jeunes actifs ; Lazare inspire à chacun de ses colocs de nouveaux projets personnels et/ou professionnels.De toutes mes expériences, Lazare est ma plus belle aventure !Cette aventure extraordinaire est à portée de main. Chaque personne intéressée peut franchir les portes d’une colocation Lazare (https://www.lazare.eu/devenir-coloc) ou soutenir ce projet (https://www.lazare.eu/faire-un-don).Nous remercions Philippe de Potesta pour la rédaction de cette interview.
Norbert de Ribaucourt : Un itinéraire sous le projecteur
Ce mois-ci, nous braquons les projecteurs sur le comte Norbert de Ribaucourt, dont l’énergie et la créativité éblouissantes ont donné naissance à une entreprise artisanale innovante. Artiste dans l’âme, touche-à-tout, anticonformiste et doté d’une vision claire et réaliste, il place la création au cœur de son quotidien, reléguant au second plan tout ce qui pourrait freiner son inspiration. Son atelier est à l’image de l’artisan : plein à craquer… d’idées. Heureusement, sa radieuse épouse Nathalie, par sa rigueur et son sens de l’organisation, veille à l’équilibre de cette dynamique ardente. Un duo complice et complémentaire, où l’un conçoit et innove pendant que l’autre structure et harmonise.L’aventure commence après quelques expériences dans différentes entreprises, en 2012 se sentant peu à peu s'éteindre sous le poids de la routine, Norbert décide de mettre à profit ce que son parcours académique lui a offert : l’électromécanique et les relations publiques. Il se lance alors à son compte grâce au programme Job Yourself, une couveuse d'entreprises qui éclaire la voie des nouveaux entrepreneurs en les libérant des contraintes administratives initiales. De cette liberté naît Novatrade, une entreprise spécialisée dans l’éclairage.Dès ses débuts, Norbert s’investit pleinement : conseil, vente, installation des produits… Rien ne lui échappe. Son ambition initiale ? Proposer des lampes démontables dans lesquelles le système d’éclairage "retrofit" peut être remplacé ou réparé, limitant ainsi le gaspillage. Rapidement, son attention se porte sur l’amélioration du CRI (Color Rendering Index) et de la température Kelvin, afin d’obtenir une lumière aussi naturelle qu’une bougie (2200 Kelvin) tout en offrant la possibilité de s’adapter à la clarté du jour ou même de contrer le clair de lune si nécessaire (6500 Kelvin). Il ne s’arrête pas là et travaille sur l’étanchéité de ses luminaires, atteignant l’indice IP65, garantissant une protection contre la poussière et l’humidité.Comme tout entrepreneur, il débute dans l’ombre : porte-à-porte pour sensibiliser aux avantages économiques des LED, puis bouche-à-oreille, avant de puiser son inspiration à l’international. Salons de Francfort, designers italiens, tendances du marché : il observe, analyse et affine sa vision avant de concevoir ses propres luminaires en laiton.Pourquoi le laiton ? Ce matériau noble résiste à la corrosion et est recyclable. De plus, sa patine capte la lumière et crée des jeux de reflets subtils et fascinants. Idéal pour les environnements extérieurs comme intérieurs, il incarne la robustesse et l’élégance intemporelle. Présentée sous la marque « Novatrade Lighting », Norbert propose désormais des appliques, spots, hublots, encastrés, plafonniers et bien sûr, son fameux "Zapa".Véritable étoile modulable de la gamme, le "Zapa" incarne l’innovation signée Norbert. Disponible avec une base en laiton, une tige longue ou un étrier, ce projecteur LED de 1W ou 1,5W est doté d’une tête pivotante à 180°, s’adaptant ainsi à toutes les exigences : illumination de parterres, jeux d’ombres, mise en valeur d’objets, d’arbres, etc.Depuis 2020, Novatrade Lighting multiplie les collaborations avec des architectes paysagistes, architectes et décorateurs. L’entreprise intervient sur des projets en Belgique, sur la Côte d’Azur, ainsi qu’en Suisse et au Portugal : son rayonnement dépasse largement les frontières.Un métier, trois expertises :Concepteur lumière : il analyse le projet, visite le site et écoute les attentes du client pour proposer une étude d’éclairage harmonieuse et esthétique.Distributeur d’éclairage : il propose une large gamme de luminaires d’intérieur et d’extérieur, sélectionnant des marques reconnues et des designers émergents, tout en développant sa propre ligne en laiton.Fabricant sur mesure : il conçoit des luminaires adaptés aux besoins spécifiques de chaque projet, alliant technologie et esthétique raffinée.Un faisceau d'indices concordants témoigne de son expertise : des solutions lumineuses sur mesure et des ambiances sculptées avec finesse. Brillant !Qu'il s'agisse d’expositions (photographes, antiquaires, etc.), d’événements, de vitrines, d’habitations privées, de festivités ou de salons, cet « Artisan de l'invisible » crée des ambiances, met en valeur les scènes et guide l'attention du public grâce à son art de l’éclairage. Qu'il intègre la lumière naturelle ou artificielle de manière innovante et esthétique, ou qu'il utilise les rayons de ces dernières pour sublimer jardins, sujets ou objets, il conçoit, distribue et fabrique l'éclairage sur mesure… Un maître des lumières en somme.https://www.novatrade.behttps://www.novatradelighting.comNous remercions le comte Pierre-Alexandre de Lannoy pour la rédaction de cet article.
Solidarcité : un tremplin citoyen pour la jeunesse
Quand la vie professionnelle permet de lancer un projet constructif et revalorisant : SOLIDARCITE !Maman de trois enfants, Marie de Dorlodot en est la cheville ouvrière et nous en parle avec passion.Comment est née cette association ? A partir de quels constats ?Le projet d’Année citoyenne Solidarcité est né il y a 25 ans sur la base des constats suivants qui sont encore d’actualité plus de 20 ans après :De nombreux jeunes adultes, bien que fragilisés, se trouvent exclus des dispositifs de l’aide à la jeunesse et doivent dès lors se tourner vers des dispositifs pour adultes (CPAS, OISP ...) ne répondant pas à leurs attentes.Des phénomènes de décrochage scolaire persistants. Par ailleurs, bon nombre des jeunes intégrant l'année citoyenne connaissent et nous livrent un rapport pour le moins conflictuel, désabusé voire douloureux vis à vis d'un système scolaire duquel ils se sont sentis exclus, incompris, voire parfois humiliés, pour des raisons diverses : décrochage, orientation peu pertinente…Les difficultés d’accès, pour les jeunes en difficulté, à des espaces de citoyenneté active.Les occasions de « brassage » social sont de plus en plus ténues, que ce soit à l’école, dans les quartiers ou dans les lieux de loisirs. Cette forme de ghettoïsation de la jeunesse a pour conséquence que certains groupes de jeunes ne se côtoient plus, renforçant les préjugés et les jugements réducteurs.L’identification de logiques cloisonnées dans l’approche des jeunes par les différentes politiques publiques.Ces constats ont amené l’idée de construire à leur intention un programme qui se fixe comme but de donner au plus grand nombre possible de jeunes, filles et garçons, l’opportunité de prendre part à un projet citoyen, tout en contribuant à renforcer la solidarité sous toutes ses formes.Cette idée, c’est l’Année Citoyenne; ce programme, c’est Solidarcité qui compte 8 asbl.L'Année citoyenne Solidarcité a pour principal objectif l’accompagnement social et éducatif de jeunes. Elle vise à favoriser leur développement personnel ainsi que leur intégration dans la société en tant que citoyens responsables, actifs, critiques et solidaires (CRACS).Pour critiquer la société, il faut la connaître. Quel public avez-vous contacté et où ?Les bénéficiaires directs sont des jeunes âgés de 16 à 25 ans aux difficultés personnelles importantes. Il s’agit d’un public pour lequel nous prenons un risque éducatif plus important (gestion quotidienne plus difficile, risque d’échec plus élevé ...) mais qui pourra bénéficier d’une stimulation positive engendrée par le reste du groupe. Ils sont généralement orientés vers notre projet par le secteur de l'Aide à la Jeunesse (36,7%) ou par leur entourage proche (17,4%) ou encore par le secteur de la santé mentale (12%).Le brassage des publics est un élément important à prendre en compte lors de la constitution des équipes. L'hétérogénéité des situations personnelles et des horizons socio-économiques et socioculturels permet la rencontre entre les jeunes qui auraient eu peu de chance de se rencontrer en raison des cloisonnements existants entre les classes sociales.Le projet est ouvert à toutes et tous, tout en se donnant les garanties d'un accès privilégié aux jeunes les plus fragilisés.En ce qui concerne notre public cible pour l'année 2023-2024, ce sont majoritairement des garçons (63%), mineurs.Les bénéficiaires indirects sont les 460 partenaires qui ont bénéficié de l'aide des jeunes volontaires via l'axe "services à la collectivité" du programme de l'année citoyenne, c’est-à-dire toutes les actions entreprises gratuitement par les volontaires au bénéfice de partenaires associatifs. Ces derniers sont, pour la plupart, des associations sans but lucratif défendant des valeurs « humanistes » et qui n’ont pas les moyens humains et/ou financiers pour mener à bien certains de leurs projets. Les services rendus par les volontaires doivent également être considérés comme des réels partenariats ; il ne s’agit en aucun cas de prestations contre rémunération mais bien de moments d’échanges au sein d’un espace de valorisation mutuelle.Comment avez-vous élaboré votre projet pédagogique ?Les jeunes sont regroupés en équipe de huit et accompagnés par un responsable. Ils/elles s’engagent pendant 6 à 9 mois dans un projet dynamique, appelé ‘Année Citoyenne’ reposant sur 3 axes :Un engagement citoyen sous forme de services à la collectivité et d'activités de rencontre :Tout au long du projet, les jeunes réalisent différentes actions de volontariat. Par exemple, retaper les locaux d’une association, distribuer des repas chauds aux plus démunis, participer aux travaux de gestion d’une réserve naturelle, participer à un projet international, etc… 2. Un temps de formations et de sensibilisations :L’action est complétée par un vaste programme éducatif poursuivant deux objectifs majeurs : préparer les volontaires aux actions qu’ils vont entreprendre (initiation aux travaux manuels, initiation aux techniques d’animation, initiation au secourisme… ) ; sensibiliser les volontaires à certaines grandes thématiques de société (développement durable, éducation à la démocratie, respect de la différence, relations Nord-Sud…). 3. Une étape de maturation personnelle :L’engagement volontaire doit aussi être une étape pour soi. Grâce à un encadrement personnalisé, chaque jeune est accompagné dans la construction de son projet post-Solidarcité.L’année citoyenne est orientée autour de 4 objectifs spécifiques :1. Redonner à chaque jeune le goût et la possibilité concrète d’exercer sa citoyenneté de façon active et dynamique;2. Permettre le brassage des publics et favoriser la rencontre de jeunes issus de quartiers différents, de milieux socioculturels différents ;3. Offrir à tous les jeunes un plus pour leur avenir en améliorant leur statut socioprofessionnel ainsi que leur statut personnel ;4. Contribuer au développement associatif et au renforcement du "vivre-ensemble".Comment chaque équipe fonctionne-t-elle ?Nous voulons que les jeunes soient acteurs de leur année : ils co-construisent leur programme en trouvant des partenaires liés à leurs thématiques que ce soit pour des chantiers ou des sensibilisations, Il faut que cela soit win-win pour les jeunes et pour l’association partenaire.Pour les jeunes, cela peut être de la valorisation personnelle, l’ouverture aux différents mondes de la solidarité active, l’acquisition de «savoirs», «savoir-être» et «savoir-faire».Du point de vue des partenaires, c’est la concrétisation de projets qui auront un impact positif sur leurs publics cibles respectifs, ils font découvrir leurs actions.Bachelard a écrit que « le monde entier sans un TU ne peut rien donner » ; l’altérité est donc une construction mutuelle. En tant qu’actrice du projet, vous et vos collègues le ressentez-vous comme tel ?Je suis convaincue que la force du projet est le collectif, car cela encourage une conscience de solidarité et d'entraide par la complémentarité des volontaires au sein des équipes. Cela favorise également l'acquisition d'aptitudes sociales. Pour un jeune qui est perdu, savoir que chaque matin un groupe vous attend pour réaliser une activité est un réel moteur pour sortir de l’isolement. De plus avec Solidarcité, les jeunes s’investissent dans le monde actuel de manière positive. Solidarcité est un projet bienveillant, qui assure un encadrement rapproché du jeune et répondant à ses besoins personnels.En savoir plus ou pour faire un don à notre associationCette altérité, véritable force vive de Solidarcité car elle aide beaucoup de jeunes à relever leur ligne d’horizon, conforte davantage cette remarque d’Albert Jacquard : « La tolérance, c’est accepter la différence, l’altérité, c’est s’intéresser à la différence ».Alors, vous ne trouvez pas que l’optimisme est au rendez-vous en 2025 ?Nous remercions la comtesse Emmanuel de Ribaucourt pour la rédaction de cette interview.
Du microscope au télescope
Interroger à ce sujet le baron Yves Jongen, ingénieur en électronique et en physique nucléaire, passionné d’astronomie et d’astrophotographie, fut une aubaine ! Se partageant entre Louvain-la-Neuve, le Vaucluse et le Chili où se situent ses télescopes, il a accepté de nous expliquer son parcours.En tant qu’ingénieur en électronique et en physique nucléaire, vous avez, dès la fin de vos études (1970), dirigé à Louvain-la-Neuve, le centre de recherches du cyclotron. De quoi s’agit-il ?Pour créer un point d’attraction sur le nouveau campus, l’UCL décide que le premier bâtiment sera le « centre de recherches du cyclotron ». Je termine à ce moment mes études avec un double diplôme : électronique et physique nucléaire, et je suis engagé par l’UCL comme responsable technique de ce nouveau centre de recherchesComment en êtes-vous arrivé à redessiner le cyclotron pour l’adapter aux utilisations cliniques ?Même si le centre de recherche du cyclotron de l’UCL était prévu au départ uniquement pour les recherches en physique nucléaire, les physiciens de l’UCL, menés par Pierre Macq ont partagé leur outil avec des chercheurs d’autres disciplines et, sous l’impulsion du Docteur André Wambersie, responsable de la radiothérapie aux cliniques universitaires Saint Luc, nous avons développé une nouvelle méthode de radiothérapie du cancer utilisant des faisceaux de neutrons.En 1982 et 1983, j’ai effectué un séjour sabbatique au « Lawrence Berkeley National Laboratory ». Ce séjour a été pour moi l’occasion de réfléchir en profondeur à mon métier de développeur de cyclotrons. Il m’est apparu très clairement que nous arrivions à la fin de l’âge d’or du cyclotron utilisé comme outil de recherche en physique nucléaire. Il fallait donc repartir d’une feuille blanche, et reprendre à zéro le dessin du cyclotron. C’est la tâche à laquelle je me suis attelé à Berkeley d’abord, puis de retour à Louvain-la-Neuve avec mon équipe au centre de recherche du cyclotron. Avec l’équipe du CRC, nous dessinons un nouveau type de cyclotron pour la production de radioisotopes, dont les performances devraient être très supérieures à ce qui existait à l’époque. Mais aucun industriel belge n’est intéressé à construire et à commercialiser cette nouvelle machine. C’est alors que nait l’idée de fonder une société, qui sera un spin-off de l’université pour réaliser et commercialiser notre nouveau dessin de cyclotron. La société est fondée en mars 1986, et s’appellera Ion Beam Applications, ou IBA.Que représente IBA aujourd’hui ?IBA, aujourd’hui, c’est avant tout 2200 collaborateurs, dont un peu plus de 1000 à Louvain-la-Neuve et le reste un peu partout dans le monde. Le chiffre d’affaires annuel excède 400 M€. A côté des cyclotrons pour la production de radioisotopes médicaux, ou nous sommes toujours un des leaders mondiaux, IBA est aussi devenu le leader mondial dans les équipements pour la thérapie du cancer au moyen de faisceaux de protons : la protonthérapie. Cette méthode de traitement permet de mettre la dose de rayonnement dans la tumeur visée, en mettant beaucoup moins de rayonnement dans les tissus sains proches de la tumeur. De ce fait, les effets secondaires de la radiothérapie sont fortement réduits. Aujourd’hui, près de 150.000 patients ont été traité avec les équipements de protonthérapie d’IBAMais IBA n’est pas qu’une pépite technologique, c’est aussi une entreprise qui montre l’exemple par son rôle social dans le monde économique belge. Le premier actionnaire d’IBA est une société holding coopérative des employés et cadres de la société. IBA a été la première société cotée belge a gagner le prestigieux label de « B Corporation » qui reconnait les sociétés les plus avancées dans le domaine du rôle social des entreprises.Le cosmos et les galaxies lointaines ont aussi capté et captivé votre regard et vos recherches. Comment étudiez-vous le ciel et comment le photographiez-vous ? Je suis arrivé à l’astronomie un peu par hasard, mais c’est devenu une réelle passion pour moi. Je me suis installé un observatoire astronomique en Provence, avec un beau télescope que je peux programmer à distance, sur internet. Et puis, il y a presque 6 ans, je me suis installé un second télescope au sommet d’une montagne au Chili, dans une « ferme à télescopes » créée par deux français. Ce deuxième télescope au Chili, je le programme aussi à distance par internet. Durant des années, j’ai fait de l’astrophotographie, pour montrer les couleurs extraordinaires des nébuleuses et des galaxies lointaines. Et puis, ma vocation de physicien a pris le dessus, et je suis passé à l’astrophysique. Depuis plusieurs années, j’étudie les exoplanètes, c’est-à-dire les planètes qui tournent autour d’autres étoiles que notre soleil, et je mesure avec précision le moment où elles passent devant leur étoile, ce qui permet d’étudier précisément leur orbite et permet parfois de détecter la présence d’autres planètes, pas encore observées, autour de cette étoile.Conclusion : Certains d’entre nous parlent encore de la théorie de la relativité d’Einstein. Mais pour moi, ce n’est pas une théorie, c’est une réalité de ma vie quotidienne ! Si nous ne tenons pas compte précisément des effets relativistes dans nos calculs d’astrophysique, les résultats seront faux : tant dans le domaine de l’infiniment petit que dans le domaine de l’infiniment grand, les mêmes lois nous régissent. Nous remercions Claire de Ribaucourt pour cet article
Profession : juge de paix
Frédéric de Montpellier d’Annevoie de Villermont Licencié en droit et titulaire d’un DES en droit de l’environnement et droit public immobilier, j’ai entamé et poursuivi une carrière d’avocat au barreau de Namur dans un cabinet généraliste, durant dix ans; après la réussite de l’examen d’aptitude professionnelle à la magistrature en 2011, j’ai été nommé substitut du Procureur du roi près le tribunal de première instance de Neufchâteau, avant d’être nommé quatre années plus tard, soit début 2017, juge de paix du canton de Thuin.Philippe de Potesta : Quels aspects de la magistrature vous ont semblé complémentaires ou différents de votre passé d’avocat ? Frédéric de Montpellier : Le barreau et ses trois premières années de stage constitue à mon sens la meilleure école pour un jeune juriste, qui, dans des domaines et des situations très variés et parfois tragiques, va conseiller son client, défendre ses intérêts, le cas échéant dans le cadre d’une procédure contentieuse. D’une certaine façon l’avocat est le premier juge d’un dossier qu’il jaugera et tâchera d’orienter. Le substitut du procureur, qui s’occupe essentiellement des matières pénales, soit qui touchent à l’ordre public, dirige les enquêtes et initie s’il y a lieu les poursuites devant les tribunaux. Bien plus qu’un avocat de l’accusation, il propose une solution de justice en qualité de garant de l’intérêt général. Enfin, un magistrat du siège, tel qu’un juge de paix, a pour mission de trancher les litiges qui lui sont soumis par les parties au procès. Il apporte une solution juridique finale au dossier, sous réserve d’un éventuel recours.PH de P : Comment se déroule une journée typique dans l’exercice de vos responsabilités ?F de M : Le Juge de paix est un juge de proximité comme on dit dans le jargon. Il est revêtu d'une juridiction contentieuse (par exemple les baux, le droit des biens, les copropriétés etc) et d'une juridiction gracieuse (protection des personnes vulnérables, soit les mineurs, les majeurs incapables et les malades mentaux). Chaque semaine, je tiens une audience d’introduction ou de plaidoiries, une audience de conciliation, une audience de cabinet (la protection des personnes), des vues des lieux généralement avec expert (architecte, géomètre, forestier ou agricole), des visites en maison de repos ou dans les hôpitaux (protection des personnes). Soit un quotidien partagé entre le travail purement intellectuel (rédaction de jugements) et un travail de terrain au contact des justiciables où la mission de conciliateur du juge de paix prend tout son sens. Lorsque le juge de paix exerce sa juridiction gracieuse (mineurs, protections des incapables majeurs, des malades mentaux), il est fréquent qu’il tente de mettre du baume sur des relations humaines abîmées ou les blessures de personnes désespérées. Ces contacts permettent parfois de parvenir à leur dire qu’elles sont uniques, et que la grandeur et le sens d’une vie ne se mesurent pas à la performance ou la richesse mais à l’amour que l’on répand, d’abord vers nos proches. Et parfois on assiste à des miracles !Ph de P : Selon vous, quels sont les enjeux majeurs pour la justice face aux mutations de notre société ?F de M : Plusieurs éléments sont essentiels pour qu’une justice efficace soit rendue. Une société juste ne peut exister que si les magistrats ont la capacité de remplir leur rôle dans des conditions optimales. Ces dernières années, on a souvent déploré le sous-financement de la justice. Par ailleurs, l’indépendance fonctionnelle du pouvoir judiciaire doit être garantie, lequel doit être protégé des pressions indues du pouvoir exécutif (on évoque par exemple le fait que les fonctionnaires fédéraux puissent être un jour passé au screening de la Sûreté de l’État). Une autre source d’inquiétude pourrait être consécutive à l’adoption de législations qui attaquent la dignité et l’intégrité humaine, notamment en matière éthique. A l’instar de l’objection de conscience des médecins, qui est de plus en plus remise en cause, le magistrat pourrait être confronté à des cas de conscience.Ph. de P. : Merci beaucoup à vous, Frédéric , de nous avoir partagé votre amour du métier ainsi que vos réflexions à propos de la justice et de notre société actuelle .Interview réalisé par Philippe de Potesta
L’Everest de la presse écrite et de nos démocraties
Les défis actuels de la presse écrite ne sont pas minces : ils sont titanesques. Le bon fonctionnement de nos démocraties repose directement sur la lucidité des opinions publiques par rapport aux grands enjeux de nos sociétés. Or, l’Histoire montre combien la manipulation des opinions publiques est possible, et peut mener à des dérives catastrophiques. La presse libre a joué historiquement un rôle pivot dans les sociétés démocratiques ; grâce à ses rédactions professionnelles, aux grands faits de société, aux débats, à la vie politique, sociale et économique…Un gouvernement vantera toujours son bilan, une entreprise communiquera toujours sur ses actions positives, un parti politique exprimera toujours son analyse des enjeux dans la perspective de son idéologie, idem pour un syndicat. La presse indépendante n’est pas juge et partie. Ses journalistes sont formés à l’esprit critique, bien sûr, la presse n’est pas exempte de biais et d’erreur, mais structurellement, elle n’a des comptes à rendre qu’à ses lecteurs. La qualité de son travail est le gage de sa crédibilité et de son succès. Et ce qui confère à la presse sa liberté, c’est son autonomie économique, c’est en effet grâce aux lecteurs abonnés (au journal ou aux éditions digitales) ou qui achètent leur journal, ainsi qu’aux annonceurs publicitaires, que les journaux peuvent rémunérer les journalistes, agences de presse et tous les autres services indispensables, sans dépendre d’un pouvoir public – politique subsidiant, susceptible d’interférer dans cette autonomie d’action. Une concurrence destructriceSous l’Ère de la presse papier, les revenus étaient au rendez-vous avec un journal papier que les lecteurs achetaient en grand nombre. Le produit se plagiait difficilement. Et puis, surtout, les pouvoirs publics ne le concurrençaient pas. Sous l’Ère internet, le modèle économique a radicalement changé. Les médias internet se commercialisent difficilement, leurs contenus sont facilement plagiés, et les pouvoirs publics leur font une concurrence destructrice. Depuis le début des années 2000, les éditeurs de presse ont investi dans le développement des médias digitaux, sites internet et applications mobiles. Les audiences sur ces médias digitaux sont devenues très importantes, plus importantes qu’elles ne l’étaient sous l’Ère papier. Mais voilà, les revenus générés par cette économie digitale de la presse restent encore aujourd’hui insuffisants pour couvrir les coûts de production et de diffusion des contenus rédactionnels. Et le gouvernement de la Vivaldi, en supprimant brutalement la concession postale pour la distribution des journaux, a porté un coup catastrophique à la presse, à tel point qu’aujourd’hui, les éditeurs ne savent pas comment ils pourront poursuivre l’activité de presse papier au-delà de 2026. Sans une modification majeure des modalités de distribution, le coût du portage des abonnements papier à domicile deviendra trop élevé pour de nombreuses zones géographiques. En ce début 2025, force est de constater que les autorités publiques à tous les niveaux, européens, belges, communautaires, sont en échec quant à la création d’un cadre juridique qui permette à la presse de trouver son modèle économique à l’Ère digitale. À titre d’exemples, la Communauté française (FWB) mène une concurrence destructrice via le site de la RTBF qui freine le marché payant de la presse en ligne, le gouvernement fédéral a supprimé la concession postale avec pour conséquence une explosion des coûts de distribution, l’Europe et la Belgique n’arrivent pas à prendre des mesures juridiques efficaces pour assurer une juste rémunération des contenus de la presse spoliés par les plateformes internationales et les acteurs de l’intelligence artificielle ? Enfin, les autorités de protection de la vie privée rendent très difficile la collecte des données indispensables pour commercialiser les sites d’information. Ère des fake newsLes réseaux sociaux ont permis l’explosion de toutes les formes de manipulations de l’information, depuis les puissances étrangères, en passant par les complotistes, et activistes. Alors qu’en face de ce tsunami de fake news, il faudrait renforcer la presse indépendante, c’est – vous l’aurez compris - l’inverse qui se passe. Le Brexit, les victoires de Donald Trump, l’assaut meurtrier du Capitole, la propagande du Kremlin, les théories complotistes, certaines polémiques autour du Covid, et la montée des populismes de gauche comme de droite témoignent des conséquences inquiétantes de la propagation des fake news. Avec l’intelligence artificielle, nous entrons dans une nouvelle Ère de la manipulation, les montages photos, vidéos, sons, seront monnaie courante, il sera de plus en plus difficile de distinguer le vrai du faux. Dans un tel contexte, on peut penser que les citoyens se référeront de plus en plus aux sources crédibles, professionnelles d’information. On assiste toutefois à deux mouvements contradictoires, alors que les sources d’information professionnelle deviennent de plus en plus importantes pour éviter d’être pollué par les fake news, une partie significative de la population préfère partager des fake news que des informations vérifiées … Infime espoirLa victoire de Donald Trump et l’ascension politique d’Elon Musk (patron du réseau X) ont poussé le dirigeant de Meta à changer de cap : son groupe ne compte plus vérifier la véracité des publications diffusées sur Facebook ou Instagram. L’ouverture des vannes sur X a déjà transformé l’ex-Twitter en une décharge publique. Ces politiques, favorables à l’extrême droite et au populisme, menacent la résilience et les fondements de nos démocraties : rejet des politiques, critique des médias traditionnels, polarisation violente de la société, avec des violences verbales et physiques à la clé. Nos pays se trouvent ainsi fragilisés par leur dépendance aux géants technologiques américains et par l’addiction aux plateformes comme X, Facebook et Instagram. Les patrons des GAFAM pourraient devenir les faiseurs de rois des mouvements radicaux et extrémistes. C’est l’heure du crash-test. Il est désormais évident que les réseaux sociaux sont des armes politiques redoutables. Leurs algorithmes nous enferment dans nos convictions ou nous noient dans les eaux troubles du complotisme et du mensonge éhonté, répété et assumé. Cependant, cette évolution pourrait se retourner contre eux pour autant qu’un sursaut de lucidité habite une majorité de citoyens, les grands annonceurs publicitaires et les gouvernements. La seule réponse aux fake news, c’est une information de qualité en abondance, grâce à un secteur de la presse libre florissant. Pour cela, nos démocraties ont besoin de citoyens en grands nombres qui s’abonnent à une presse de qualité de leur choix, nos démocraties ont besoin d’acteurs économiques responsables, qui investissent leurs budgets marketing dans des médias de qualité, nos démocraties ont besoin de gouvernants qui adoptent des mesures qui permettent l’émergence d’une économie digitale de la presse. L’opportunité d’un revirement historique existe. Reste à la saisir… Dorian de MeeûsRédacteur en chef de La Libre Belgique
Fleur de Changy nous parle du 5e Salon des Arts et du Terroir qui se tiendra à l’ANRB les 15 et 16 février prochains. Une merveilleuse célébration de créativités et de saveurs grâce à la présence de nos membres exposants.
Philippe de Potesta : bonjour Fleur, le prochain Salon des Arts et du Terroir aura bientôt lieu. Vous nous en dites un peu plus ?Fleur : bien volontiers ! Les 15 et 16 février prochains s’ouvriront les portes de la 5e édition de cette exposition. Cette année, nous l’agrémentons d’une nouveauté : les 30 artistes seront accompagnés d’artisans culinaires ! Ce sera l’occasion de découvrir 35 talents toute disciplines artistiques, styles et matériaux confondus, bons amateurs et professionnels, et de goûter à leurs délicieux produits. Philippe : comment sélectionnez-vous les artistes qui exposeront ? D’après un thème particulier ? Fleur : l’idée première est de mettre en avant les talents des membres et tout l’or qu’ils ont dans les doigts. La sélection faite parmi les nombreuses candidatures reçues chaque année n’est franchement pas facile. Nous essayons chaque fois de faire en sorte que les visiteurs, lors de leur visite, aient tous une étincelle pour une œuvre, un style, un matériau, un artiste. Cette année, ils y découvriront donc autant des portraitistes, que des sculpteurs animaliers, paysagistes, photographes, de l’art abstrait, des toiles conçues en matériaux de récupération… Ou encore des supports très particuliers tels que des œuvres lumineuses. L’éventail des disciplines artistiques est donc très large et sans thème particulier si ce n’est présenter les talents des membres de l’Association.Du côté des artisans culinaires, nous avons spécifiquement choisi des petites entreprises : l’artisanal sera donc au rendez-vous. Le savoir-faire et l’amour de ces producteurs pour des ingrédients purs et naturels valent à eux seuls le détour ! Ils sont pour la plupart les producteurs-transformateurs de ce que Dame Nature fait pousser dans leurs potagers, vergers, oliveraies ou vignobles… En prévision de la 6e édition, il est peut-être bon de préciser aux lecteurs que les candidatures peuvent être posées par des membres, leur conjoint et leurs enfants. Les exposants ne sont donc pas tous nécessairement de la noblesse.En ce qui concerne le rayonnement de tous ces exposants, ils ont chacun invité tous leurs clients, professeurs, élèves, etc. à venir admirer leurs dernières œuvres. Cette manifestation est donc ouverte à tous, membres et non-membres, amateurs d’art, de délices… et de patrimoine : la maison du « 25 » est un splendide écrin pour ce type d’exposition !Philippe : si je comprends bien, chaque édition est donc bien différente des précédentes…Fleur : effectivement ! Les Salons des Arts se suivent, mais ne se ressemblent pas. Depuis 2017, nous présentons 24 « nouveaux » artistes et artisans lors de chaque édition, dont certains grands noms de l’art. Les techniques, supports, matériaux… Changent donc à chaque fois. Comme dit plus haut, cette année, les arts graphiques seront assortis des arts culinaires : nous profiterons également de l’espace des JNB tout fraîchement rénové pour présenter des exposants qui raviront les pupilles et les papilles de nos visiteurs ! Du côté des coulisses, l’équipe organisatrice a également évolué : lors des premières éditions, le duo formé avec le baron Henry d’Anethan, alors Secrétaire général, a très bien fonctionné. Depuis quelques mois, un quatuor très féminin a pris place avec Madame Amaury de Troostembergh, Vice-Présidente, Madame Caroline Siraut et Mademoiselle Yolande de Borchgrave, du secrétariat. And last but not least, il est important de signaler que, comme plusieurs activités phares de l’ANRB, l’organisation bénévole permet de verser des bénéfices plus conséquents à Solidaritas.Philippe : observez-vous en général des ventes sur place ou des opportunités pour les exposants ?Fleur : oh oui ! À chaque édition, la plupart des exposants vendent une ou plusieurs œuvres. C’est notre petite récompense : nous aurons réussi à attirer l’attention des amateurs sur l’un ou l’autre talent jusqu’au point qu’il souhaite en garnir son intérieur. Nous espérons toujours que l’un ou l’autre galeriste y fasse aussi quelques repérages… Les 600 à 800 visiteurs présents à chaque édition montrent également tout l’intérêt du public pour ces grands talents. Philippe : le mot de la fin ?Fleur : comme organisatrices, nous n’avons vu la plupart des œuvres qu’en photos. Nous sommes impatientes d’y être parce que, comme chaque exposition, ce week-end artistique sera haut en couleur !5e Salon des Arts et du Terroir, les samedi 15 et dimanche 16 février de 10h30 à 18h30 au siège de l’ANRB. 8€ l’entrée pour les membres, 10€ pour les non-membres, gratuit <18 ans.Merci chère Fleur de nous avoir donné ces très intéressants renseignements qui permettront de mieux comprendre notre visite de ce Salon des Arts. Interview réalisé par Philippe de PotestaPlus d'informations
Un Amiral à la tête de de l’Institut Royal Supérieur de Défense
Même si les Amiraux commencent leur carrière au sein de la Marine avec un passage à bord de nos bâtiments de guerre, ils la poursuivent souvent dans des fonctions d’Etat-major et de direction au sein de la Défense. Ainsi, l’Amiral de flottille Baudouin Coppieters de Gibson a repris depuis peu les fonctions de Directeur Général de l’Institut Royal Supérieur de Défense. Né à Bruxelles en 1970, messire Baudouin Coppieters de Gibson, issu d’une ancienne famille originaire de Courtrai, incarne une longue tradition d’attachement au service de notre Royaume. En 1994, il obtint un diplôme d’ingénieur civil en télécommunications à l’École Royale Militaire (ERM) avant de suivre la formation d’officier de marine à l’École d’application de la marine. L’année suivante, il épousa Anastasie de Ghellinck d’Elseghem, avec laquelle il partage une vie familiale heureuse, enrichie par leurs quatre enfants.Issu d’une lignée militaire, Baudouin ne tarda pas à montrer un intérêt marqué pour les forces armées, perpétuant ainsi les traditions familiales. Son père, Xavier Coppieters de Gibson, ingénieur polytechnicien, fut colonel breveté d’État-Major (BEM), tandis que son grand-père maternel, le comte Maurice de Lannoy, servit comme lieutenant-colonel d’artillerie.Promu lieutenant de vaisseau en septembre 2000, il suit un postgraduat en ingénierie des systèmes d’information à l’École nationale supérieure des techniques avancées de Paris, qui lui confère, en 2002, le brevet d’ingénieur du matériel militaire. Suite à cette formation il rejoint la Direction Générale des Ressources Matérielles (DGMR) et suit ensuite le cours pour candidats officiers supérieurs au Collège de défense. Début 2008, il rejoint le Primula comme commandant en second. Il en devient le commandant en juillet de la même année, participant à des missions nationales et internationales. En 2010, il devient chef de la sous-section lutte anti-mines à la direction générale des ressources matérielles.En juin 2014, il devient commandant en second de la frégate Léopold 1er, participant à l’opération Atalante et à un programme dans le golfe de Guinée. Fin 2015, il lance le projet de renouvellement des capacités de lutte anti-mines, qui aboutit, en mars 2019, à l’attribution des contrats pour 12 navires équipés de drones au consortium Belgian Naval & Robotics.Le 15 mai 2019, il devient commandant de la frégate Louise-Marie et rejoint ensuite l’État-major jusqu’en juillet 2024 dans la gestion des systèmes navals et les programmes de renouvellement des capacités maritimes.Il est finalement nommé directeur général de l’Institut royal supérieur de défense, qui est, pour le ministère de la Défense, d’une part le centre d’étude et de réflexion dans le domaine de la sécurité et de la défense, et d’autre part le coordinateur et le facilitateur des activités dans le domaine de la recherche, du développement et de l'innovation.En Belgique, le grade d’amiral de flottille est le premier grade parmi les officiers amiraux.Au nom de tous ses membres, l’ANRB félicite chaleureusement Baudouin Coppieters de Gibson pour sa nomination et lui souhaite bon vent dans ses nouvelles fonctions, en particulier à l’heure où la Marine belge se prépare à relever les défis stratégiques de demain.Nous remercions le comte Pierre-Alexandre de Lannoy pour la rédaction de cet article.
Monsieur Adriaan Jacobovits de Szeged, ancien ambassadeur, entre autre, en poste en Russie, Ukraine et Moldavie, était l’invité des Conférences des Midis Culturels.
Il avait choisi comme thème de sa conférence : "La situation politique en Russie aujourd’hui ". Retrouvons ici les grandes lignes de son développement. Adriaan Jacobovits de Szeged a débuté sa conférence en affirmant que, bien que la Russie soit en partie située en Europe, elle n’est pas occidentale. Il a cité son professeur russe à l’université de Leyde, qui disait que la Russie devait être perçue comme un monastère, avec sa propre religion et sa propre culture. Selon cette vision, les habitants de ce "monastère" sont convaincus que leur culture est supérieure à celle d’un Occident qu’ils jugent décadent. Ce "monastère" est protégé de son environnement hostile par une force armée.L’orateur a souligné la résilience du peuple russe, sa patience — une qualité dont, selon eux, nous pourrions tirer des enseignements — et l’absence de la mentalité américaine « Si vous pouvez l’imaginer, vous pouvez le faire. » Pour les Russes, l’homme est soumis au destin, contre lequel il est inutile de lutter. L’influence de l’Église à travers les siècles a probablement joué un rôle à cet égard : Dieu décide, et il faut accepter son sort. L’individu se soumet à l’État, qui est vu comme seul capable de subvenir à ses besoins.Bien sûr, ce sont là des généralités. Heureusement, il existe des exceptions individuelles.Le régime actuel de la Russie, où le pouvoir est concentré entre les mains des services secrets dirigés par Poutine, est exceptionnel, même pour la Russie. Pendant l’ère soviétique, la police secrète était subordonnée au Parti.L’organe le plus important en Russie est le Conseil de sécurité, composé de quatorze membres, sous la présidence de Poutine, où sont prises toutes les grandes décisions. Cet organe est majoritairement constitué de membres des services secrets, de l’armée et de la police. À titre de comparaison, dans le Politburo de l’ère soviétique, le chef du KGB n’était presque jamais membre. Le Conseil de sécurité est alimenté par l’administration présidentielle, le principal organe d’État, qui prépare les décisions dans tous les domaines. Les ministères, eux, exécutent ces décisions.Adriaan Jacobovits a ensuite abordé la situation économique et sociale de la Russie : une croissance économique d’environ 3,6 %, principalement due aux énormes dépenses de l’État dans l’industrie militarisée, mais aussi en faveur de ses citoyens. Ainsi, un soldat combattant en Ukraine reçoit l’équivalent de 2.000 € par mois, un montant bien supérieur au salaire moyen. Dans de nombreuses régions, il peut également recevoir une prime pouvant atteindre 1.000 € s’il se porte volontaire. En cas de décès, sa famille touche environ 50.000 €, ou 30.000 € en cas de blessure grave. Ces compensations sont la principale motivation pour s’engager dans le conflit. Cependant, ces dépenses entraînent une inflation, actuellement autour de 8,6 %.Le pétrole et le gaz demeurent les principales exportations. Si les exportations de pétrole continuent par des moyens détournés, Gazprom a enregistré pour la première fois depuis 1990 une perte, car les exportations vers l’Europe, son principal client, ont presque totalement cessé. Avant la guerre en Ukraine, l’Europe importait environ 175 milliards de mètres cubes de gaz par an, dont il ne reste qu’une fraction (environ 28 milliards) destinée à la Hongrie, à la Slovaquie et à l’Autriche. Poutine a ordonné la construction de gazoducs pour desservir le marché intérieur, mais cela prendra du temps. La Chine pourrait acheter 30 milliards de mètres cubes via un gazoduc cette année, ainsi que du gaz naturel liquéfié, mais les négociations sur un deuxième gazoduc sont au point mort, car la Chine refuse de payer les prix souhaités par la Russie.Poutine prétend souvent que la Russie, avec sa taille, ses ressources et son peuple talentueux, peut se suffire à elle-même et n’a pas besoin du reste du monde. Cette mentalité, qui dépasse Poutine, condamne inévitablement la Russie à rester en retard. À une époque de développement technologique rapide, les échanges mondiaux sont essentiels pour rester compétitif.Les autorités russes identifient deux grands problèmes : le déclin démographique et le manque de main-d’œuvre. Pour y remédier, elles accordent des aides financières aux familles nombreuses. Ceux qui ont trois enfants ou plus sont exemptés de service militaire. Une loi récente rend même la promotion du "sans-enfant" passible de sanctions. L’exode d’environ 800.000 Russes vers l’étranger et les pertes militaires aggravent cette pénurie de travailleurs.Un autre problème majeur est l’exclusion de la Russie du système de paiements internationaux "Swift", rendant difficile le règlement des importations ou des exportations.La Russie revient à ce qu’elle appelle des "valeurs traditionnelles", ce qui inclut l’opposition à l’avortement et à l’homosexualité. Dans les écoles primaires, les cours de "sciences familiales" sont obligatoires et prônent les valeurs traditionnelles : pourquoi fonder une famille, comment se comporter envers ses parents et grands-parents, etc. Des cours d’instruction militaire sont également dispensés, visant à former des "patriotes".Sur le plan international, la Russie aspire à influencer les politiques mondiales et à maintenir une sphère d’influence à ses frontières, notamment dans ce qui était autrefois appelé "l’étranger proche", maintenant désigné comme "l’espace post-soviétique". Ce territoire inclut naturellement, selon Poutine, "ce qu’on appelle aujourd’hui l’Ukraine", qu’il considère comme partie intégrante de la Russie. Poutine ne s’arrêtera pas tant que l’Ukraine ne deviendra pas, comme la Biélorussie, un "État uni" avec la Russie.Cependant, comme l’a dit récemment un chercheur américain : "Les aspirations de la Russie ne correspondent pas à ses capacités."Nous remercions Monsieur Adriaan Jacobovits de Szeged pour ce partage de réflexion.
Framboise Boël, à la croisée des chemins professionnels “Muscler ma confiance en la vie en apprenant à écouter mon intuition”
Avocate au Barreau de Bruxelles depuis 2001, médiatrice agréée, Framboise Boël a toujours été passionnée par l’humain. Sa formation de médiatrice, renforcée par l'expérience acquise en siégeant au sein de conseils d'administration, lui a permis de développer une écoute active, le goût des solutions pragmatiques et équilibrées, la capacité à révéler les talents et un optimisme créatif. Ces compétences, elle les met au service des personnes qu’elle accompagne depuis 2021 dans le cadre de leur transition professionnelle. Philippe de Potesta : Framboise, qu’est-ce qui vous a encouragé à développer une nouvelle activité professionnelle passé quarante ans ? Framboise : Ultra cartésienne, diplômée du secondaire en math-sciences fortes, j’ai choisi d’étudier le droit et suis devenue avocate. Tout allait bien jusqu’à ce que j’aie des enfants. Avoir des enfants, pour une personnalité anxieuse qui tente désespérément de contrôler son univers, c’est un drame absolu. Imaginez un ferry condamné à prendre la mer un soir de tempête, les portes-rampes grandes ouvertes. Après la naissance prématurée de mon fils, j’ai atterri en catastrophe sur la table d’un ostéopathe, qui m’a prescrit de muscler ma confiance en la vie en apprenant à écouter mon intuition. J’ai commencé à me connecter à moi-même, à écouter mes émotions et mes sensations, à prendre des décisions « justes » pour moi. Je me suis lancée. D’abord modestement. Puis de plus en plus franchement. J’ai quitté après 15 ans le cabinet d’avocat dans lequel j’avais fait mes débuts pour fonder mon propre cabinet. Puis, j’ai enfin osé m’avouer que le conflit, cela use. J’ai eu la chance de suivre une formation donnée sur l’accompagnement à la transition professionnelle, fondée sur l’Ikigai, une très ancienne philosophie japonaise. Philippe de Potesta : Qu’est-ce donc que l’IKIGAI ? Framboise : Selon cette philosophie japonaise millénaire, ce qu’on fait le mieux est à la rencontre de quatre cercles : ce qu’on aime faire, ce qu’on fait très bien, ce dont le monde a besoin et les métiers pour lesquels on peut être rémunéré. L’accompagnement dans la recherche de sa raison d’être, « Ikigaï » en japonais, aide à prendre conscience de ses ressources internes, et de ses compétences pour permettre de s’aligner sur ce qui est essentiel pour soi. L’Ikigai est un puissant outil, que j’utilise tant avec des collectivités (demandeurs d’emploi, des classes du secondaire et des entreprises familiales) qu’avec des individus, à tous stades de leur vie professionnelle. Concrètement, j’accompagne mes clients en cinq séances d’1h30, entrecoupées de séances de préparations à domicile, chaque séance étant consacrée à un des cercles de l’Ikigai puis à la synthèse pratique de celui-ci. L’ikigai, c’est un cheminement. Dès lors, chaque fois que la météo le permet, j’accompagne des gens à la recherche d’un métier qui leur ressemble, en marchant avec eux dans la Forêt de Soignes.Philippe de Potesta : Un conseil pour nos lecteurs, jeunes et moins jeune ?Je vous ai raconté comment l’intuition m’avait permis de découvrir une voie à laquelle je n’aurais jamais pensé et de déployer mes ailes. Grâce à elle, j’ai découvert l’Ikigai.Et vous ? En suivant chacun des cercles de l’Ikigai, insufflez un peu de ce qui vous met en joie dans votre quotidien. En période de transformation, c’est essentiel de vous aménager des oasis de plaisir, que ce soit lire, courir, vivre un moment de qualité en famille ou entre amis, la pratique d’un hobby, ... Faites-vous du bien, soyez un bon ami pour vous-même. Vous avez du talent, que ce soit la bonté, le leadership, le goût de la beauté. Ce que vous faites facilement, comme si vous aviez des ailes, vous est tellement familier qu’il vous semble peut-être banal. Détrompez-vous.. Ce pourquoi les gens vous demandent conseil, c’est un pouvoir singulier, qui vous vient naturellement et sur lequel vous pouvez compter pour bâtir à terme un projet professionnel. Contribuer au monde permet de donner du sens à notre vie. C’est le cercle le plus important de l’Ikigai. Vous êtes déjà en mesure d’apporter au monde ce dont il a besoin (Justice, bienveillance, lutte pour le climat ou contre la pauvreté, égalité des chances pour tous, …) Même sans être actif sur le marché de l’emploi, vous pouvez agir bénévolement, au niveau de votre cercle d’intimes, des associations qui vous tiennent à cœur. Avez-vous conscience de l’extraordinaire outil dont vous êtes doté ? L’Intuition, cette boussole qui apporte des solutions sur-mesure à vos besoins. Suivez-la, cette petite voix et apprenez à vous connaitre : restez connecté à ce que vous aimez, ce que vous savez faire et aux choses essentielles pour vous, à votre Ikigai.Vous pouvez vous faire confiance, la réponse est en vous.La vie est un fleuve, disait ma grand-mère la Comtesse René Boël. On peut tenter de maitriser ce qui nous arrive en nageant à contre-courant. On fait du sur-place, c’est épuisant. Ou se laisser porter par le courant, en (se) faisant confiance. C’est sur ce chemin que je vous souhaite de voyager. Interview réalisé par Philippe de Potesta
Qui se cache derrière Margaux…
Passionnée par la cuisine depuis mon plus jeune âge, j’ai toujours adoré créer et composer des recettes avec ce que j'avais sous la main. Très rapidement, j'ai compris qu'il ne s'agissait pas seulement d'un savoir-faire, mais aussi d’un art : un mélange d’ingrédients, des saveurs, d’herbes fraîches.Afin de partager cette passion avec vous, j’ai décidé d'écrire 3 livres de cuisine. Sur mon site et mes réseaux sociaux, vous retrouverez également de nombreuses recettes qui pourront vous inspirer. Rochers à la noix de coco : Ingrédients pour 12 rochers :3 blancs d’oeufs80g de sucre de canne180g de poudre de coco Préparation :Allumez le four à 180°.Séparez les blancs et les jaunes d’oeufs.Mélangez les blancs d’oeufs avec le sucre et la poudre de coco.Formez des petites boules de tailles identique.Déposez les rochers sur une plaque de cuisson et faites-les cuire pendant 15-20 minutes.Merci à Margaux de Biolley pour cette délicieuse recette de rochers à la noix de coco et son talent culinaire inspirant !
REGARDS CROISES
Deux enseignants partagent leur passion pour la lecture comme moyen de résistance face aux distractions numériques.Je constate avec mes collègues à quel point l’écran pousse les adolescents à être sans cesse à l’extérieur d’eux-mêmes en sautant d’une vidéo à l’autre et en étant constamment distraits par les notifications incessantes. La lecture, au contraire, par l’effort silencieux et solitaire qu’elle propose est un véritable chemin pour se reconnecter à son intériorité, lieu des grands rêves et des grands désirs, si importants au seuil de la vie adulte.Je suis émerveillée par l’imagination, la créativité et la vivacité de mes élèves qui sont de grands lecteurs. Je suis persuadée que la compagnie des livres stimule leur imaginaire et nourrit leur être. Cet été, j’ai d’ailleurs été marquée par une phrase du pape François (*) consacrée à la lecture. Elle nous donne de « voir à travers les yeux des autres », d’acquérir « une largeur de perspective qui élargit notre humanité ».Pour eux, j’en suis persuadée, la littérature est une école de compassion et d’empathie. (*) lettre du Pape François sur le rôle de la littérature dans la formation.Annonciade d’Otreppe, professeur d’histoire à Agnes School. buibi« Chaque lecture est un acte de résistance » (Daniel Pennac).Il existe encore des écoles-bastions, en primaire comme en secondaire, qui ont choisi d’entrer en résistance face au déficit en lecture des nouvelles générations. Il existe encore des élèves éclairés qui à 10 ans se réjouissent de découvrir « Oscar et la Dame rose » ou « Wonder », et d’autres qui à 17 ans sont profondément marqués par l’exigence ciselée des 700 pages d’un livre-univers comme « La Horde du Contrevent ». Il existe encore des enseignants lucides qui n’ont pas oublié qu’il importe de toujours donner du sens à chaque lecture imposée par l’école : au-delà du plaisir ou de l’effort intellectuel, il s’agit de trouver un moteur assez puissant pour motiver un enfant ou un adolescent à plonger dans l’imaginaire d’un auteur. Un élève qui lit « Douze hommes en colère » revêtira en classe les habits d’un avocat en herbe et tentera le temps d’une plaidoirie d’aider un jeune accusé au préalable si mal défendu. Un élève qui lit « La Nuit des Temps » rivalisera d’ingéniosité lors d’un concours d’exposés à créer sa propre neo-utopie adaptée à la société moderne. Un élève qui lit « La Mort du roi Tsongor » verra défiler sous ses yeux un millénaire de mythes et d’images universelles qui structurent sa psyché. Il existe encore des élèves qui lisent. Cédric de Séjournet de Rameignies, professeur de français à l’Institut Saint-André d’IxellesNous remercions Claire de Ribaucourt pour ces propos recueillisCet article fait écho à celui publié dans la circulaire d'octobre 2024 (accessible uniquement aux membres) : « La lecture agrandit l’âme » - Voltaire.
Un mariage parfait entre passion et profession
Diane Kervyn de Volkaersbeke directrice d’Antica Namur a idéalement conjugué son expertise en management et son amour pour l’art . Elle qui a eu la chance de grandir dans une famille où l’art et l’esthétique occupaient une place essentielle. Après son diplôme en business management , elle a suivi deux formations en arts décoratifs à Sotheby’s Educational studies à Londres . Son mariage avec un Florentin l’a ancrée définitivement dans l’inestimable richesse artistique de la Città Eterna ! Philippe de Potesta: Quels critères utilisez-vous pour sélectionner les exposants chaque année ?Diane Kervyn de Volkaersbeke :Chaque participation au salon commence par une demande de candidature, qui doit être approuvée par un comité d’experts. Nous disposons d’une charte stricte que chaque exposant s’engage à respecter, notamment en ce qui concerne la sélection rigoureuse des œuvres présentées. Pour chaque édition, nous veillons à examiner minutieusement chaque demande, tout en maintenant un équilibre entre les différentes spécialités afin d’offrir une palette variée et harmonieuse.Avant l’ouverture, un comité composé de 30 experts parcourt les stands pour procéder au vetting : un contrôle rigoureux destiné à vérifier la conformité et l’authenticité des œuvres exposées. Ce processus garantit aux visiteurs une expérience de qualité.Ph de P: Qu'est-ce qui vous passionne le plus dans l'organisation d'un tel événement et dans toutes les formes d'art qui y sont exposées ?D.Kde V:Allier l’effervescence du monde des affaires et de l’organisation à un environnement profondément artistique est une source de bonheur. C’est l’équilibre entre professionnalisme et créativité qui alimente ma passion et donne sens à mon parcours.Ce qui me passionne dans l’organisation d’un salon, c’est la diversité des tâches et des défis à relever. De la recherche de clients à la négociation commerciale, en passant par la quête de partenaires et sponsors, sans oublier la communication et la coordination globale, chaque aspect me stimule. J' apprécie particulièrement de pouvoir exercer ce métier d’organisatrice dans un environnement où l’art et l’esthétique sont au cœur de chaque projet. J’aime la grande richesse des rencontres inspirantes avec les antiquaires, galeristes, artistes et personnalités du monde de l’art qui me transmettent leur passion et leur expertise. Ce que j’aime par-dessus tout, c’est voir le fruit de ce travail d’un an prendre vie : un salon abouti ,un écrin de beauté, où les exposants et visiteurs y trouvent à chaque fois leur bonheur. La nature éphémère d’un salon peut être frustrante, car après plusieurs mois de préparation intense, tout disparaît en un instant ! Cependant, cette fin laisse place à de nouveaux projets, une dynamique renouvelée et l’opportunité de se réinventer.Ph de P: Quels efforts sont faits pour sensibiliser les jeunes à l'art et aux antiquités ? Avez- vous songé à proposer des outils pédagogiques ou des initiatives spécifiques pour attirer une nouvelle génération d'amateurs d'art ?D.Kde V:Tout en restant les ambassadeurs des antiquaires, nous avons également pris une orientation marquée vers le XXᵉ siècle (design, tableaux et sculptures modernes,.. ) et vers l'art contemporain afin de répondre aux tendances du marché .Grâce à cette offre, le salon attire un public intergénérationnel et dynamique. Nous invitons régulièrement des écoles d'art et d'ébénisterie à visiter le salon avec leurs professeurs.De plus, afin de sensibiliser une nouvelle clientèle, nous organisons plusieurs visites guidées pour des groupes de jeunes, âgés de 25 à 30 ans. Des experts, des guides-conférenciers ou des antiquaires les accompagnent à travers le salon, leur faisant découvrir leurs coups de cœur et partagent leur expertise.Ph de P: Les détails complexes des œuvres anciennes s' opposent souvent à la surface lisse des œuvres contemporaines et minimalistes de plus en plus présentes à Antica Namur. Est-ce bien apprécié et perçu par les visiteurs ?D.Kde V:Cette diversité est perçue de manière positive par nos visiteurs. Nombreux sont ceux qui apprécient la richesse et la profondeur des œuvres antiques, où chaque détail raconte une histoire et reflète un savoir-faire traditionnel. Cependant, l’art contemporain et plus minimaliste, avec ses lignes épurées et son approche parfois plus conceptuelle, attire également une clientèle en quête de nouvelles formes d’expression et une esthétique plus moderne. Cette diversité crée une dynamique intéressante, où chaque visiteur peut s'identifier à l'un ou l'autre style, ou encore apprécier les deux. Elle permet aux visiteurs de découvrir et de dialoguer avec des créations aux langages très différents. Cette cohabitation enrichit l'expérience globale du salon, en offrant une palette variée qui satisfait à la fois les amateurs d'art classique et les passionnés de tendances contemporaines.Ph de P: Et pour terminer , quel est l'impact économique et culturel de la foire et son rayonnement pour la Province de Namur et au-delà ?D.Kde V: La ville de Namur est en fête lorsque Antica ouvre ses portes, un événement qui dure plus de 3 semaines (avec le montage du salon). Les drapeaux Antica flottent fièrement dans la ville, et le secteur horeca est en plein essor. En novembre, les gîtes et restaurants de la ville affichent souvent complet, attirant une clientèle enthousiaste. Les exposants ou visiteurs qui s’y prennent trop tard doivent faire preuve de créativité, en s’éloignant de la ville pour se tourner vers les campagnes ou les villes voisines.Les musées de la ville et de la province de Namur bénéficient également de cette affluence, en grande partie grâce à leur présence au salon, où un stand leur est spécialement dédié.Il est important de souligner tout l’emploi créé en amont En effet, une équipe de plus de 60 personnes se charge de la logistique ,construction ,montage et aménagement des stands, sans oublier d’autres services tels que la sécurité, le catering et bien sûr toute l’équipe d’organisation chez Easyfairs. De plus, le salon Antica est l'événement phare de l’agenda des foires du hall d’exposition de Namur Expo.Nous remercions Philippe de Potesta pour cet article
Guénola de Lhoneux : Une nouvelle ère pour le bénévolat éducatif en Belgique
Après plus de 15 ans passés dans le milieu scolaire en tant qu’institutrice et conseillère éducative, Guénola de Lhoneux décide début 2023 de fonder l’association Les ABS – Aidants Bénévoles Scolaires. Elle est aussi conseillère pédagogique au sein de la Fédération de l’Olivier qui compte les pouvoirs organisateurs d’une vingtaine d’écoles du réseau libre. Sa mission ? Ouvrir les écoles à la culture du bénévolat. Concrètement ? Offrir une aide bénévole sur mesure aux enseignants pendant le temps scolaire et les soutenir dans leur travail pédagogique. Brigitte Ullens de Schooten : La fondation des Aidants Bénévoles Scolaires se fait dans un contexte actuel plutôt tendu au niveau de l’enseignement. Où vous situez-vous dans la mission éducative ? Guénola de Lhoneux : C’est vrai que mon système de bénévolat s’inscrit dans une période contextuelle, disons, difficile. Nous vivons une grosse période de changement et de réformes et le système scolaire est à ‘flux tendu’. Mais en réalité le bénévolat scolaire est une démarche ‘win-win’, bénéfique à la fois pour les écoles et pour la société. L’enjeu social est évident, et reconnu par les élus, parce qu’il y a des écoles partout, que les problèmes sont partout, quels que soient les niveaux socio-économiques.BUdS : Quelle place occupe le bénévole à côté de l’enseignant et quelle est celle des ABS à côté des directions d’écoles ?GdL : Un bénévole ne remplace pas l’enseignant qui reste l’expert en apprentissage. Le bénévole est là pour aider l’enseignant, un élève ou un groupe d’élèves, dans un bon équilibre pédagogique. Et il ne s’agit pas non plus de mettre un bénévole derrière un enfant spécifique à la demande des familles. La demande doit venir de la direction qui identifie une mission dans une classe. Dans ce cas précis un projet peut se construire.Actuellement nous accueillons les bénévoles qui sont assez nombreux vu notre référencement sur internet et nous répondons aux demandes des écoles, mais l’objectif est plutôt de se déployer comme facilitateur, donc d’être au service des écoles et de les accompagner à recruter elles-mêmes leurs bénévoles, à les gérer et les pérenniser. Notre but n’est pas de centraliser, mais d’assister, quel que soit le réseau, que ce soit en maternel, en primaire ou dans le secondaire, où nous entamons d’ailleurs une première expérience.BUdS : Et si demain je souhaite être bénévole, y a-t-il des contraintes particulières ?GdL : Nous recrutons tout profil sensible à la cause scolaire, ayant une parfaite maitrîse [KU1] du français, des affinités avec les enfants et apte à travailler en équipe avec des adultes. Si le bénévole vient du monde de l’éducation c’est un plus… Nous n’observons pas de problèmes au niveau des missions elles-mêmes. Quant à l’offre de bénévoles, elle est importante, mais elle est irrégulière, car les bénévoles postulent dans différentes associations ; nous devons être réactifs quand un profil nous convient.L’expérience montre que le recrutement doit rester local et c’est pour cela que nous souhaitons que progressivement ce soient les écoles qui gèrent leurs bénévoles et les fidélisent.BUdS : Actuellement vous répondez aux demandes des directions et vous proposez aussi des accompagnements sur mesure ?GdL : Il y a énormément de besoins. Le but est d’offrir du soutien. Si une direction nous demande d’assister un enseignant sur le fil, la présence du bénévole va être bénéfique : tout le monde est gagnant. Le bénévole s’investit dans une mission que les enseignants accueillent favorablement, bien plus qu’avant. Les mentalités évoluent et c’est aussi une piste pour anticiper l’absentéisme.On sait que le monde de l’enseignant s’est complexifié car les jeunes ont changé et la structure n’a pas évolué dans le temps. Il y a plus d’élèves allophones dans les classes mais aussi plus d’enfants à besoins spécifiques.BUdS : Le chantier de l’éducation est énorme. 2 ans que l’association existe. Que faudrait-il aujourd’hui ?GdL : Reconnaître [KU2] que le bénévolat favorise le bon fonctionnement d’une société, ce qui s’illustre un peu plus dans les pays anglo-saxons où les écoles sont plus ouvertes. Par ailleurs ma volonté est de fonctionner avec la Fédération Wallonie-Bruxelles et de travailler en cohésion.Ensuite, entendre les acteurs de terrain dans leur charge. Notre système provoque des inégalités scolaires exemplaires et un profond sentiment de culpabilité chez les enseignants !3% des enseignants seulement se sentent reconnus… On ne peut pas rester sans rien faire !Contact : www.lesabs.be
Ophélie t'Serstevens : le succès d'une passion
Comment Ophélie t’Serstevens a su transformer ses rêves et sa passion en un succès professionnelOphélie t’Serstevens, 30 ans, a fait le choix audacieux de se consacrer pleinement à la poursuite de ses rêves. En 2016, animée par un enthousiasme inébranlable pour l’art, elle décide de relever un défi : faire de sa passion son métier, grâce à l’influence des réseaux sociaux. Elle commence alors à faire de son visage une véritable toile où s’exprimerait toute la singularité de sa créativité.C’est ainsi qu’est né son pseudonyme « Simple Symphony ».Un an plus tard, son pari est couronné de succès. L’une de ses vidéos suscite un engouement mondial générant des centaines de millions de vues. Son audience se développe rapidement et, en quelques mois, plus d’un million de personnes la suivent à travers ses différents réseaux sociaux. Ce succès marque le début d’un parcours fulgurant, jalonné de projets passionnants et de collaborations prestigieuses.Philippe de Potesta : Ophélie, après plusieurs années d’expression artistique via les réseaux sociaux, vous avez mis à profit votre sens de l’innovation et votre expertise pour mettre en lumière de nombreux artistes. Pouvez-vous nous en dire plus ?Ophélie t’Serstevens : Tout à fait. Après quatre années dans ce domaine, j’ai décidé de réorienter mon projet professionnel. L’exposition constante sous les feux des projecteurs avait mis à mal ma santé mentale, et j’éprouvais le besoin de prendre du recul. J’avais également le sentiment d’avoir atteint mes objectifs et d’avoir exploré un maximum de possibilités créatives. Grâce à la notoriété que je m’étais construite, de nombreuses portes se sont ouvertes à moi, et forte de mes connaissances des réseaux sociaux, j’ai décidé de me lancer dans une nouvelle aventure.C’est donc fin 2019 que j’ai pris la décision de passer de la lumière à l’ombre : cette fois, c’est moi qui allais mettre en avant de nombreux artistes talentueux.Je lance alors une toute nouvelle page sur les réseaux sociaux avec une identité visuelle propre.Mon rôle consiste à démarcher des artistes s’illustrant dans des disciplines variées allant de la peinture à la sculpture, en passant par la pâtisserie, le bricolage, et bien d’autres formes artistiques, afin de leur proposer une collaboration. Le but étant de partager le processus de création de leur art sur cette nouvelle page sous forme de vidéo.Une fois leur contenu réceptionné, je le personnalise et retravaille le montage, j’y ajoute également des sous-titres, ou une voix-off explicative. Je publie jusqu’à 10 vidéos par jour, toutes monétisées grâce à des pauses publicitaires.En moins d’un mois, l’engouement a été tel que j’ai dû créer ma société en urgence, ce qui me permit de me consacrer pleinement et sereinement à cette nouvelle activité.Aujourd'hui, près de cinq ans plus tard, je collabore avec plus d’une centaine d’artistes issus des quatre coins du monde.Ils bénéficient non seulement d’une compensation financière, mais aussi d’une immense visibilité grâce à la plateforme que je leur offre. En effet, la communauté que j’ai créée compte près de 7 millions d’abonnés, et les contenus que je diffuse génèrent plus de 2 milliards de vues par an.Au départ, j’ai dû m’entourer pour faire grandir rapidement ce projet, en recrutant trois employés. Actuellement, je parviens à tout gérer seule, en faisant appel à des freelances pour des tâches spécifiques.Mon métier me permet de vivre en tant que « digital nomade », je peux travailler tout en voyageant, ce qui me procure une très grande liberté!Ainsi, ma passion pour l’art continue de s’enrichir à travers le succès et la promotion de ces artistes, tout en contribuant à mon propre épanouissement professionnel et personnel.J’apprécie le fait de ne plus être sur le devant de la scène, et c’est pourquoi je choisis de rester discrète sur l’identité de cette page sur les réseaux sociaux.Mais si un jour nos chemins se croisent, chers lecteurs, je serai ravie de vous en dévoiler davantage!Philippe de Potesta : Quel serait le mot de la fin que tu adresserais à ceux qui hésitent à se lancer dans un nouveau projet ou à se réorienter ?De nos jours, il est tout à fait possible de réussir sa vie sans nécessairement suivre un parcours académique classique. Le monde évolue rapidement, et les opportunités sont nombreuses.Lorsque je repense à mes débuts, me maquillant dans un coin de ma chambre chez mes parents, et que je vois aujourd’hui ce que j’ai accompli en étant à la tête d’une entreprise ayant généré des millions d’euros de chiffre d’affaires, mon parcours témoigne que tout est possible.Alors si vous avez un projet, aussi fou soit-il, lancez-vous. Le véritable secret du succès réside dans l’audace, l’action, et la persévérance.Et surtout, au diable le regard des autres !Nous remercions Philippe de Potesta pour cette interview.
Le Pape François à Louvain-La-Neuve
Le Pape arrive dans sa modeste papamobile blanche immatriculée SCV1 qui s’arrête plusieurs fois en chemin pour saluer et bénir des enfants et des moins valides. Il est accueilli par Françoise Smets, Rectrice de l’UClouvain, Luc Sels, Recteur de la KULeuven, Mgr Luc Terlinden, Archevêque de Malines-Bruxelles et Grand Chancelier de l’Université, ainsi que par une haie joyeuse d’étudiants équipés de leurs plus beaux attributs : drapeaux et bannières, toges et capes, calottes, … Il salue ensuite les autorités de l’université et de la ville et est invité à signer le Livre d’Or.Le Pape arrive dans l’Aula Magna au son de chants et de musique inspirés de “Laudato Si” , qui est le thème de l’après-midi. La Rectrice rappelle la naissance de l’UCLouvain en 1425 qui fut consacrée par une bulle papale de Martin V et un film reprend quelques grandes étapes de son développement jusqu’à ce jour. Après son discours centré sur le changement climatique et le rôle qu’une université peut jouer pour le combattre, la parole est donnée à la communauté d’étudiants qui avaient rédigé une lettre à l’attention du Pape avec pour fil conducteur “Laudato Si”. Cette lettre, soignée et dense, est lue avec cœur par la dramaturge Geneviève Damas. Elle évoque les grandes interrogations écologiques et sociales de notre temps. Elle interpelle le Pape en particulier sur la place de la femme dans l’église et termine sur l’exemple inspirant de Saint François d’Assise, qui est aussi le patron de la paroisse universitaire. Le Pape souligne alors les dominations de notre temps comme la guerre et la corruption (« le diable - l’argent - rentre par les poches ») et invite à l’espérance et à la gratitude pour la création que l’homme doit soigner avec urgence. Il souligne la beauté du don et le défi du développement intégral qui est un appel à la conversion. Il explique que la femme est « accueil fécond, soin et dévouement vital » et que, avec ses études universitaires, elle (comme l’homme) grandit dans « la recherche, l’amitié, le service social, les responsabilités civiles et politiques, les expressions artistiques ». Il insiste sur le sens à donner aux études, le diplôme universitaire étant l’attestation d’une capacité à contribuer au Bien Commun et à rechercher la vérité. Il termine en demandant de prier pour lui ou, pour le moins, de lui « envoyer de bonnes ondes ».Cette rencontre se conclut par un long et chaleureux standing ovation après quoi le Pape est invité à écrire un vœu sur un feuillet qui est fixé sur l’« arbre des 600 ans » et qui sera compilé avec les autres pour devenir un manifeste à publier le 9 décembre 2025, jour du 600e anniversaire.Après sa bénédiction, le Pape se rend vers le parking de l’Aula Magna. Il reçoit une calotte, salue la foule, serre des mains et bénit à nouveau de nombreux enfants et personnes moins valides.On apprend par la suite que l’UCLouvain a diffusé un communiqué exprimant « des convergences de fond, mais aussi une divergence majeure en ce qui concerne la place de la femme dans la société ». Ceci fera certainement l’objet d’un dialogue qui se poursuivra entre les parties.La rencontre se termine, la tête et le cœur de chacune et chacun remplis de ce riche échange. Et la visite du Pape de se poursuivre pour culminer le lendemain dimanche à la messe solennelle célébrée avec 39.000 fidèles au stade Roi Baudouin.Nous remercions le baron van Rijckevorsel pour cet article
Publi-reportage
Pourquoi avez-vous créé une entreprise dans le secteur funéraire ? En d’autres termes, quels étaient votre constat et votre objectif ?C-A. Greindl :Les traditions, les rites pour organiser des funérailles ont fortement évolué au cours des dernières années. Il y a vingt ans, lors d’un décès, la famille contactait les pompes funèbres pour résoudre les problèmes logistiques et s’adressait au curé pour les guider dans la préparation des funérailles.La cérémonie religieuse et le deuil du défunt primaient le plus souvent, au détriment de la personne elle-même, de sa personnalité, de son parcours de vie.Pour mener à bien notre projet d’entreprise, nous avons voulu bien comprendre les traditions, les rituels en cours ; et accompagner une évolution des mentalités, des attentes.De nos jours, la famille, les proches ont besoin de s’approprier la cérémonie funéraire.Ils sont au contraire sensibles aux rituels de commémoration de la vie du défunt.A cet égard, c’est le message que je voudrais adresser aux lecteurs, nous sommes à votre disposition pour créer un rituel qui fait du sens par rapport à la vie de la personne, pour créer un souvenir durable et significatif.Notre rôle consiste en un accompagnement personnalisé, transparent, sur-mesure en adéquation avec les us et coutumes, toujours dans le respect des règles de bienséance et du protocole.Vous avez édité un carnet intitulé « Le livret de mes dernières volontés ».L’anticipation des funérailles est un thème sensible et les intentions peuvent bien sûr évoluer. C’est pourquoi nous avons publié un « Livret de mes dernières volontés » qui permet à chacun de se familiariser avec une démarche qui reste peu courante en Belgique, contrairement à d’autres pays, comme l’Espagne où pas moins de huit personnes sur dix planifient leurs funérailles.Ce livret a pour but :D’éclairer chacun sur toutes les possibilités qui s’offrent pour organiser son dernier voyage.De faire respecter les dispositions prises pour la fin de vie ;D’éviter des conflits ou anticiper des tracas au sein des familles.Un exemple parmi d’autres, que faire lorsqu’il n’y a plus de place dans le caveau de famille ?Faire des crémations ? Mettre les cendres dans une urne ? Quel rituel peut-on créer ?Nous sommes à disposition pour vous aider à remplir ce livret qui est téléchargeable sur www.mavolonte.be ou disponible en version papier sur simple demande par e-mail à : prevoyance@ag-funeral.beSi vous deviez résumer, pour le lecteur, vos priorités dans votre activité, dans votre offre d’accompagnement ?Rendre service, inspirer et soutenir ;Parler de la mort et de la vie ;Rendre des instants de vie plus lumineux ;Créer un partenariat bienveillant pour éviter les conflits, discussions inutiles ou problèmes post-mortem.Sur un plan plus personnel, quelle est la réalisation dont vous êtes le plus fier ?Outre l’indépendance financière dont l’entreprise bénéficie, je suis fier d’être entouré par une équipe et un réseau d’agences et de professionnels qui nous permettent d’offrir un véritable service d’accompagnement avant, pendant et après le décès. Je veux enfin souligner la présence de femmes de nos équipes. C’est essentiel et même important pour dialoguer avec une mère lorsqu’un enfant vient à décéder.Et votre plus grande satisfaction ?Des familles qui nous expriment leur reconnaissance pour avoir été à leurs côtés est une satisfaction énorme dans mon métier. Cette reconnaissance, cet aspect gratifiant fait aisément oublier la contrainte inhérente à notre activité : l’exigence d’une très grande réactivité. Heureusement, aujourd’hui, la structure de l’entreprise et l’équipe en place permettent de concilier service optimal et vie familiale. A&G Funeral Un service d’accompagnement pour commémorer la vie. L’année 2010 voit la création de la société Funé reprenant les Pompes funèbres Altenloh-Greindl. Quinze ans après, que de chemin parcouru ! L’entreprise regroupe aujourd’hui une dizaine de maisons et d’agences de services funéraires et compte une trentaine de collaborateurs.www.ag-funeral.beANRB Newsletter 11-24 - Fr
L’Élégance au service du Cœur
3 stylistes de renom ont à nouveau accepté de mettre leurs superbes talents et leur précieux temps à la disposition de l’organisation d’un défilé de mode pour l’ANRB : Eléonore de Lichtervelde, amoureuse d’étoffes anciennes et rares, elle conçoit des vêtements qu’elle réalise à la main à l’aide de matériaux oubliés ou de vêtements vintage. Corinne le Gentil de Rosmorduc donne une seconde vie à des bijoux et crée des pièces uniques pour des femmes uniques selon un goût inspiré du 19ème siècle et du style victorien romantique. Marie-Catherine le Hodey a ouvert sa propre maison de couture à Bruxelles consacrée à la mariée pour laquelle elle crée des robes « romantico rock ». Qu’ont-elles en commun ? Elégance et beauté, service et générosité, pérennité et durabilité, mécénat et partage, toutes des valeurs représentatives de la noblesse les animent. Pourquoi avez-vous- choisi de vous engager pour l’ANRB alors que chacune de vous exerce déjà une activité professionnelle dynamique ? Nous avons choisi de ne pas garder pour nous nos compétences et le fruit de notre expérience mais de les investir au profit de Solidaritas car c’est une association qui fait du bien et qui est nécessaire pour les membres de notre association qui sont dans le besoin. Quelle est votre contribution au défilé d’octobre prochain ? Nous montons le défilé de A à Z. Depuis plus d’un an, nous chinons dans le vestiaire de l’ANRB où nous dénichons des merveilles. Nous y avons sélectionné de jolies pièces, de belle qualité, actuelles, griffées ou vintage. Nous avons passé de nombreuses soirées à trois pour associer les jupes et les hauts, sans oublier les accessoires et ainsi sélectionner des silhouettes et composer des looks pour tout type d’occasions, soir, jour, hiver ou été, et pour toute les femmes, jeunes filles et dames. Ensuite, nous avons identifié plus d’une dizaine de mannequins de tout âges et de toutes morphologies avec différentes personnalités de femmes qui toutes personnifient le chic et l’élégance tout en conservant leur simplicité. Deux autres critères ont également prévalu lors du choix, leur volonté de participer au projet, évidemment, et leur sourire. Nous avons aussi choisi le DJ, les musiques, l’ordre de passage qui permet à chaque mannequin de se changer entre les présentations et, bien entendu, un élément caractéristique de tout défilé, le tapis rouge. Nous avons aussi pris le temps de fixer un prix pour chaque pièce en fonction de notre expérience de vente, de « vestiaire collective », de vide dressings, de seconde main de luxe. Bref, tout est désormais bientôt prêt pour atteindre notre objectif qui est de vendre ces vêtements et ainsi contribuer à Solidaritas. Quel message souhaitez-vous transmettre à nos membres ? Venez au vestiaire, tant pour donner des vêtements que pour y dénicher la veste à combiner avec un jeans, le chapeau ou la robe dans l’air du temps, auquel vous pourrez donner une seconde vie et ainsi, arrêter de consommer et participer à cette économie de la fast fashion, tout en participant à une action de partage et de solidarité avec ceux qui ont moins de chance. Ce sont des valeurs importantes car c’est connu, donner, c’est recevoir deux fois. Pour les hommes, il y a aussi des costumes, smokings et cravates de grande maisons et de belle facture, rangés et sélectionnés par les gentilles dames du vestiaire sous l’égide de Marie de Schietere de Lophem. Nous vous invitons à venir nombreux admirer le fruit de leur travail et leur générosité, lors du défilé du 3 octobre au siège de l’ANRB et, si le cœur vous en dit, vous pouvez aussi découvrir leurs créations respectives et les rencontrer sur leurs medias : o Eléonore de Lichtervelde ou IGo Corinne le Gentil de Rosmorduc ou IGo Marie-Catherine le Hodey ou IG
L'aérodrome de Temploux selon Olivier de Spoelberch
Olivier de Spoelberch nous parle de l’aérodrome de Temploux - Namur.Les Spoelberch sont connus pour être à la fois des artistes et des entrepreneurs. Olivier, le benjamin de la famille, incarne parfaitement cet esprit polyvalent. Comme c’est souvent le cas pour le cadet, il a bénéficié d’une grande liberté, qu’il a exploitée au maximum pour nourrir sa créativité. Il est aujourd’hui engagé dans une multitude de projets divers. Arrivé dans le Namurois en 1986, Olivier de Spoelberch cherchait des terres pour se lancer dans l’agriculture biologique. C’est ainsi qu’il a trouvé, à Flawinne, un magnifique domaine en piteux état, qu’il a restauré avec soin pendant quinze ans. Passionné par l’aviation depuis l’enfance, il est pilote depuis 1967 et a découvert le vol à voile en 1971, lors d’un stage à Saint-Hubert. Depuis plus de 35 ans, il pratique le vol en avion, en planeur et en hélicoptère à l’aérodrome de Temploux. Investisseur dans la société STEMME, spécialisée dans la construction de motoplaneurs performants près de Berlin, il promeut ce type d’appareil qui permet de décoller avec un moteur, puis de voler sans, comme un planeur, tout en conservant la sécurité de pouvoir redémarrer le moteur en cas de besoin. La passion de l’aviation remonte loin dans la famille : en 1938, Eric de Spoelberch, l’oncle d’Olivier, était déjà pilote d’essai pour la firme Renard à Evere et travaillait régulièrement pour l’armée de l’air. L’aérodrome de Temploux, lui, a une histoire militaire : en 1944, les Américains l’ont choisi comme base aérienne pendant la bataille des Ardennes et l’ont utilisé pour rapatrier les soldats alliés vers l’Angleterre. Depuis les années 70, Madame Bertrand possédait l’aérodrome, mais, souhaitant le vendre, elle a cherché durant plusieurs années un acquéreur désireux de poursuivre l’activité. En 2017, Olivier a rencontré par hasard Benjamin de Broqueville et son épouse Vanina Ickx. Ensemble, ils ont décidé de se lancer dans l’aventure. Les décisions ont été prises rapidement, et les travaux ont été menés tambour battant. Le premier projet fut la construction d’un magnifique hangar métallique destiné à accueillir la société SONACA AIRCRAFT, qui avait choisi de produire un avion d’entraînement, le Sonaca 200. Ils se sont ensuite attelés à la réalisation d’une piste en dur, permettant aux avions de décoller et d’atterrir par tous les temps car l’ancienne piste en herbe devenait souvent impraticable en hiver. Puis, le trio s’est intéressé au bâtiment principal, qui était en grande partie abandonné. La décision a été prise de le reconstruire entièrement pour y créer un restaurant, une tour de contrôle, des bureaux, une grande salle polyvalente et un rooftop spectaculaire. Les travaux ont duré deux ans, et le résultat est bluffant. Olivier, spécialisé dans le travail du bois, du plâtre et des résines, a laissé libre cours à son imagination pour créer des décors intérieurs uniques. La tour de contrôle, construite au centre d’un bassin avec des carpes japonaises, est probablement la seule de ce genre au monde ! Concernés par l’impact énergétique de leurs activités, ils ont choisi d’installer des pompes à chaleur et des panneaux solaires sur les toits, au nombre de plus de 700, afin de subvenir aux besoins électriques du bâtiment. Pour les avions, ils proposent de l’essence sans plomb adaptée aux moteurs récents. De plus, pour minimiser l’impact sonore sur le village voisin de Temploux, ils ont modifié les circuits des avions et opté pour des appareils moins bruyants pour le remorquage des planeurs et pour le para-club. Ils ont aussi investi dans un treuil, permettant de lancer un planeur à 400 mètres en une minute, sans bruit, et avec seulement un litre de carburant. Grâce à ces initiatives, Temploux est devenu un pôle économique important, accueillant désormais huit entreprises et employant près de 130 personnes. La société SOURSE, créée par Olivier et Benjamin, se concentre sur la surveillance des pipelines, routes et chemins de fer, en développant des instruments sophistiqués capables de détecter automatiquement les anomalies et de les traiter en temps réel. Conscient des enjeux climatiques actuels, Olivier ne cherche pas à développer l’aviation à l’aérodrome. Il souhaite plutôt en faire un lieu convivial où il fait bon venir en famille. Un château gonflable, un bac à sable et des jeux permettent aux enfants de s’amuser, tandis que les parents profitent d’un cadre agréable avec, en toile de fond, un coucher de soleil exceptionnel et quelques avions, planeurs ou parachutistes en guise de spectacle. L’aérodrome offre une alternative locale précieuse, alors qu’il est essentiel de réduire nos déplacements. Les salles de réception et le rooftop permettent d’allier l’utile à l’agréable et ont déjà accueilli divers événements : concerts, projections de films, mariages, présentations de voitures, vernissages, rallyes automobiles et incentives. Olivier, qui visite l’aérodrome quotidiennement, s’efforce d’en faire un lieu toujours plus attractif, et il se projette déjà dans un nouveau grand projet culturel dans les Marolles… Nous remercions Philippe de Potesta d’avoir rencontré Olivier et de nous faire découvrir ce lieu. Découvrez l’histoire de l’aérodrome de Temploux
L'univers poétique d'Olivier Terlinden
Dieu, que cela fait du bien ! 150 pages de délices ….. ou comment pénétrer à pas feutrés dans un univers magique et amical. Voici le premier récit, qu’on peut qualifier d’initiatique, écrit par Olivier Terlinden, 36 ans, agronome et photographe-nature, assurément philosophe-poète car l’amour de la nature lui permet de transmettre de très belles pensées, telles : « la forêt…apportait un sentiment d’éternité » (p.96) ou « Mai est un mois pour travailler la terre, et un mois pour la contempler » (p.57).Tout commence par le désir irrépressible des trois écoliers fascinés par une propriété entourée d’un vieux mur et qui, selon la légende, recèlerait un trésor…Il s’agit du domaine d’Hermeline, autrefois abbaye ; il semble maintenant dédié à la nature qui s’y installe voluptueusement.Un vieillard, châtelain-jardinier y habite encore et, en pleine tempête, recueille le jeune François. Une belle complicité naîtra entre eux et, avec douceur et affection, l’aïeul initiera François à la beauté de la nature : « …au-delà du mur et des arbres entrelacés… quelque chose en ces lieux respirait »(p.22). Voilà, on est prêt à entrer dans l’émerveillement. « Au-delà du vieux mur », le titre de votre livre est déjà un peu magique et le lecteur se sent prêt à enjamber le mur en question. Comment est née chez vous l’envie d’évoquer cela ? Ces dernières années, j’ai passé de longues heures à marcher en forêt autour du village de Néthen, un petit carnet à la main. J’ai photographié les arbres, les collines, les vallons, les animaux qui les peuplent. J’ai goûté aux odeurs du bois, palpé les troubles et les joies que l’on ressent parfois en marchant dans des lieux imprégnés d’histoire.Je suis né à Néthen. Les premières années de la vie sont essentielles dans la construction de l’imaginaire. Le village abrite un domaine insolite, un ancien couvent entouré d’un long mur de briques. J’ai eu la chance d’avoir un pied à l’extérieur du domaine, et un pied à l’intérieur. D’imaginer les mystères que l’on envisage depuis l’extérieur, connaitre les merveilles que l’on rencontre à l’intérieur. Par ce roman, je souhaitais inviter le lecteur à vagabonder en ces lieux, entre rêve et réalité. Vous scandez l’histoire en trois parties : la rencontre, la croissance, l’envol et cela s’apparente aussi bien au vécu de la semence qu’à la croissance de François, l’enfant émerveillé et durement touché par la vie. L’optique de la transmission vous a-t-elle habité dès le début de votre écriture ? La nature, le silence, le temps qui passe ont été mes premiers lieux d’inspiration. Puis le récit s’est peuplé de personnages. François, ses amis d’enfance, le vieil homme. « Sans doute le vieux avait-il senti ma solitude. Il m’adopta comme un fils. » Ce vieil homme est une figure d’amitié et de transmission. Quand François rencontre le vieil homme qui l’accueille lors de la tempête, qu’il entend « son pas serein » sa voix paisible et qu’au fil du temps il en vient à l’appeler « Bon-Papa » on a l’impression que ces souvenirs chaleureux font partie de votre enfance : est-ce possible ? Quand j’étais enfant, mon grand-père me racontait des histoires. Quand on se promenait avec lui, tout prenait la grandeur des légendes : tel chêne abritait la fée Bleuette, telle souche le troll Barbapoux. Bon-Papa était un homme bon. Il m’a inspiré en partie le personnage du vieil homme, et sa mythologie a influencé celle du domaine d’Hermeline. Sans doute m’a-t-il transmis quelque parfum d’un passé aujourd’hui effacé. « La terre est pareille à une femme. Ce n’est pas tout d’y poser les mains, il faut pouvoir l’admirer » (p.57) Voulez-vous signifier par là l’importance vitale de prendre du recul par rapport aux évènements et vanter cette vertu fondamentale qu’est la patience ? En tirez-vous une leçon ou une « morale » à la façon de La Fontaine ? Je ne suis pas sûr que les livres aient pour vocation de proposer des leçons, des morales. La littérature, comme la peinture ou la musique, a pour vocation d’être, pour la beauté de l’être. Elle est fenêtre ouverte sur la lumière. Ceci dit, je pense qu’on ne peut produire du fruit qu’en aimant. Et que l’amour demande de la patience. C’est valable dans la relation de couple, dans l’amitié,... mais aussi dans le lien à la terre, au bois, aux mots, matières que travaillent le paysan, l’artisan, le poète. En tant que photographe, y a-t-il un lieu privilégié dans lequel vous pénétreriez avec le plus de joie et de respect ? J’aime les lieux bercés d’ombres et de lumière, les lieux dressés vers le ciel, les lieux qui racontent des histoires. Un pareil endroit pourrait être une abbaye du XIIème siècle, habitée ou en ruine, sur le sommet désert d’une montagne. Photographe et agronome, l’émerveillement sous-tend votre vie. Pouvez-vous expliciter cela ? L’émerveillement a cette faculté de détourner l’homme de lui-même, de ses ambitions, ses préoccupations. De le tourner vers plus grand, vers le beau, vers l’autre. C’est l’élan qui pousse le fiancé vers sa belle, retient la nuit venue l’artisan sur son œuvre, invite le paysan à contempler sa terre, offre au moine une larme dans la prière. Pour Maurice Zundel, l’émerveillement n’est-il pas l’expérience spirituelle par excellence ? Un grand merci à Claire de Ribaucourt pour cet interview. Il ne nous reste plus qu’à découvrir ce livre !
Les JO de Paris 2024
Entretien avec le baron Pierre-Olivier Beckers-Vieujant, ancien président du Comité Olympique et Interfédéral Belge. Vous aviez des responsabilités particulières dans l’organisation des derniers Jeux Olympiques. Vous pourriez nous les rappeler ? Depuis fin 2017, j’ai assuré la présidence de la Commission de Coordination des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Mon rôle a été en premier lieu de garantir que la France et son comité d’organisation délivrerait bien en temps et en heure, et dans le budget annoncé, la vision développée par Paris 2024 dans son dossier de candidature. Par ailleurs, mon rôle était d’assurer le lien entre d’une part les parties prenantes principales du Mouvement Olympique, à savoir le Comité International Olympique (le CIO), les Fédérations internationales et les Comités Nationaux Olympiques, et d’autre part le comité d’organisation et les différents niveaux de pouvoir en France afin d’assurer la meilleure mise à disposition des ressources et compétences nécessaires à la bonne réalisation du projet. Comment évaluez vous les performances de nos athlètes belges y compris celles qui n’ont pas été gratifiées avec une médaille ? Il ne fait aucun doute que nos “Teams Belgium” Olympiques et Paralympiques ont merveilleusement performé durant ces Jeux. Dans l’ensemble, la taille de nos délégations, le nombre de médailles obtenues et en particulier le nombre de médailles d’or, le grand nombre de quatrième places, certainement frustrantes mais ô combien révélatrices du potentiel de podium de nos athlètes, et enfin le grand nombre de places de finalistes, tous ces éléments de mesure sont des marqueurs et démontrent combien les efforts et investissements renforcés depuis 20 ans sont en train de porter leurs fruits. Notre pays, et ses communautés ne voient plus le sport de haut niveau comme un signe d’élitisme discriminatoire, mais au contraire comme un moteur de bien-être pour nos jeunes et surtout un facteur d’inclusion et de solidarité. Paris 2024 fera très bonne figure dans les anales olympiques. Quel est selon vous son impact le plus significatif ? De l’avis général des observateurs internationaux, les Jeux de Paris 2024 sont les Jeux les plus extraordinaires de l’histoire des Jeux modernes ( qui ont commencé en 1896). Dès 2017, la vision de Paris 2024 a rejoint celle du CIO pour renforcer le rôle des Jeux Olympiques afin de leur donner une dimension plus inclusive, plus responsable, plus durable, plus urbaine, et plus utile. Pour la première fois dans l’histoire des Jeux, il y avait exactement le même nombre d’athlètes masculins et féminins. Les Jeux ont été organisés avec un budget, certes élevé mais couvrant des besoins réels d’infrastructures dans la région Parisienne, inférieur de plusieurs milliards d’euros par rapport à la dernière édition de Tokyo en 2021. Paris 2024 s’est engagée à réduire de 50% son impact carbone par rapport au passé et à développer une série d’initiatives remarquables sur le plan environnemental. Des centaines de contrats ont été octroyés à des très petites et moyennes entreprises et à des entreprises issues de l’économie solidaire et responsable. Et ce qui restera dans toutes les mémoires, ce qui différencie Paris de tous les autres Jeux, c’est d’avoir voulu amener le sport au cœur de la ville, dans des stades éphémères urbains, là où les gens vivent, et avec ce point fort en plus, d’avoir pu installer dans la ville Lumière le sport au beau milieu de paysages et bâtiments iconiques. La devise de Paris était : “Ouvrons grand les Jeux” ! Cette promesse a été pleinement tenue, avec des célébrations populaires et des manifestations d’amitié et de solidarité tout au long de l’été ! Comment expliquez vous la popularité des jeux paralympiques ?La popularité extraordinaire des Jeux Paralympiques de Paris 2024 tient à plusieurs facteurs. Tout d’abord, je veux croire que les mentalités ont continué à évoluer ces dernières années et que la volonté d’inclusion, même si le travail n’est pas terminé, est plus forte que jamais. Ensuite, il y a la performance des athlètes. À chaque édition des Jeux Paralympiques, le niveau des compétitions augmente. Les athlètes font vibrer les supporters par leur mérite sportif intrinsèque. À cela s’ajoute que Paris 2024 a voulu résolument montrer un visage égalitaire : pour la première fois dans l’histoire des Jeux, l’emblème, la devise et les mascottes étaient identiques et communes ! Il est certain ensuite que le succès extraordinaire de ces Jeux Olympiques a déclenché les passions, en particulier celles de millions de Parisiens et autres supporters qui avaient abandonné Paris à la mi-juillet et qui se sont rendus compte de ce qu’ils avaient manqué ! Heureusement, avec les Jeux Paralympiques, il leur a encore été possible de regarder la deuxième mi-temps de ces Jeux ! Enfin, le fait de les vivre dans notre fuseau horaire nous a permis de les suivre avec beaucoup plus d’intensité. Il est clair que ceci sera un défi dans quatre ans à Los Angeles. Quels sont les principaux défis auxquels l’idéal olympique pourrait être confronté à l’avenir ? Les Jeux Olympiques et dans leur sillage, l’idéal Olympique qui est de contribuer à rendre le monde meilleur par le sport, ont une visibilité qui permet de réaliser de grandes choses, mais qui fait aussi des jaloux et des envieux. Les Jeux Olympiques sont le plus grand événement pacifique au monde. La vision du CIO est un modèle de solidarité, qui se traduit par la volonté de redonner l’argent généré par le sport au plus grand nombre d’athlètes et au plus grand nombre de pays. Face à ce modèle, plusieurs pays ou organisateurs d’événements rêvent d’organiser des Jeux spectaculaires, où tout serait permis, y compris bien sûr le dopage sans limites, et dans lesquels quelques athlètes privilégiés et quelques fédérations de sport rafleraient toute la mise. Le Mouvement Olympique devra donc trouver les parades pour éviter que ce “tout à l’argent”, “tout à quelques-uns”, et “tout à la gloire de sombres objectifs politiques de quelques pays”, ne prennent le dessus. La récupération politique du sport, qu’hier encore nous croyons définitivement enterrée dans une ère post-soviétique et post-Allemagne de l’Est est en train de faire un retour en force.Le dernier grand défi de l’Olympisme est de trouver le moyen d’intégrer la technologie des jeux vidéos et sports virtuels, qui contribuent à l’explosive obésité de nos jeunes, au sein même des Jeux et des nombreuses initiatives Olympiques, tout en maintenant au premier plan les valeurs fondamentales de l’Olympisme que sont le respect, l’amitié, l’excellence et la solidarité. Avez-vous un souhait particulier ou une ambition personnelle pour le sport belge ?Cela fait plus de 20 ans que je travaille comme bénévole au sein du mouvement Olympique car j’ai la conviction que les images positives du sport et les valeurs de l’Olympisme, qui représentent en fait les valeurs fondamentales de la vie, peuvent contribuer à construire un monde plus juste, plus solidaire, plus inclusif. Un monde peuplé de citoyens en meilleure santé physique et mentale, qui dès lors seront mieux à même d’offrir plus, lors de leur passage sur terre, à notre petite mais chère planète.Cet idéal est intact et motive mon espoir de voir demain des “Teams Belgium” encore plus performants car l’image formidable de nos athlètes et para-athlètes a le potential de décider nos concitoyens à bouger….dans tous les sens du terme.Nous remercions le baron Johan Swinnen pour cette fantastique interview.Copyright Paris 2024/Getty ImagesCopyright Belga image
Hope Happening
Cher Gauthier, Tu es la cheville ouvrière de l’événement “Hope Happening” qui aura lieu fin septembre, au Heysel, à l’occasion de la venue du Pape François. Cet événement est destiné aux jeunes de 12 à 30 ans, croyants et non-croyants. Pourquoi t’es-tu lancé dans ce projet ? Il y a deux ans, j’ai décidé de quitter mon poste de directeur général Belgique d’une société internationale pour laquelle j’ai travaillé pendant 20 ans. J’avais pris cette décision pour pouvoir racheter une entreprise et pour avoir plus de temps à consacrer dans des projets qui avaient plus du sens par rapport à ma foi. Fin avril, j’ai rencontré Sofi Van Ussel, directrice de la pastorale des jeunes en Flandre à une soirée de Logia qui veut promouvoir une parole chrétienne dans le débat public. Elle avait été présentée comme la personne en charge du festival des jeunes dans le cadre de la venue du pape en Belgique le WE du 28/29 septembre. La venue du pape en Belgique était une occasion extraordinaire que nous recevions, nous catholiques belges, pour donner un nouveau souffle à notre Église, pour faire passer un message d’espérance dans la société et pour permettre à des milliers de jeunes de vivre un rassemblement un peu comme les JMJ (Journées mondiales de la jeunesse). Très vite, je me suis engagé dans le projet comme bénévole et grâce à mon profil biculturel (flamand et francophone) et mon expérience professionnelle, Sofi m’a demandé de l’assister dans l’organisation générale. Le communiqué de presse invite tout le monde à participer à cet évènement : croyant, non-croyant ou en recherche de Dieu. Comment accueillir les non-croyants et leur permettre de collaborer pleinement à ce rassemblement ? Le Hope Happening du 28 et 29 septembre se compose de 4 grands moments. Tout d’abord, une marche au départ de 3 points de Bruxelles vers le palais du Heysel. Ensuite, un festival qui s’articule autour des 3 expériences : 1. Des groupes de musique chrétiens (ou à inspiration chrétienne), 2. Un village où différentes communautés/associations proposeront des activités pour les jeunes et 3. Des témoignages de personnes inspirantes. Le troisième moment est celui de la prière commune, suivie de la soirée et enfin, après la nuit où tous les jeunes pourront dormir dans le Heysel, il y aura le dernier moment qui sera la messe du dimanche 29 septembre à 10h avec le pape dans le stade Roi Baudouin. Comme des mini-JMJ, le Hope Happening se veut être un rassemblement unique qui permet aux jeunes de découvrir le Christ ou de renforcer leur amitié avec lui. Le fait de voir d’autres jeunes engagés peut aussi être une vraie source d’inspiration. Le but est donc de rassembler tous ces jeunes, chacun avec leur parcours individuel, autour de la visite du pape en Belgique et de vivre tous ensemble un moment d’espérance. Est-il encore possible, de s’inscrire à un des 4 grands moments que vous organisez ? Oui ! Il suffit d’aller sur le site www.hopehappening.be pour s’y inscrire. Chaque jeune inscrit au Hope Happening reçoit aussi l’entrée pour la messe dans le stade avec le pape. Bien que les places pour les inscriptions individuelles et pour de nombreux groupes soient déjà complètes pour la messe, nous avons reçu un nombre de places suffisant du comité national afin de pouvoir accueillir un maximum de jeunes, mais ne tardez pas ! En-dehors de cet événement, ton épouse et toi-même êtes impliqués dans la vie de votre paroisse. En quoi consiste cette participation ? Que vous rapporte-t-elle ? Nous avons vécu, il y a 3 ans, un moment fort quand nous sommes partis avec nos 5 enfants à Madagascar pour rencontrer le Père Pedro dans son village de Akamasoa. En rentrant de ce voyage, nous avons vraiment senti que nous devions nous investir plus pour Dieu. Six mois après, nous faisions un pèlerinage en Terre Sainte et à notre retour, on proposait à Raphaëlle de devenir la nouvelle animatrice pastorale. Je venais de quitter mon travail et je cherchais une entreprise à racheter. Depuis Raphaëlle et moi, sommes très impliqués dans la vie de notre paroisse à La Hulpe. Pour le moment, Raphaëlle est en train de mettre en place OClocheren Belgique. C’est une application digitale au service de la communication de la vie de la paroisse qui encourage la fraternité et l’esprit de famille. ‘Hope Happening’ claque comme une voile d’espérance : comment en voyez-vous les retombées ? Beaucoup de personnes ont, après les JMJ de Paris ou de Cologne, découvert la foi ou ont été renforcées dans leur foi. Notre souhait est d’écouter les jeunes, de leur permettre de vivre un moment d’intériorité et de partage. Comme l’a demandé le pape aux JMJ de Lisbonne, que les jeunes se lèvent, qu’ils cheminent dans l’espérance à la suite de Jésus et qu’ils partagent la joie reçue avec les autres. Hope Happening est un message d’espérance pour les jeunes car ce sont eux qui seront l’Église de demain ! Si vous voulez nous soutenir ou avez des questions, n’hésitez pas à envoyer un mail à info@hopehappening.beInterview de Gauthier Morel de Westgaver réalisée par le comité de rédaction de l’ANRB.
Salon des Arts et du Terroir
Le prochain Salon des Arts et du Terroir de l’ANRB ouvrira ses portes les 14, 15 et 16 février 2025 et vous présentera plus de 20 talents artistiques de l’association. La nouveauté de cette 5e édition sera la découverte de produits de bouche d’exception. Vous êtes artisans culinaires ou patron d’une production de délices : sucrés, salés, fermentés, naturels, transformés, etc. ? Posez votre candidature en complétant le formulaire en ligne. Ce sera l’occasion de présenter de visu, oralement et gustativement votre spécialité culinaire.
L'Europe dompte l'IA
À l’image d’un cheval fougueux, l’Intelligence Artificielle (IA) fait preuve d’une ardeur impétueuse et semble être totalement indomptable. Le dressage des chevaux révolutionna pourtant le transport, l’agriculture, la mobilité des armées, le travail et les loisirs, et contribua de manière significative au développement des sociétés humaines. Voilà qui a de quoi rassurer : l’intelligence artificielle doit donc être encadrée pour mieux correspondre aux attentes du monde dans lequel elle est née. La rejeter est d’ores et déjà considéré comme une attitude absurde tant l’IA s’est rendue indispensable dans des secteurs tels que la santé, la finance, la mobilité, le commerce, l’énergie, l’éducation, l’industrie ou l’agriculture.Certains diront que l’arrivée des trottinettes électriques aurait dû permettre de fluidifier la mobilité tout en réduisant les émissions de CO2, mais que le manque de législation pour les encadrer a fini par autoriser indirectement leurs usagers à circuler n’importe où et dans n’importe quelles conditions. Pour éviter que son utilisation soit mal « gérée » et afin d’assurer des conditions optimales pour son développement, l’Union Européenne a décidé de réglementer le recours à l’intelligence artificielle.Il y a quatre ans, un premier cadre réglementaire concernant l’IA fut proposé par la Commission européenne. Le Parlement s’était alors fixé pour priorité de veiller à la sûreté, à la transparence, à la traçabilité et au caractère respectueux des personnes et de l’environnement. Un classement recensant les « risques » que les différentes applications peuvent présenter pour notre civilisation fut également créé.Le 13 mars 2024, une réglementation européenne en matière d’intelligence artificielle, connue sous le nom d’AI Act ou de Loi IA, fut adoptée par le Parlement et approuvée par le Conseil européen le mois dernier. Cette loi pionnière vise à harmoniser les règles sur l’IA, en mettant l’accent sur ces « risques » pour garantir un développement et un usage responsables de cette technologie au sein de l’UE. Mais, au fond, de quels risques s’agit-il ? Basée sur l’EU Artificial Intelligence Act, voici une synthèse vulgarisée de cette loi et ses quatre « classes de risques » : 1. Les « risques inacceptables », tels que les systèmes de notation sociale et l’IA manipulatrice, sont interdits. Ces risques inacceptables incluent la manipulation cognitive et comportementale de personnes ou de groupes vulnérables, comme des jouets vocaux incitant les enfants à des comportements dangereux, ainsi que le classement social des individus basé sur des critères personnels et socioéconomiques. D’autres interdictions concernent la catégorisation et l’identification biométriques, ainsi que les systèmes d’identification biométrique en temps réel à distance, tels que la reconnaissance faciale. Des exceptions peuvent toutefois être autorisées pour certaines utilisations liées à l’application de la loi. 2. Les systèmes d’IA à « haut risque » comprennent les systèmes d’IA capables de malmener la sécurité et les droits fondamentaux : ceux qui sont utilisés dans les produits relevant de la législation de l’UE sur la sécurité des produits (voitures, aviation, jouets, etc.) ; mais aussi ceux qui relèvent de domaines particuliers devant être ajouté à une base de données de l’Union européenne (emploi, éducation, forces de l’ordre, etc.). 3. Les systèmes d’IA à « risque limité », soumis à des obligations de transparence : les citoyens doivent savoir qu’ils interagissent avec une IA (chatbots, deepfakes). Pour ce faire, il faudra clairement indiquer les médias ou contenus ayant été générés par une IA. Il est primordial de reconnaitre que chaque individu a le droit de s’opposer à des traitements automatisés qui ne comportent pas d’intervention humaine dans le processus décisionnel. Comme les êtres humains, les systèmes sont également susceptibles de commettre des erreurs, qu’elles soient causées par des défaillances techniques ou par des biais (discriminations) intégrés dans l’outil. 4. Les systèmes d’IA à « risque minimal ». Cette dernière catégorie n’est pas (encore) réglementée et inclut des applications comme les jeux vidéo et des filtres anti-spam activés par l’IA. Cette loi adoptée en mars 2024 ne sera totalement appliquée que dans deux ans, même si certains volets le seront plus rapidement. Il s’agit là d’une première « limite théorique » sensée réguler l’usage de cette arme pour laquelle une formation « éthique » spécifique devrait être dispensée à tous ses utilisateurs avant qu’une totale mise à disposition ne leur soit accordée. Une sorte de permis d’IA peut-être ? EU Artificial Intelligence Act : https://artificialintelligenceact.eu/fr/high-level-summary/ CNIL : https://www.cnil.fr/fr/intelligence-artificielle/intelligence-artificielle-de-quoi-parle-t-on Nous remercions le comte Pierre-Alexandre de Lannoy pour la rédaction de cet article.
Trait d’union entre particules
Ces trois livres nous invitent à découvrir des univers insoupçonnés où des forces façonnent notre quotidien ;"Le Papillon d’or" de Stéphanie Crayencour nous entraîne dans une quête poétique de transformation personnelle, "Mythologie du .12" de Célestin de Meeûs explore les symboles et les mythes modernes, tandis que "Petite philosophie des algorithmes sournois" de Luc de Brabandère met en lumière les mécanismes subtils des algorithmes qui influencent nos choix. Chaque auteur, à sa façon, nous offre une réflexion sur les puissances (invisibles) qui gouvernent nos existences. Luc de Brabandère : Petite philosophie des algorithmes sournois Éditions Eyrolles, 192pp, 2023. Chaque jour davantage, de nombreux algorithmes façonnent notre manière de vivre. Ce qui n’était autrefois qu’une simple technique de programmation est aujourd’hui devenu un moteur de transformation profonde de notre société. Dans ce bref ouvrage, à la fois dense et percutant, le philosophe présente ces formules de code informatique qui régissent désormais de nombreux aspects de notre vie quotidienne. Luc de Brabandère a grandi avec l’informatique. Durant ses études à l’École Polytechnique de Louvain, il s’intéresse aux algorithmes et publie dès 1985 Les Infoducs, un essai pionnier sur « la toile ». Dans ce septième volume des Petites Philosophies, il met à profit son instinct de vulgarisateur pour explorer le fonctionnement et l’influence des algorithmes dans la vie quotidienne, tout en en soulignant les limites. Il encourage ainsi une réflexion alliant inventivité et sens du devoir. Stéphanie Crayencour : Le Papillon d’Or : Mon exploration aux portes de l’au-delà Éditions Animae, 240pp., 2024. « En plein tournage, ma respiration s’accélère, devient haletante, irrégulière... Je ressens l’envie soudaine et irrépressible de mourir. À des centaines de kilomètres de là, mon frère Max est en train de mettre fin à ses jours. » À cet instant, Stéphanie Crayencour ressent la présence de son frère qui l’entoure d’amour et la visite dans ses rêves. Elle commence alors à s’interroger sur la mort et l’au-delà, explorant ces questions métaphysiques comme l’a fait son arrière-grand-tante Marguerite Yourcenar. Cette quête qui bouleversa toutes ses perceptions de la réalité l’amèneront à tisser des liens entre science, conscience et spiritualité. « Ce qui ressort de cette enquête rigoureuse et dynamisante, c’est que la mort est un degré supérieur de la vie. On sort de ce livre ému, joyeux, plus dense et plus riche. » (D. van Cauwelaert). Célestin de Meeûs : Mythologie du .12 Éditions du sous-sol, 144pp, 2024. Dans ce premier roman, Célestin de Meeûs nous plonge dans diverses atmosphères : il raconte un jour de solstice d’été lors duquel Théo et Max, deux amis, passent leur temps à errer, fumer des joints et plaisanter pour combler le vide de leur existence. En parallèle, le lecteur suit Rombouts, un médecin dévasté par la séparation brutale qu’il a vécue avec sa femme et ses enfants, conséquence d’une infidélité, si brève fut-elle. En même temps, un homme ivre, remâche sans cesse ses insuccès avant de se perdre dans un soliloque paranoïaque abracadabrant. Ces personnages partagent une perte de contrôle sur le réel, influencés par diverses substances et par des émotions intenses dominant la raison. Ce roman explore ces instants délicats où tout nous échappe, où l’imprévu surgit brusquement au cœur d’une vie qui semble si ordinaire.