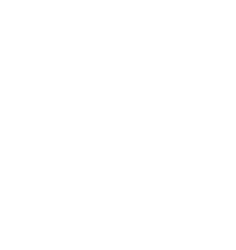Actualités
Rencontre avec Bénédicte van Zeeland, infirmière en milieu carcéral : soigner derrière les barreaux
À l'âge de 50 ans, j'ai choisi d'opérer une réorientation professionnelle mûrement réfléchie après avoir travaillé la majeure partie de ma carrière au sein d'un service d'urgences. J'ai souhaité mettre mes compétences au service d'une population différente, dans un environnement unique et spécifique. C'est ainsi que j'ai intégré l'établissement pénitentiaire de Leuze-en-Hainaut en tant qu'expert technique médical pénitentiaire.
Philippe de Potesta : Comment vivez-vous le rythme d’une journée en prison ?
Bénédicte van Zeeland : Le rythme de la prison est certes contraint par la sécurité, mais je l'aborde comme une opportunité d'exercer mon métier de soignante. Le quotidien peut être émotionnellement éprouvant et demande une vigilance constante. La satisfaction ressentie lorsque l'on parvient à établir une connexion, à soulager une douleur ou à soutenir un détenu dans sa prise en charge donne tout son sens à notre travail. L'objectif est de faire exister l'humanité du soin, même face aux comportements les plus ardus.
Mes consultations sont des moments privilégiés qui me permettent d'établir un lien avec les détenus. Mais je ne me voile pas la face: certains détenus ne sont pas toujours "gentils" ou coopératifs: insultes et comportements agressifs font malheureusement partie du tableau. Ces réactions reflètent souvent une grande souffrance, une frustration face au système, un manque total de repères ou encore un manque d'éducation. Ma priorité reste le soin. Je maintiens mes limites claires, je rappelle le cadre, les règles de respect mutuel, tout en garantissant la confidentialité absolue.
Philippe de Potesta : Comment établissez-vous la relation de soin et comment se déroule leur suivi médical ?
Bénédicte van Zeeland : La relation de soin et le suivi médical des détenus sont guidés par le principe d'équivalence de soins (droit à avoir des soins équivalents à ceux prodigués à la société civile) et par le respect des droits du patient dont le secret professionnel.
Elle repose sur plusieurs piliers essentiels :
- Nous abordons les détenus sans jugement et avec empathie comme des individus à part entière, indépendamment des raisons de leur incarcération en veillant à la continuité des soins avant, pendant et après leur détention.
- Nous garantissons la confidentialité des informations médicales, condition essentielle pour instaurer la confiance.
- A leur arrivée, une évaluation initiale (incluant l'état médical, psychologique et le risque suicidaire, particulièrement élevé en début de détention) est réalisée. Un examen médical est effectué par un médecin et une infirmière dans les 24 heures de son arrivée. Il permet d'évaluer l’état de santé du détenu, d'identifier ses problèmes physiques et psychiques et d'assurer la poursuite des traitements en cours: ex: traitements de substitution pour les toxicomanes.
Chaque établissement dispose d'une équipe de soins pluridisciplinaire: avec des médecins généralistes, infirmiers, psychiatre, psychologues, dentiste, kinésithérapeute. Les détenus ont le droit de demander à voir l'infirmerie tous les jours: nous y assurons les premiers soins: (plaies, fractures, prises de sang, électrocardiogrammes, douleurs dentaires, etc.) tandis que les consultations spécialisées sont organisées suivant un calendrier de rendez-vous.
- Bien que je travaille dans un milieu sécurisé en étroite collaboration avec les surveillants, je tiens à maintenir mon identité professionnelle d'infirmière. Cette neutralité est perçue comme telle par les détenus et facilite le lien de confiance.
Philippe de Potesta : La détention peut-elle être un levier de transformation personnelle ?
Bénédicte van Zeeland : La transformation dépend avant tout de la volonté et de la résilience du détenu. Le système propose des outils: travail, formation professionnelle, activités culturelles et sportives et programmes thérapeutiques mais le cheminement est personnel. Les parcours de réinsertion les plus probants concernent généralement les détenus qui ont admis leur culpabilité et manifestent la volonté de réparer le préjudice aux victimes.
Mais je constate aussi que la surpopulation carcérale, la violence et l'influence d'autres détenus peuvent saboter ces efforts et aggraver les situations. Les moyens humains et matériels alloués à la réinsertion restent insuffisants, ce qui limite nos actions.
Philippe de Potesta : En quoi le travail d’infirmière en milieu carcéral diffère-t-il de celui en milieu hospitalier ?
Bénédicte van Zeeland : Il se distingue surtout par le cadre sécuritaire contraignant, la globalité des soins et la spécificité de la population.
Nous travaillons avec des règles strictes et dépendons des agents pour l'organisation concrète de notre travail: la sécurité prime et peut impacter l'organisation de nos soins.Nous traitons un large éventail de pathologies: problèmes de santé mentale, assuétudes, maladies infectieuses, soins chroniques et urgences avec des ressources plus limitées qu'à l'hôpital, ce qui exige une grande polyvalence. Nous assurons à la fois le suivi, le dépistage et la prévention.
Un autre point à souligner aussi est leur demande de soins qui peut être manipulatrice: je dois souvent démêler ce qui relève d'une vraie demande de ce qui serait plutôt une tentative pour sortie de cellule ou un désir d'accéder à des médicaments détournés. Cela peut parfois être épuisant mais cela fait partie du notre travail.
Philippe de Potesta : Un tout grand merci à Bénédicte van Zeeland pour cet échange et la qualité de ses réponses.
Nous remercions également Philippe de Potesta