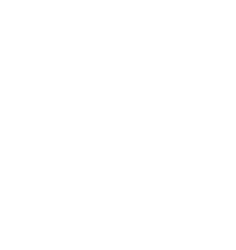Actualités
Le Cinéma Belge
Notre compatriote Joseph Plateau, professeur en physique expérimentale à l'Université de Gand, a développé dès 1836 un dispositif stroboscopique, le phénakistiscope, apportant ainsi une contribution essentielle à l'invention du cinématographe par les frères Lumière en 1895, et donc à la naissance de l'industrie cinématographique. Le 1er mars 1896, la première projection d’un film en Belgique a eu lieu dans une salle des Galeries Royales Saint-Hubert à Bruxelles.
Durant la première moitié du siècle dernier, le cinéma en Belgique est resté un terrain d'expérimentation pour les pionniers. Avec l'aide de l'industriel français Charles Pathé, Alfred Machin a fondé en 1910 un premier studio de cinéma. Hypolyte De Kempeneer devient le premier producteur de films et travaille notamment avec la première réalisatrice et actrice Aimée Navarra. Son film Coeurs Belges s'inscrit dans une série de mélodrames patriotiques qui dominent la modeste industrie cinématographique belge après la Première Guerre mondiale. Un autre pionnier, le comte Robert de Wavrin de Villers-au-Tertre, ethnologue et explorateur, a vécu plusieurs années parmi les Indiens d'Amérique du Sud et a capturé des témoignages de diverses cultures sur pellicule. Ses films les plus connus sont Au Centre de l’Amérique du Sud inconnue (1924) et Au Pays du Scalp (1931).
Dans les années 30, Charles Dekeukeleire, Henri Storck et Joris Ivens ont expérimenté de nouvelles techniques cinématographiques et fondé l'École belge du documentaire. Misère au Borinage de Storck et Ivens est considéré comme une œuvre marquante. De Witte (1934), adapté du roman d'Ernest Claes, devient le premier long-métrage de fiction populaire. Le réalisateur Jan Vanderheyden réalise ensuite avec Edith Kiel une série de comédies populaires avec des acteurs comme Gaston Berghmans, Jef Cassiers et Nand Buyl.
De l’après-guerre aux années 80, le drame paysan devient un genre clé du cinéma belge. Parallèlement, certains cinéastes posent leur empreinte personnelle sur le cinéma belge et déclenchent ainsi une première vague de reconnaissance internationale : Roland Verhavert (Meeuwen sterven in de haven,…), André Delvaux (De man die zijn haar kort liet knippen, L’oeuvre au noir,…), Harry Kümel (Malpertuis,…) et Jacques Boigelot (Paix sur les champs). Leurs films deviennent plus contemporains, souvent empreints de réalisme magique, une tendance qui persiste. La création des premières écoles de cinéma au début des années 60 forme une nouvelle génération de réalisateurs. Des talents comme Chantal Akerman ou Raoul Servais (Palme d’or à Cannes avec Harpya) cherchent leur propre voie dans le film expérimental et d’animation. Robbe De Hert, Guido Henderickx et Patrick Lebon construisent à Anvers le Fugitive Cinema progressif, tandis que Marion Hänsel, Jean-Jacques Andrien et Michel Khleifi façonnent un cinéma universel.
Dans les années 80 apparaît une manière plus personnelle et réaliste de faire du cinéma. Notre cinéma devient petit à petit mature et plus divers. Les producteurs Pierre Drouot, Erwin Provoost et Dominique Jeanne apportent une structure financière et économique dans le secteur et misent sur la promotion. Le public découvre tant le cinéma d’auteur que les films populaires : Brussels by Night de Marc Didden, Crazy Love de Dominique Deruddere, Toto le Héros et Le Huitième Jour de Jaco Van Dormael, Le Maître de Musique et Farinelli de Gérard Corbiau, C’est arrivé près de chez vous de Benoît Poelvoorde, Rémy Belvaux et André Bonzel ou encore Hector, Koko Flanel et Daens de Stijn Coninx. En 1987, Nicole Van Goethem remporte le premier Oscar belge du meilleur court-métrage d’animation avec Een Griekse Tragedie. Puis Le Maître de Musique et Daens sont nommés à l’Oscar du meilleur film en langue étrangère. Et avec Rosetta, Luc et Jean-Pierre Dardenne gagnent leur première Palme d’Or au festival de Cannes. Après 100 ans, les choses s’accélèrent enfin pour l’industrie cinématographique belge.
Les frères Dardenne restent toujours nos porte-drapeaux, avec de nombreux talents dans leur sillage. Trop nombreux pour être tous cités, ils comptent d’excellents acteurs, actrices, producteurs, compositeurs, chefs créatifs et artistiques, ainsi que des maîtres dans la photographie, le montage et le maquillage qui font la richesse de notre pays.
Aujourd’hui, le cinéma belge est devenu un produit d’exportation, au même titre que nos pralines, notre bière et notre chocolat. En décembre 2022, le magazine britannique Sight & Sound a désigné Jeanne Dielman, 23, quai du Commerce, 1080 Bruxelles (1975) de Chantal Akerman comme le meilleur film de tous les temps. Bien que le cinéma belge ne rencontre pas encore une grande popularité ou un succès financier régulier à l’international, le circuit festivalier international reste toujours à l’affût de nouvelles œuvres belges. Lukas Dhont (Close, Girl), Baloji (Augure) et Felix Van Groeningen (The Broken Circle Breakdown, De acht Bergen) suscitent de grandes attentes. Les récompenses pleuvent et les nominations aux Oscars ne sont plus une exception.
Les frères Dardenne ont récemment reçu plusieurs prix à Cannes pour Jeunes Mères. De plus, le documentaire Soundtrack to a Coup d’État de Johan Grimonprez a été nommé aux Oscars 2025 dans la catégorie du meilleur documentaire et la coproduction belge Flow a remporté cette année le Golden Globe et l’Oscar du meilleur film d’animation.
Faire un film coûte cher. En Europe, le cinéma est considéré comme un produit culturel et artistique, subventionné par les pouvoirs publics, contrairement aux États-Unis où l’industrie cinématographique repose sur un modèle économique basé sur le divertissement. En Belgique, chaque Communauté a mis en place des fonds pour soutenir les productions locales, mais les budgets sont et restent trop limités. En complément, le gouvernement a instauré le système de Tax Shelter, une mesure fiscale favorisant l’investissement privé.
Si le groupe Kinepolis est mondialement connu, l’arrivée des plateformes de streaming a profondément changé l’expérience cinématographique. Les grands joueurs décident de plus en plus ce qui se produit ou pas : tout doit être plus rapide ou moins cher et nos chaînes nationales peinent à suivre cette évolution.
Le cinéma est un art, une alchimie entre histoire, mise en scène, jeu d’acteur, photographie, mouvement, décors, costumes, musique, son et montage pour transformer l’ensemble en une expérience immersive et captivante sur un grand écran blanc. C’est une magie, un miroir, une réflexion d’émotions et de désirs. Le film donne conscience, rend curieux et connecte les gens et les cultures. C’est ce dont le monde a un besoin urgent et croissant.
Nous avons beaucoup de jeunes talents et la dernière décennie, de nombreux jeunes réalisateurs et quelques acteurs belges ont trouvé leur voie à l’étranger. Pour que nous puissions continuer à raconter nos propres histoires, préserver notre culture d’ouverture d’esprit, d’imagination et de liberté créative, et ne pas perdre nos talents émergents, il est essentiel de développer de nouvelles formes de financement.
Baron Stijn Coninx, réalisateur et scénariste (Daens, Hector, Koko Flanel, When the Light Comes, Sœur Sourire, Marina, Niet Schieten…), a été professeur à l'INSAS et au RITCS pendant 28 ans et est actuellement vice-président de la Cinémathèque Royale de Belgique.